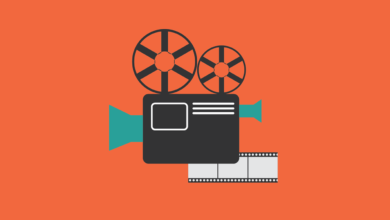Du traitement médiatique des femmes migrantes au Maroc : La Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile comme point charnière

Prepared by the researche : Achraf El Yahyaoui, Doctorant-Chercheur, LARMODAD, FSJES-Souissi, Université Mohammed V-Rabat
Democratic Arabic Center
Journal of African Studies and the Nile Basin : Thirty Issue – March 2025
A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin
:To download the pdf version of the research papers, please visit the following link
Abstract
La présence des femmes migrantes au Maroc ne date pas d’aujourd’hui. Elle remonte loin dans le temps et leur visibilité s’accroit de manière constante. Leur profil et leur lieu de provenance se diversifient. Contrairement à d’autres sociétés voisines, la société marocaine voit le traitement de la femme migrante passer par deux phases majeures : de 1999 à 2013 et de 2013 à nos jours. 2013 est une année charnière, car elle marque non seulement l’intérêt que le Maroc porte à la question migratoire, mais aussi l’évolution, quoique limitée, dans le traitement réservé aux droits des migrants en général, et de la femme tout particulièrement, cette dernière étant par ailleurs assez souvent marginalisée dans les différents types de médias.
Introduction
Au carrefour de l’Afrique et de l’Europe, le Maroc est une terre de transit et d’accueil pour de nombreux migrants, hommes et femmes, venant principalement de régions pauvres et/ou politiquement proie aux guerres, en quête de meilleures conditions de vie ou parfois pour échapper à des situations assez difficiles.
Contrairement aux hommes, les femmes migrantes sont perçues et considérées différemment. Leur expérience et/ou périple migratoire est souvent complexe, marqués essentiellement par des difficultés multiples allant de la précarité économique à la vulnérabilité sociale. A cela, il faudrait ajouter les difficultés qu’elles rencontrent dans le pays d’accueil ou de transit et le traitement partiel dont elles sont l’objet par et dans les médias.
Les médias jouent un rôle crucial dans la construction des représentations sociales et des perceptions, non seulement à l’adresse des populations migrantes, mais aussi pour tout autre phénomène de nature sociétale.
La visibilité médiatique des femmes migrantes au Maroc est assez souvent limitée et peu apparente, leur voix étant généralement marginalisée. Les récits rapportés par les médias tendent souvent à se concentrer sur les aspects passionnels et sur la propagation des stéréotypes, occultant ainsi délibérément les réalités complexes de ces femmes migrantes.
En effet, les femmes migrantes sont généralement présentées comme étant un ensemble homogène, réduites ainsi à des clichés simplistes qui ne reflètent pas leur réalité et les difficultés qu’elles endurent. Cette simplification arbitraire contribue à renforcer davantage les préjugés et les discriminations à leur encontre, en les dépeignant médiatiquement comme des «envahissantes» ou des migrantes clandestines «indésirables».
Pourtant, derrière ces images se cachent des histoires riches et variées, des parcours de résilience et de lutte. Car, ces femmes sont aussi des actrices à part entière, contribuant à leur tour au développement économique, social et culturel du pays.
Le traitement médiatique des femmes migrantes au Maroc soulève des questions d’ordre éthique et déontologique, interpellant dans les approches adoptées, l’esprit d’équilibre, de nuance et l’obligation de respecter les droits fondamentaux des étrangers tels qu’ils sont explicitement exprimés dans la Constitution marocaine de 2011.
Ce traitement risquerait de diffuser une image déformée de ces femmes migrantes et de consacrer des représentations négatives de ces dernières dans la société. Seule une prise de conscience générale de la part de ces médias pourrait contribuer à promouvoir une image réaliste et humaine de ces femmes.
Délimitation et motivations scientifiques
Cette contribution est un essai exploratoire du traitement médiatique dont les femmes migrantes au Maroc sont l’objet. Elle consiste à analyser la manière dont les médias marocains abordent la question de la migration féminine, en mettant en lumière les différentes narrations et représentations qui sont véhiculées par les différentes productions médiatiques (reportages, émissions, articles de presse…etc.).
On y examinera aussi les divers facteurs économiques et sociaux qui impactent le traitement médiatique dont ces femmes sont l’objet, ainsi que les implications de ces représentations sur la perception du public et sur les politiques migratoires.
Les raisons qui motivent cette communication sont au nombre de trois. D’abord, il faudrait noter qu’il y a peu d’écrits scientifiques sur la question. Ensuite, la compréhension de ces représentations semble cruciale pour saisir les dynamiques sociétales et les enjeux liés à la migration féminine au Maroc. Enfin, étant donné le rôle central des médias dans la construction des discours et des perceptions, cet essai pourrait contribuer à sensibiliser davantage sur les réalités vécues par les femmes migrantes et à faire prévaloir des représentations plus justes et équilibrées.
Problématique
Cette communication a pour ambition de contribuer à combler une partie des lacunes constatées dans le domaine de la recherche académique portant sur le traitement médiatique de la question des femmes migrantes au Maroc. Nous nous attèlerons à mettre en lumière les diverses représentations, les discours et les facteurs sous-jacents à travers une analyse de quelques médias locaux.
Pour ce faire, nous déclinairons notre problématique en trois grandes sous-problématiques :
– Quel est le profil général de ces femmes migrantes au Maroc ?
– Quelles sont les représentations que les médias cherchent à véhiculer à leur égard ?
– Quelles perceptions le public se fait-il de ces représentations médiatiques?
Méthodologie
La méthodologie que nous avons adoptée part d’une perspective exploratoire, à la fois descriptive et analytique. L’on s’arrêtera au niveau exploratoire, sur l’étude des principales productions médiatiques portant sur la place et l’image de la femme migrante.
Dans le même temps, l’approche descriptive nous aidera à relever les principales caractéristiques du phénomène étudié, en s’interrogeant plus particulièrement sur les facteurs qui incitent ces médias à adopter un tel traitement à l’égard des femmes migrantes au Maroc.
Partant d’une réflexion qualitative, l’on a recouru aussi à des méthodes plus empiriques telles l’observation et l’analyse des contenus, et ce pour pouvoir appréhender l’ensemble des aspects concourant à la construction des stéréotypes et des idées reçues.
Ce travail se structurera donc en deux grands axes. Le premier portera sur l’analyse des différents profils de la femme migrante au Maroc : pays de provenance, âge, état matrimonial et niveau d’éducation. Il portera aussi sur les facteurs l’ayant poussé à faire le choix de la migration. Le second aura pour objet l’analyse de la manière dont est traitée la femme migrante dans les divers médias, en termes de représentations et de perceptions. L’on conclura par un regard sur le rôle des réseaux sociaux en tant que relais de renforcement ou de déconstruction de ces images stéréotypées et dégradantes dont ces femmes continuent à faire l’objet.
- Profil des femmes migrantes au Maroc
L’étude du profil des femmes migrantes établies au Maroc est essentielle pour la compréhension des dynamiques migratoires contemporaines et les implications qui en découlent. En effet, à travers une analyse fine de ce groupe démographique, l’on pourrait saisir les multiples dimensions se rapportant à leur situation et à leur parcours migratoire, tout autant qu’aux déterminants de leur départ et les défis rencontrés dans le pays d’accueil.
1.1 Eléments statistiques sur la migration féminine au Maroc
Au Maroc, la présence des migrantes issues de l’Afrique subsaharienne ne date pas d’aujourd’hui, d’autant qu’elle provenait de pays de confession musulmane. Pourtant, le profil de cette catégorie de migrantes s’est nettement diversifié avec le temps et leur visibilité sur le sol marocain s’est de plus en plus renforcée.
Ces migrantes (originaires d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, encore moins de régions telles le Proche Orient) atterrissent le plus souvent dans les villes limitrophes, principalement à Nador, Oujda, Rabat ou Agadir, villes rejointes en faisant une longue traversée du désert mauritanien ou algérien.
Certaines études estiment à entre 50 000 et 70 000[1] le nombre de migrants subsahariens au Maroc. Selon les récents chiffres officiels publiés par les Nations Unies en 2020, les femmes représentent 48,5 % de l’immigration régulière au Maroc (OIM, 2020). A partir de là, l’on pourrait faire un recoupement qui nous conduit à une estimation de présence des femmes immigrées au Maroc, à quelques 30 000 femmes, à l’exception de celles en situation illégale, qui se compte par en milliers.
S’agissant de la structure de ces femmes, il semblerait intéressant de faire appel à l’enquête du Haut-commissariat au plan (HCP), intitulée «la migration forcée au Maroc», publiée en 2021. Quatre principaux points se dégagent de cette enquête points:
1.1.1 Répartition par pays de provenance et par âge
Pour les principaux pays d’origine de ces femmes immigrées, il faudrait noter que la République Démocratique du Congo (RDC) occupe la première place avec 53,8%, suivie de la Côte d’Ivoire avec 53,6%, la plus faible proportion revenant à la Guinée avec 27,6%, au Mali avec 29,9% et à la république de Centrafrique avec 32,8%[2].
S’agissant de la répartition par âge, presque la moitié des femmes se situe dans la catégorie d’âge 30 – 40 ans. Pour les autres catégories, elles se présentent comme suit :
Tableau 1 : Structure par âge des femmes migrantes au Maroc
1.1.2 Répartition par état matrimonial
Les données concernant l’état matrimonial sont fondamentales ici, car elles renseignent réellement sur les perspectives d’installation et de départ. En effet, l’état matrimonial des femmes immigrées au Maroc, affiche une prééminence de la femme immigrée célibataire. En termes de proportion, 51,7 % des femmes immigrées au Maroc sont des célibataires, 33,2 % sont mariées, 5,6 % sont divorcées, alors que celles en situation de concubinage représentent 2,7 %[3].
1.1.3 Répartition par niveau d’éducation
L’on observe à ce niveau, que les femmes immigrées au Maroc se distinguent par leur niveau de formation relativement élevé et les capacités professionnelles de qualité qu’elles possèdent.
En termes de statistiques, presque 22,5 % des femmes ont atteint le niveau de l’enseignement supérieur. La part des femmes ayant le niveau secondaire qualifiant est de 23,1%, le niveau collégial 19,9% et le niveau primaire 17,29%. Par contre, la proportion des femmes immigrées sans instruction est de l’ordre de 16,4 % seulement[4].
1.1.4 Répartition par domaine de spécialisation
Pour ce qui a trait au domaine de spécialisation des migrants ayant obtenu un diplôme supérieur, l’on constate que trois spécialisations se détachent nettement : le commerce et la gestion (administration des entreprises) avec 24,2%, suivi du droit (9,2%) et des technologies de l’information et de la communication (8,5%).
En outre, on s’aperçoit que le domaine relatif au commerce et à la gestion est le domaine de prédilection des femmes (34,7%), la santé (6,6%) et le droit (11,4%) étant minoritaires. En revanche, les femmes sont moins présentes dans les métiers liés à l’ingénierie et techniques parallèles (1,1%), les TIC (7%), l’ingénierie et l’architecture (1,8%), les mathématiques et statistiques (1,5%) et les sciences physiques (1,1%).
1.2 Déterminants de la migration des femmes subsahariennes établies au Maroc
Les déterminants de la migration des femmes migrantes sont multiples et complexes. Ils peuvent diverger sensiblement en fonction de la région de départ, mais demeurent, pour leur majorité, motivés par les considérations économiques, celles qui sont liées aux perspectives d’amélioration des conditions de vie et le désir d’échapper à la pauvreté et toutes autres formes de précarité sociale.
En effet, depuis pratiquement deux décennies, l’on assiste à un durcissement des conflits armés en Afrique sahélo-sahélienne, mais également au Proche-Orient, deux régions du monde où sévisse un continuum de persécutions ethniques et politiques sans merci. Les groupes terroristes sont dynamiques dans les deux régions et sont en pleine expansion, portant grande atteinte aux infrastructures vitales et contraignant les populations à l’exil volontaire ou forcé.
Dans le même ordre, et parmi les facteurs explicatifs de ce type de migration, l’on trouve le facteur climatique. De nos jours, le changement climatique et tant d’autres problématiques environnementales constituent un défi majeur, dont les implications sont notoires. Ce fléau met l’Afrique à rude épreuve, et la place dans une course contre la nature pour lutter freiner la montée linéaire du réchauffement climatique et tirer parti des richesses du continent.
1.2.1 Déterminants socio-économiques
Le choix de la migration, opéré par les femmes migrantes au Maroc, est bel et bien un choix dicté par les considérations d’ordre social et économique. Dans ce cas de figure, la précarité[5] et les opportunités économiques limitées dans les pays d’origine sont les principales raisons qui poussent de nombreuses femmes à migrer pour améliorer leur situation.
Selon les données de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en 2022, environ 58% des femmes migrantes subsahariennes au Maroc, déclarent avoir migré pour des raisons économiques (OIM, 2022).
Cette fragilité économique de l’Afrique a été explicitement soulignée par le Rapport de la Banque Mondiale sur l’état de développement en Afrique de 2022.Ce dernier avance qu’en Afrique, 45 pays sont tributaires des produits de base, et leurs recettes sont très instables en raison de la nature du marché, caractérisé par des périodes d’envolée et de chute des prix[6].
Ce constat signifie l’incapacité de près de 83 % (45 pays des 54 pays que compte l’Afrique) des économies à créer les conditions normales dont les citoyens ont besoin. De nombreuses autres études ont relevé aussi que les économies africaines sont marquées par un très faible niveau de développement et une grande dépendance envers des marchés extérieurs fluctuants et instables.
Les récentes crises mondiales, à l’instar de celle des Subprimes en 2008, celle multidimensionnelle de COVID-19 de 2020, ou encore la crise résultant du conflit russo-ukrainien, ont enclenché des envolées brutales des cours des matières premières et un effondrement des finances publiques d’Etats africains fort dépendants du reste du monde.
Cette situation donne une idée sur la capacité de résilience de ces pays et montre que ces derniers sont incapables d’agir face aux chocs externes, lesquels pèsent lourdement sur les recettes de l’Etat et sur l’investissement tant public que privé. D’où un environnement social et économique de plus en plus assombri et des conditions propices pour quitter son pays.
D’un autre côté, les études portant sur la pauvreté, à l’image du rapport de la Banque Mondiale de 2018, notent que l’Afrique subsaharienne sombre dans l’extrême pauvreté, avec un seuil de revenu qui ne dépasse pas 1,9 dollars, soit beaucoup moins que les 3.5 dollars des pays à revenus intermédiaires (Banque Mondiale, 2018).
Selon le rapport de la Commission Economique de l’Afrique, relevant des Nations Unies, 18 millions de nouveaux pauvres supplémentaires sont apparus en Afrique en 2022, alors que le continent comptait déjà plus de la moitié de la proportion de pauvres, soit 54,8 %, la plus élevée au monde. Ce qui est alarmant, car 546 millions de personnes vivaient dans la pauvreté en 2022, soit plus de la moitié de la population du continent[7].
Outre la pauvreté endémique, le continent africain se heurte aussi à la problématique du chômage. Ce dernier est fortement corrélé aux potentialités économiques de l’Afrique. La situation empire encore faute d’un modèle de développement économique qui soit en mesure d’absorber les jeunes diplômés d’une part et de mettre fin aux inégalités sociales d’autre part. Selon un rapport publié en 2023 par le BIT (Bureau International du Travail), 9,4 millions de jeunes sont à la recherche d’opportunités professionnelles, soit un taux de 8,9 % (BIT, 2023).
La même institution internationale ajoute que pour la même année, près de 62 millions de jeunes, soit 25,9 % de la population jeune, sont considérés comme « NEET », terme signifiant qu’ils ne suivent ni formation, ni éducation, ni ne sont employés. Une statistique qui présente une hausse significative par rapport au taux de 22,2 % enregistré en 2013 (BIT, 2023). Face à cette vulnérabilité dont souffre l’Afrique (principalement subsaharienne), la femme africaine opte pour la migration et s’emploie pour gagner sa vie.
1.2.2 Déterminants politiques
Au-delà des facteurs socio-économiques présidant à la migration des femmes africaines, l’on ne pourrait faire l’impasse sur la série de facteurs politiques et sécuritaires qui frappent de nombreux pays africains. Les facteurs politico-sécuritaires sont principalement dus à l’instabilité politique qui gagne une partie des pays africains du centre (Mali ; Niger ; Burkina-Faso et RDC) ou du nord (Libye, Tunisie principalement).
Les crises malienne de 2012 et syrienne de 2015 sont très significatives d’une telle réalité. Elles sont de nature politique (et ce au-delà de leurs causes) et ont conduit à de véritables drames humains humaines traduits par la fuite d’une grande proportion des ressortissants des deux pays, qui se meuvent au lendemain des conflictualités à différents pays voisins (dont principalement le Maroc, en raison de sa proximité avec l’Europe) pour échapper au calvaire et bénéficier du statut de réfugié, titre permettant une protection mondiale en vertu de la convention de Genève en 1951 (signée par le Maroc au lendemain de son indépendance).
Dans ces deux cas, une proportion importante concernait les femmes, jugées fort vulnérables à l’instabilité politico-sécuritaire, à cause principalement de leur genre, mais également aux enfants dont elles ont la lourde charge.
Selon les dernières données de l’UNHCR (Agence des Nations Unies pour les Réfugiés), le Maroc compte sur son territoire presque 14 500 réfugiés et demandeurs d’asile, dont 37,4 % sont des femmes, tandis que les syriens occupent la première place. La figure ci-dessous trace la montée linéaire du nombre de réfugiés depuis 2015 :
Figure 1 : Evolution des migrants et refugiés (2002-2022)
1.2.3 Déterminants climatiques
De nos jours, le changement climatique est considéré comme étant dramatique, pour le monde entier et pour l’Afrique en particulier. Il provoque des dégâts énormes sur les espèces vivantes, exacerbe les problèmes des écosystèmes et donne naissance à une série de défis difficiles à surmonter, ou du moins à en atténuer l’impact et les implications (sécheresses prolongées, inondations, désertification et érosion des ressources naturelles/des terres arables).
Les conséquences du réchauffement climatique sont réelles. Elles affectent directement les moyens de subsistance des populations (rurales notamment), mettent en péril la productivité et entraînent l’effondrement des écosystèmes vitaux pour la survie humaine. Cette réalité contraint les populations locales à déserter, pour s’établir dans des régions moins affectées (littoral africain par exemple) ou pour déposer des demandes d’asile dans la perspective de devenir réfugié climatique.
Selon l’Agence Française de développement, l’Afrique se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Le continent a vu ainsi ses températures augmenter de + 1,4 °C depuis l’ère préindustrielle contre + 1,1 °C à l’échelle du globe. En termes de chiffres, ce phénomène a provoqué en 2020, le déplacement interne de 7,4 millions de personnes, un chiffre qui, selon les spécialistes, est appelé à croitre en l’absence de mesures directes et efficaces[8].
- Analyse du traitement médiatique des femmes migrantes au Maroc
Le traitement que réservent les médias aux femmes migrantes au Maroc est d’une grande importance, ne serait-ce que parce qu’il reflète les interactions entre migration et médias dans un contexte particulier. Dans un pays comme le nôtre, les femmes migrantes, venues d’Afrique subsaharienne ou d’une autre région du monde, se trouvent assez souvent au croisement de multiples formes de stéréotypes, de stigmatisation et de xénophobie, faits exacerbés par ailleurs, par les représentations véhiculées par certains médias.
De même, la manière dont les médias marocains façonnent la perception du public à l’égard des femmes migrantes (et des migrants de façon générale) est souvent superficielle, déformée et simpliste. Ils tendent souvent sous-estimer leurs vulnérabilités, précarités et les difficultés énormes auxquelles elles font face, allant même jusqu’à les dénigrer.
2.1. Evolution du traitement médiatique des femmes migrantes au Maroc
Le traitement médiatique de la femme migrante au Maroc est passé par deux étapes essentielles, maquées pour chacune, par un traitement particulier à l’égard de cette catégorie de migrantes. La première couvre la période de 1999 (date de l’accession au trône du Roi Mohamed VI) à 2013, la seconde s’étalant de 2013 jusqu’à nos jours.
2.1.1 La période de 1999 à 2013
La période d’avant 2013 a été spécifique. Car le paysage médiatique de l’époque était marqué par une influence grandissante de la presse écrite (rattachée aux partis politiques notamment) et une faible influence des médias privés ou des réseaux sociaux. Le traitement de la question migratoire par les médias marocains allait porter la marque de cette réalité puis de l’influence réduite des nouveaux outils médiatiques, web et réseaux sociaux.
Les médias jouent ici un double rôle. D’un côté, ils influencent l’opinion publique du pays d’accueil et endosse, de l’autre côté, une grande responsabilité dans le processus de prise de décision de la migration.
Pour la période de 1999 à 2013, le traitement médiatique de la question migratoire a été éminemment stéréotypé et surchargé d’idées reçues. En effet, c’est à partir de 1995, année de l’entrée en vigueur des accords de Schengen, que l’étau commence à se resserrer sur les migrants subsahariens au Maroc, avec l’institution d’un « partenariat politique et de sécurité », partenariat ayant indirectement pour principal objectif, le maintien des migrants illégaux sur le sol marocain. Dès lors, leur présence s’accroit de manière fulgurante.
Le premier acte médiatique relevé en réaction à cette situation était la Une de l’Hebdomadaire « Achamal » datant de septembre 2005. Ce dernier est allé jusqu’à comparer les migrants subsahariens à de véritables « criquets noirs » qui envahissent le nord du Maroc, avec mise en perspective d’une image de trois migrants subsahariens.
Le Tribunal de Tanger a d’ailleurs condamné le directeur de publication dudit journal pour «incitation à la haine raciale », lui infligeant ainsi une peine de prison avec sursis. C’est un message fort adressé à ce genre de propos et une mise en garde nette contre les éventuels dérapages xénophobes des médias marocains. Au cours de la même année, d’autres journaux ont réservé un traitement frôlant la xénophobie à cette question. L’on cite à titre d’exemple, le quotidien Al Haraka, organe du parti du Mouvement populaire ou L’Opinion, organe du parti de l’Istiqlal[9].
Certains médias se mettaient même à parler d’identité, en lançant des propos dégradants à l’égard de ces femmes, comme étant des femmes s’adonnant à la mendicité, n’hésitant pas à glisser dans le monde de prostitution et les qualifiant de manque d’hygiène.
En 2003 une nouvelle loi sécuritaire sur l’immigration a été instituée, loi fortement contestée par ailleurs, en raison de ses dispositions allant à l’encontre de certains droits des femmes, notamment les femmes fuyant les persécutions ethniques et les guerres, qui peuvent être appréhendées par la police avant même de pouvoir déposer la demande d’asile. Cette dimension n’a pas été relevée par les médias de l’époque.
L’on déplore aussi le fait que certains médias, par manque de réserve ou par indifférence, se sont livrés à comparer la femme migrante à l’épidémie d’Ébola. Ce stéréotype est parfois utilisé dans la rue à l’égard des femmes noires.
En 2012, le journal Maroc Hebdo emboîtait le pas à Achamal. Le journal titrait dans sa Une « le Péril noir », en référence aux migrants subsahariens qui envahissaient le Maroc, faisant la manche et le concubinage et pose un problème humanitaire pour le pays[10]. Le journal a fait l’objet, suite à cela, de vives critiques sur les réseaux sociaux.
Cette « Une » aura pour effet de créer un « électrochoc » pour une grande frange de la société marocaine. Un électrochoc salutaire d’ailleurs, puisqu’il a permis de réaliser combien les populations migrantes pouvaient être victimes d’un traitement passionné de la part de certains médias.
2.1.2 Période d’près 2013
L’année 2013 est fondamentale dans l’histoire contemporaine de la migration au Maroc. C’est une année de référence qui marque l’annonce par le souverain du lancement d’une nouvelle Stratégie, se voulant humaniste et volontaire, saluée vigoureusement par la communauté internationale et par la société civile marocaine.
Cette stratégie survient immédiatement après la remise par le CNDH (Conseil National des Droits de l’Homme) à la plus haute autorité du pays d’un rapport intitulé « Etrangers et droits de l’homme au Maroc : pour une nouvelle politique d’immigration et d’asile radicalement nouvelle ».
Cette stratégie a lancé des messages clairs à l’adresse de toutes les parties concernées. Pour ce qui est relatif aux médias, le CNDH exhorte les journalistes marocains à :
– s’abstenir de diffuser tout message incitant à l’intolérance, à la violence, à la haine, à
la xénophobie, au racisme, à l’antisémitisme ou à la discrimination envers les étrangers ;
– promouvoir un traitement journalistique et des analyses équilibrées de l’immigration
en mettant l’accent également sur ses aspects positifs ;
– combattre les stéréotypes et les discours négatifs sur la migration ;
– contribuer de manière active à la sensibilisation de la population contre le racisme
et la xénophobie[11].
Au cours de la même année, une campagne de régularisation a été lancée et 92 % des 27,463 demandes de régularisation déposées ont été acceptées, dont 10,201 femmes, selon le Ministère chargé des marocains résidents à l’étranger et de la migration (MCMREAM).
Une prise de conscience grandissante a été constatée suite à cela, en particulier chez les journalistes qui n’ont pas manqué de développer des discours plus équilibrés en matière de migration. Mais cela n’a tout de même pas empêché la persistance de certains dérapages xénophobes.
L’étude effectuée par le Groupe arabe d’observation des médias dans la zone MENA (la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord) révèle qu’entre le 11 et 31 octobre 2015, cinq quotidiens arabophones marocains (Al Akhbar, Al Massae, Assabah, El Ahdath, Akhbar Al Yaoum) ont utilisé plus de 140 fois des discours «insultants, stigmatisants ou haineux » « principalement dans des articles politiques publiés par les quotidiens Al Ahdath Al Maghribia (37 %) et Al Akhbar (29 %)»[12].
Le chercheur Massimiliano Di Tota, chercheur en migration, déplore le manque de couverture médiatique et le désintérêt des journalistes quant aux questions migratoires relatives aux migrants subsahariens qui rejoignent sans cesse le Maroc. Ce dernier compte huit journalistes professionnels s’intéressant au sujet de façon régulière[13].
Pour Salaheddine Lemaizi, des journalistes de la presse francophone, notamment Hassan Bentaleb de Libération et Julie Chaudier, journaliste indépendante basée à Casablanca, présentent des « analyses fort pointues » sur les questions migratoires, avec des articles montrant souvent en lumière les aspects négligés, tout autant que les exactions que subissent les populations migrantes par les autorités marocaines.
« Le droit à un environnement sain fait partie intégrante des valeurs socialistes » ; « Les migrants, une aubaine pour le Maroc ? » font partie de la série d’articles publiés par Bentaleb.
Le manque de couverture de la question des réfugiés Syriens au Maroc est ainsi déplorable. Depuis le début de leur arrivée (à partir de 2015), les femmes syriennes sombrent dans la précarité et la misère.
Cependant, on peut souligner l’effort de certains journalistes de télévision qui évoquent de temps à autre, ces questions, comme par exemple les journalistes de l’émission « 60 minutes » de Medi 1 TV (il y a huit ans), dont les invités représentent les principales parties prenantes engagées dans le domaine. But : discuter le bilan de 3 ans du lancement de la Stratégie.
En août 2021, un article majeur est paru dans le média francophone Jeune Afrique, abordant les femmes migrantes mères. Selon JA, ces femmes sont exposées à toutes sortes de danger, dont principalement d’être proies aux proxénètes et les précriminels.
L’importance de l’article venait de la lumière qu’il avait mise sur l’association Kirikou, créée en 2015 par un Franco-Sénégalais, avec pour principal objectif de prendre en charge les enfants des femmes migrantes vulnérables et les mineurs isolés au Maroc, pour leur permettre de trouver un emploi et subvenir à leurs besoins[14].
L’institut du Genre en Géopolitique abonde dans le sens de l’article de Jeune Afrique. L’institut dans un article paru en octobre 2023 sur son site, fait savoir que face aux multiples dangers, les femmes migrantes au Maroc sont contraintes de s’organiser pour éviter la violence. Il met en évidence l’absence de chiffres officiels sur la violence faite à ces femmes.
Néanmoins, l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) met en avant un phénomène « aux proportions immenses ». L’ONG avance qu’à ces locaux, 1/3 des femmes migrants prises en charge témoignent avoir déjà été victime une ou plusieurs fois, que ce soit dans son pays d’origine, au cours du périple migratoire ou sur le territoire marocain[15].
En outre, les femmes migrantes dénoncent constamment le racisme affiché dans les transports en commun, tout autant qu’au logement où, comme à Casablanca, l’on observe des pancartes affichant l’interdiction de louer aux africains.
2.2 Quelles perceptions du traitement médiatique de la femme migrante au Maroc
Le traitement médiatique de la femme migrante est variable. Il reste tributaire d’un grand nombre d’éléments dont principalement le professionnalisme et la déontologie. Ce traitement est tantôt positif tantôt négatif, et ce selon le contexte en question.
2.2.1 Avec la société marocaine
Nous ne savons pas représenter les étrangers dans nos sociétés, note le professeur François Crépeau, Rapporteur Spécial des Nations Unies depuis 2011, les migrants n’apparaissent pas, ne se plaignent pas et n’ont pas voix au chapitre, car ils ont peur du renvoi et de la stigmatisation.
Aujourd’hui, un traitement négatif de la femme migrante porte en son sein plusieurs préjudices, car elle peut prendre part, à l’égard des marocains, au processus de développement via la mise à disposition de sa compétence et de son savoir-faire.
Néanmoins, les médias sont en mesure d’agir sur deux voies. Ils peuvent aller dans le chemin de la stigmatisation et la tenue de propos comme « les femmes migrantes viennent voler notre boulot » ou le contraire (valoriser leur contribution). Dans ce cas, le comportement qu’adopte le marocain envers la femme migrante est amené à s’adoucir, si les médias empruntent la voie d’une présentation juste, positive et impartiale.
Néanmoins, avec l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), une nouvelle ère s’ouvre. Leur usage progresse et entraîne ainsi une évolution des médias et leur influence auprès du public.
Aujourd’hui, entre 57,1 et 60,7 % de la population marocaine, aux alentours de 33,8 millions est en ligne (20,068,556 internautes en 2016), selon l’Union Internationale de Télécommunication. De même, l’usage des réseaux sociaux monte exponentiellement, avec près de 27 millions de marocains utilisateurs de WhatsApp et près de 23 millions pour Facebook[16] (Cf. Figure ci-après).
Figure 2 : Usages des nouveaux médias
Si les marocains affichent un intérêt grandissant et un fort engouement pour les réseaux sociaux, l’usage de ces derniers pourrait devenir une arme majeure des médias dans leur stratégie d’influence.
Deloitte (Organisation mondiale spécialisée dans le conseil) résume de la sorte les nouvelles pratiques à employer à l’avenir par toute organisation/société désireuse de faire passer un message à des fins multiples : «la forte augmentation des utilisateurs de smartphones et de réseaux sociaux en Afrique favorisera […] la visualisation de plus en plus fréquente des vidéos courtes ce qui impactera sûrement le ‘profilage’ et le ciblage publicitaire»[17].
2.2.2. Avec les pouvoirs publics
Les médias se servent de plusieurs moyens dans le but d’exercer une influence certaine. S’agissant des pouvoirs publics, les médias peuvent les amener soit à un durcissement de la politique migratoire soit à l’assouplissement de ces dernières.
On pourrait miser, à titre d’exemple, sur une intermédiation entre les organes de défense des droits des migrants ( de concert avec les représentants même de ces migrants) avec le pouvoir public, soit pas le biais d’une confrontation de points de vues (dans des émissions par exemple), ou à travers des reportages et des enquêtes afin de leur transmettre le message idoine, susceptibles de contribuer à d’éventuelles améliorations de la situation.
Avec le concours de la société civile, les médias peuvent jouer un rôle clef dans la couverture de ses travaux portant sur le suivi de la situation de la femme migrante au Maroc, en élaborant régulièrement des rapports parallèles pointant du doigt les points à rattraper en ce qui concerne le respect des différentes conventions ratifiées par le Maroc, à l’instar des conventions en relation avec les réfugiés, avec l’élimination de la discrimination à l’égard de la femme ou celle sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille.
2.2.3 Rôle réseaux sociaux comme relais
Pour Jean-Paul Marthoz, dans son ouvrage « Couvrir les migrations » : « face à des sujets aussi “chargés” que les migrations, le journalisme a un choix : contribuer par ses négligences, ou par son indifférence au malheur du monde ou, au contraire, participer, dans le respect des règles du métier à la défense de la dignité humaine ».
Pour déconstruire l’image erronée portée vis-à-vis des migrants et la femme migrante en particulier, les journalistes doivent prendre appui sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, YouTube et Instagram, eu égard au grand nombre d’utilisateurs, de la grande capacité d’influence et de l’esprit de créativité que peuvent renfermer les contenus orientés vers la sensibilisation.
S’agissant de Facebook, la popularité qu’il revêt est incontestable, pour toutes tranches d’âge et pour les deux genres (Voir la dernière figure).
La page Facebook du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR), comporte 4 millions d’abonnés. L’OIM-Maroc, quant à elle, voit le nombre de ses abonnés en accroissement, avec près de 3500 abonnés. Les deux organisations publient régulièrement des vidéos/témoignages sur des réfugiés, leurs malheurs et les aides qui leur sont accordées, et reçoivent des milliers de mention Like et autant de partage.
Pour ce mois de Mars (où la journée de la femme est fêtée mondialement), l’OIM-Maroc met en avant sur Facebook, le rôle des femmes dans le développement mondial. Elle souligne que les préjugés sexistes ont longtemps restreint l’accès des femmes au travail et entravé le plein développement des économies.
Étant donné que 93 % des utilisateurs des réseaux sociaux au Maroc passent la plupart de leur temps sur Facebook, le potentiel d’influence de ce dernier est énorme et se doit d’être exploité pour sensibiliser l’opinion sur la question migratoire au Maroc[18].
Quant à YouTube, le réseau représente le deuxième réseau le plus consulté au Maroc. Le contenu en relation avec la question migratoire oscille entre conseil/orientation et sensibilisation. En guise d’exemple, depuis sa création en 2006, plus de 23,000 personnes sont abonnées au compte YouTube du HCR des Nations Unies. Les vidéos du HCR ont été vues plus de 10 millions fois[19].
Outre ces deux plateformes, l’on ne pourrait faire l’impasse de Instagram. Ce dernier a fait preuve à maintes reprises de son efficacité, à la fois pour produire des photos et des vidéos très courtes comparativement aux long-métrages suscitant l’ennui à cause de la pléthore d’informations multimédia déjà présente sur les autres réseaux.
En s’appuyant sur ces réseaux, tout devient ciblé grâce à des méthodes appropriées. Autrement dit, la tâche devient facile et le ciblage des populations devient maitrisable, tout autant que les autres tâches connexes inhérentes au suivi et à l’évaluation des résultats des campagnes de sensibilisation.
Cependant, étant donné que les médias sont sous la tutelle de la réglementation, il semble fort judicieux et fondamental de préciser leur le rôle qui leur incombe. Lors d’une rencontre internationale organisée par la HACA, en marge de la signature du pacte de Marrakech en 2018, la présidente de l’institution avait mis en garde contre la représentation récurrente de la migration comme une crise géopolitique contemporaine, alors que le phénomène migratoire est inhérent à l’histoire de l’humanité.
La présidente de la HACA a souligné également la responsabilité des régulateurs en matière de promotion d’un traitement médiatique rigoureux et éthique de cette question, insistant sur le fait que les médias seraient une nouvelle fenêtre d’émergence d’un nouveau type d’immigré qui n’est plus doublement absent (de son pays d’origine et de celui d’accueil) mais doublement présent et en contact permanent avec diverses communautés avec qui il interagit[20].
Or, si les réseaux sociaux constituent l’espace favori pour les jeunes marocains et la principale cible des campagnes de sensibilisation, il ne faut pas sous estimer le rôle des autres médias, qui, eux aussi, ont leur part d’influence. Autrement dit, chaque média joue son rôle : la télévision informe les femmes, la radio les chauffeurs de taxi et les réseaux sociaux les jeunes.
Conclusion
La femme migrante est présente au Maroc depuis pratiquement deux décennies, les études et enquêtes menées par différentes instituions nationales et nationales montrent l’accroissement de leur nombre et la diversification de leur profil, leur pays de provenance ainsi que leur niveau d’éducation.
La femme migrante au Maroc œuvre dans des domaines variés, allant de la couture à la coiffure et leur visibilité au sein de la société marocaine devient un fait courant, en raison des liens privilégiés qui lient le Maroc aux autres Etats de l’Afrique, incarnés principalement par la volonté des partenariat sud-sud en cours.
Néanmoins, le traitement que réservent les médias marocains à la femme migrante est généralement négatif, stéréotypé et simpliste. Il va dans le sens du discours passionné, marqué essentiellement par une image erronée «collée sur le dos » de la femme migrante, et faisant parfois montre d’une discrimination sans détours.
Depuis le tournant opéré sur la question migratoire par la mise en place de la SNIA, les médias épousent la prudence et craignent les implications d’un éventuel dérapage et la perte de crédibilité.
La généralisation des TIC et des réseaux sociaux devient une arme à double tranchant. D’un côté, un usage à des fins de sensibilisation et de partage de bonnes pratiques, et de l’autre côté un usage déboussolé, distingué par des agissements anti-migratoires. Ceci interpelle la déontologie du métier de journaliste, mais aussi les lois sur la discrimination et la xénophobie ainsi que le degré de respect des conventions signées
Bibliographie
Conférence Internationale des Nations Unies, « Le rôle des médias et des régulateurs africains et méditerranéens face à la crise des migrants et réfugiés », Réseau des instances de régulation méditerranéenne ; Haute Autorité de Communication Audiovisuelle ; Réseau des instances africaines de régulation de la communication, Marrakech, 2018.
CNDH, «Etrangers et droits de l’Homme au Maroc : pour une nouvelle politique d’immigration et d’asile radicalement nouvelle », Rabat, 2013.
Elisabeth Byrs et Julia Burpee, «Média et Migration : Couverture médiatique de la migration : l’influence des différents médias sur l’opinion publique au Maroc », OIM/Union européenne, mars, 2017.
Perle Guichenducq (2023), «Au Maroc, les femmes migrantes subsahariennes s’organisent entre elles pour éviter les violences », Institut Géopolitique du Genre. https://igg-geo.org/?p=15645,
HCP, « Migration forcée au Maroc », septembre 2021.
Nations Unies, «Repenser les fondements de la diversification des exportations en Afrique : le rôle catalyseur des services financiers et des services aux entreprises», Rapport sur le développement économique en Afrique, 2022.
Webiographie
https://aujourdhui.ma/economie/usage-des-tic-les-grands-constats-de-2020,
https://www.afd.fr/fr/ressources/infographie-lafrique-face-au-changement-climatique,
https://journalinbled.wordpress.com/2015/06/,
[1]https://www.infomigrants.net/fr/post/52374/le-maroc-de-plus-en-plus-un-pays-de-destination-pour-les-femmes-dafrique-subsaharienne, site consulté le 06/03/2024.
[2]HCP, «Migration forcée au Maroc», septembre 2021, p.34.
[3]HCP, enquête nationale…, p.36.
[4]HCP, enquête nationale…, p.38.
[5]En entend ici par précarité, le fait qu’un citoyen, peu importe son pays d’origine, est fortement fragile au choc externe et qu’une crise économique peut être dévastatrice pour lui.
[6]Nations Unies, «Repenser les fondements de la diversification des exportations en Afrique : le rôle catalyseur des services financiers et des services aux entreprises », Rapport sur le développement économique en Afrique, 2022, p.19.
[7]https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99afrique-doit-endiguer-la-pauvret%C3%A9-et-les-in%C3%A9galit%C3%A9s-sociales-pour-atteindre-ses-objectifs, site consulté le 06/03/2024.
[8]https://www.afd.fr/fr/ressources/infographie-lafrique-face-au-changement-climatique, site consulté le 06/03/2024.
[9]https://journalinbled.wordpress.com/2015/06/, site consulté le 07/03/2024.
[10]https://www.courrierinternational.com/article/2012/11/09/pourquoi-le-peril-noir-de-maroc-hebdo-provoque-l-indignation, site consulté le 07/03/2024.
[11] CNDH, « Etrangers et droits de l’Homme au Maroc : pour une nouvelle politique d’immigration et d’asile radicalement nouvelle », Rabat, 2013.
[12]Elisabeth Byrs et Julia Burpee, «Média et Migration : Couverture médiatique de la migration : l’influence des différents médias sur l’opinion publique au Maroc », OIM/Union européenne, mars, 2017,p.15.
[13] Elisabeth Byrs et Julia Burpee, Média …,p.13.
[14]https://www.jeuneafrique.com/1213751/societe/maroc-mountaga-diop-les-femmes-migrantes-seules-avec-enfants-sont-des-proies, site consulté le 07/03/2024.
[15]Perle Guichenducq (2023), Au Maroc, les femmes migrantes subsahariennes s’organisent entre elles pour éviter les violences, Institut Géopolitique du Genre. https://igg-geo.org/?p=15645,
[16]https://aujourdhui.ma/economie/usage-des-tic-les-grands-constats-de-2020, site consulté le 06/03/2024.
[17]Elisabeth Byrs et Julia Burpee, « Média …,p.45.
[18]Elisabeth Byrs et Julia Burpee, « Média …,p.46.
[19]Ibid.
[20] Conférence Internationale des Nations Unies, « Le rôle des médias et des régulateurs africains et méditerranéens face à la crise des migrants et réfugiés », Réseau des instances de régulation méditerranéenne ; Haute Autorité de Communication Audiovisuelle ; Réseau des instances africaines de régulation de la communication, Marrakech,2018,p.4.