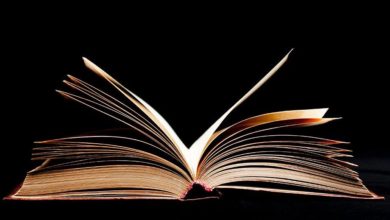LA TRANSFORMATION DU PARADIGME SECURITAIRE ISRAELIEN SOUS BENNETT-LAPID
The Transformation of Israel’s Security Paradigm under Bennett-Lapid

Prepared by the researche : Doctorant Karim AICHE, Université Mohammed V, Royaume du Maroc – Sous la Direction du Pr. Ahmed Ouedghiri Ben Otmane, Université Mohammed V, Royaume du Maroc
Democratic Arabic Center
Journal of Strategic Studies for disasters and Opportunity Management : Twenty-sixth Issue – June 2025
A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin
:To download the pdf version of the research papers, please visit the following link
Résumé
Cette étude examine l’évolution de la doctrine sécuritaire d’Israël sous le gouvernement Bennett-Lapid (2021–2022). Sur le plan interne, l’instabilité politique et les tensions sociales ont fragilisé la cohésion nationale. À l’extérieur, les menaces continues de l’Iran, du Hezbollah et du Hamas ont contraint Israël à moderniser son dispositif de défense et à intégrer les nouvelles technologies. Malgré la normalisation diplomatique avec plusieurs pays arabes, l’environnement régional reste instable. L’étude souligne les défis éthiques posés par l’usage des technologies sécuritaires, et la nécessité pour Israël d’équilibrer protection nationale et respect des principes démocratiques.
Abstract
This study analyzes the profound changes in Israel’s security doctrine during the Bennett-Lapid government (2021–2022). Internally, political instability, societal polarization, and judicial reforms significantly influenced national security management. Externally, persistent threats from Iran, Hezbollah, and Hamas forced Israel to adopt proactive defense measures and reorganize its intelligence and defense structures. Technological innovations, particularly cyberwarfare and artificial intelligence, redefined Israel’s security apparatus while raising ethical concerns regarding human rights. Despite diplomatic breakthroughs through the Abraham Accords, Israel continued to face mounting regional instability. This work highlights the delicate balance between security imperatives and the preservation of democratic principles, showing how Israel’s evolving doctrine seeks to maintain military superiority while adapting to an increasingly complex geopolitical landscape.
Introduction :
La période étudiée se caractérise par une intensification des défis politiques et sécuritaires auxquels Israël doit faire face, tant sur le plan interne qu’externe.
Sur la scène nationale, la coalition gouvernementale menée par Naftali Bennett et Yair Lapid a introduit une dynamique d’instabilité politique, exacerbée par les controverses entourant les projets de réformes judiciaires. Cette atmosphère tendue a engendré de vives protestations et de profondes fractures sociales au sein de la population israélienne[1].
À l’échelle internationale, Israël est confronté à des menaces stratégiques majeures. La position hostile de l’Iran, notamment en ce qui concerne son programme nucléaire, est perçue comme une menace existentielle². À cela s’ajoutent les tensions continues avec des acteurs régionaux comme le Hezbollah au Liban et les groupes soutenus par l’Iran en Syrie, qui maintiennent une pression sécuritaire constante le long des frontières.
Par ailleurs, bien que les Accords d’Abraham aient permis la normalisation des relations diplomatiques avec plusieurs États du Golfe – notamment les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan –, ils n’ont pas entièrement dissipé les risques sécuritaires régionaux².
Sur le terrain sécuritaire, Israël subit une recrudescence d’attaques terroristes, notamment de la part du Hamas à Gaza et du Jihad islamique palestinien¹. Entre 2021 et 2023, l’apparition de nouveaux groupes armés indépendants, tels que “Fosse aux lions”, complique davantage le paysage sécuritaire¹. Les tensions intercommunautaires en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, alimentées par des conflits persistants avec les factions palestiniennes, renforcent ce climat d’insécurité.
Face à ces défis, Israël a adopté une stratégie proactive de coercition, comprenant des frappes militaires ciblées contre les positions du Hezbollah, du Hamas et d’autres entités terroristes. L’armée israélienne a également intensifié ses opérations en Cisjordanie, multipliant les arrestations et les démolitions de structures palestiniennes, des actions qui suscitent des critiques internationales sur la politique de colonisation[2].
La doctrine sécuritaire israélienne reste structurée autour de deux axes fondamentaux : prévenir les menaces existentielles et maintenir une supériorité militaire qualitative sur les adversaires régionaux. Toutefois, certaines pratiques militaires, notamment les frappes en territoire syrien et les mesures sécuritaires dans les territoires occupés, font l’objet de critiques concernant le respect du droit international et des droits humains.
Aujourd’hui, la communauté internationale suit de près l’évolution de la situation, à la lumière de l’aggravation des tensions israélo-palestiniennes et de l’instabilité régionale[3]. Les organismes israéliens de sécurité nationale sont ainsi appelés à ajuster continuellement leurs stratégies pour faire face à un environnement de plus en plus complexe et imprévisible.
Pour analyser de manière approfondie l’évolution récente du paradigme sécuritaire israélien, il est nécessaire de clarifier les concepts opérationnels et les enjeux géopolitiques qui sous-tendent ses dynamiques de défense.
En premier lieu, le terrorisme constitue un axe central de la politique sécuritaire d’Israël. Les groupes comme le Hamas et le Jihad islamique palestinien continuent d’être au cœur des tensions régionales, menant des actions qualifiées d’attaques terroristes contre l’État israélien[4]. Cependant, la définition même du terrorisme varie considérablement selon les perceptions nationales et internationales. Tandis que l’État israélien classe la majorité des groupes armés palestiniens et leurs alliés iraniens, comme le Hezbollah, sous l’étiquette terroriste, d’autres acteurs sur la scène internationale adoptent des définitions plus nuancées[5]. Cette subjectivité influence non seulement la manière dont Israël conçoit ses priorités sécuritaires, mais aussi son approche diplomatique vis-à-vis des acteurs régionaux et globaux[6].
S’agissant des menaces régionales, l’Iran demeure la principale source d’inquiétude sécuritaire pour Israël. Son programme nucléaire, ses avancées balistiques et son soutien militaire aux groupes armés dans le Croissant chiite sont perçus par Israël comme des éléments d’une stratégie régionale visant à son encerclement[7]. De plus, le Hezbollah, avec son arsenal militaire renforcé au Liban, et les milices chiites actives en Syrie, maintiennent une pression sécuritaire constante aux frontières nord et nord-est d’Israël[8]. Toutefois, les Accords d’Abraham, signés en 2020, ont permis à Israël de normaliser ses relations avec plusieurs États arabes – notamment les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan –, modifiant partiellement l’équilibre diplomatique au Moyen-Orient[9]. Cette dynamique offre à Israël de nouvelles opportunités économiques et sécuritaires, même si elle ne réduit pas significativement les menaces existentielles régionales.
Sur le plan interne, la gouvernance de la coalition Bennett-Lapid s’est révélée particulièrement fragile. Marquée par des divergences idéologiques profondes et une crise de confiance généralisée, cette période a vu émerger de fortes tensions politiques autour des réformes du système judiciaire, déclenchant de vastes mouvements de contestation[10]. Les divisions communautaires traditionnelles (juifs séfarades vs ashkénazes, religieux vs laïcs, juifs vs arabes israéliens) se sont exacerbées, alimentant un climat de défiance généralisée[11]. Ce contexte intérieur tendu a poussé les organes sécuritaires israéliens à ajuster leurs priorités en matière de gestion des risques internes, en intégrant de manière plus systématique la surveillance des troubles civils et des violences intercommunautaires[12].
Face à cette double menace interne et externe, Israël a privilégié une doctrine de riposte anticipative et de pression militaire ciblée. Des opérations de neutralisation préventive ont été intensifiées en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et sur le territoire syrien⁴. La multiplication des démolitions de maisons, des arrestations ciblées et des frappes de précision a été justifiée par la nécessité de maintenir l’avantage stratégique sur des ennemis multiples⁵. Cependant, ces actions ont provoqué de vives critiques sur le plan international, en particulier en ce qui concerne le respect du droit humanitaire international⁸.
Le paradigme sécuritaire israélien repose donc sur une articulation complexe entre préservation de la sécurité nationale, maintien de la supériorité militaire régionale et gestion d’une instabilité politique intérieure croissante. Comprendre ces éléments est indispensable pour appréhender les ajustements doctrinaux et opérationnels opérés par Israël au cours de la période récente.
Hypothèses sur l’impact des menaces sur l’appareil sécuritaire
L’analyse de l’impact des menaces sur l’appareil sécuritaire israélien repose sur une série d’hypothèses tenant compte des dynamiques internes et externes.
Premièrement, la persistance des menaces terroristes, notamment celles émanant du Hamas et du Jihad islamique palestinien, met en lumière des vulnérabilités majeures dans les systèmes de renseignement et d’alerte précoce israéliens. L’attaque du 7 octobre 2023 en est une illustration dramatique : malgré des signes précurseurs identifiés en amont, l’incapacité à prévenir et à contenir cette attaque a révélé des défaillances critiques dans la coordination et la réactivité des forces de sécurité[13]. Ce fiasco sécuritaire soulève des interrogations fondamentales sur la capacité d’Israël à anticiper et à neutraliser efficacement les menaces asymétriques dans un contexte d’escalade rapide.
Deuxièmement, les pressions géopolitiques externes, en particulier l’influence stratégique de l’Iran et de ses alliés régionaux comme le Hezbollah, renforcent la vulnérabilité d’Israël sur plusieurs fronts. Le programme nucléaire iranien et les capacités balistiques de ses proxies génèrent une menace stratégique directe, alimentant la doctrine israélienne de frappes préventives[14]. À ce titre, plusieurs hypothèses stratégiques envisagent des frappes israéliennes contre les installations nucléaires iraniennes, bien que de telles actions comporteraient d’importants risques politiques, diplomatiques et militaires[15]. Cette menace structure Israël dans un état de vigilance opérationnelle permanente et impose des ajustements constants de ses doctrines de dissuasion et de projection de force.
Troisièmement, sur le plan interne, l’instabilité politique et sociale compromet la cohésion de l’appareil sécuritaire. Le gouvernement Bennett-Lapid a été confronté à une polarisation croissante alimentée par des réformes judiciaires controversées et des mouvements sociaux de grande ampleur[16]. Ces tensions internes sapent la capacité des forces de sécurité à se concentrer sur les menaces extérieures, les obligeant à redéployer des ressources vers la gestion de l’ordre public, la surveillance communautaire et la prévention des violences interethniques. Le double front interne-externe impose une lourde charge sur des institutions sécuritaires déjà sollicitées par la montée des conflits asymétriques.
Quatrièmement, les stratégies de riposte sécuritaire, bien qu’efficaces à court terme, soulèvent des interrogations sur leur durabilité juridique et éthique. Les mesures de répression, les démolitions de structures palestiniennes, les arrestations de masse, ainsi que les frappes préventives à l’étranger, sont perçues par certains acteurs internationaux comme des violations potentielles du droit international humanitaire[17]. Cette tension entre impératif sécuritaire et respect des normes démocratiques pose un dilemme stratégique majeur : Israël peut-il préserver son modèle démocratique tout en maintenant une doctrine de sécurité nationale fondée sur la coercition préemptive ?
En définitive, l’ensemble de ces hypothèses souligne une recomposition profonde de l’appareil sécuritaire israélien, contraint de s’adapter à une multiplicité de menaces évolutives, tout en naviguant dans un contexte intérieur fragilisé et un environnement international de plus en plus critique.
Contexte Politique, Sécuritaire et Géopolitique
Analyse du Gouvernement Bennett-Lapid et des Politiques Mises en Œuvre
Le gouvernement Bennett-Lapid, formé en juin 2021, constitue une expérience politique inédite dans l’histoire contemporaine d’Israël. Surnommée « gouvernement du changement », cette coalition hétéroclite réunissait des partis issus de tout le spectre politique, de la droite nationaliste aux formations de gauche progressiste, incluant également le parti islamiste Ra’am[18]. Cette diversité idéologique a entraîné une gestion particulièrement complexe, rendant la stabilité politique fragile et exposant l’État à des défis internes et externes majeurs².
Politique intérieure : Réformes et tensions
Sur le front intérieur, le gouvernement a tenté d’impulser des réformes structurelles, notamment dans le domaine judiciaire. Cependant, les projets de modification du système judiciaire, perçus comme une atteinte à l’équilibre des pouvoirs, ont déclenché des mobilisations populaires massives[19].
Les profondes divergences entre les partis coalisés – en particulier sur les questions de laïcité, de politiques sociales et d’organisation judiciaire – ont exacerbé les tensions au sein même de la coalition[20]. L’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu a habilement capitalisé sur ces fractures pour galvaniser l’opposition, accentuant l’instabilité gouvernementale.
Naftali Bennett et Yair Lapid, bien que déterminés à préserver la coalition, ont dû naviguer dans un climat politique marqué par une polarisation accrue et une défiance grandissante de l’opinion publique[21].
Contexte sécuritaire : Pressions externes et menaces internes
La période a été également marquée par une intensification des menaces sécuritaires. Sur le plan externe, Israël est resté confronté à l’activisme du Hamas dans la bande de Gaza et du Jihad islamique palestinien, tandis que l’Iran continuait de représenter une menace existentielle, notamment par le développement de ses capacités nucléaires⁵.
Le gouvernement a dû adapter sa posture sécuritaire en jonglant entre des opérations militaires ponctuelles et la recherche d’une stabilité régionale fragile. La sécurité intérieure, de son côté, a été fragilisée par une hausse des violences intercommunautaires, nécessitant un redéploiement des ressources de sécurité nationale³..
Mutations des appareils sécuritaires : Adaptation et controverse
L’extension de la surveillance électronique pour anticiper les risques d’attaques,
La réorganisation des unités de réponse rapide face aux menaces hybrides³.
Néanmoins, ces évolutions ont soulevé des critiques éthiques et juridiques : des ONG locales et internationales ont dénoncé certaines méthodes de surveillance et de gestion des foules, les jugeant incompatibles avec les normes internationales de protection des droits humains⁶.
Dilemme démocratique : Sécurité vs Principes
Le gouvernement s’est heurté à un dilemme stratégique majeur : protéger Israël contre une menace multiple sans éroder ses fondements démocratiques[22].
Les politiques de riposte, souvent perçues comme disproportionnées, ont nourri un débat public sur la nature même de l’État israélien : comment maintenir une démocratie libérale tout en menant une politique sécuritaire musclée face à des menaces complexes et évolutives[23] ?
Cet équilibre délicat entre efficacité sécuritaire et respect des libertés fondamentales a constitué l’un des principaux défis du mandat Bennett-Lapid.
Facteurs Internes Augmentant la Fragilité Politique de l’Appareil Sécuritaire Israélien
Durant la période du gouvernement Bennett-Lapid (2021-2022), plusieurs facteurs internes ont considérablement fragilisé la stabilité politique et, par ricochet, la solidité de l’appareil sécuritaire israélien.
Divisions politiques internes et instabilité gouvernementale
La coalition gouvernementale formée en juin 2021 rassemblait des partis aux idéologies radicalement divergentes, allant de formations d’extrême droite à des partis arabes modérés[24]. Cette diversité a rapidement engendré des tensions internes paralysantes, chaque parti défendant des priorités contradictoires sur des sujets fondamentaux tels que la réforme judiciaire, les politiques sociales et la sécurité nationale[25].
L’épisode des réformes judiciaires controversées a cristallisé ces divergences : perçues comme une menace pour l’indépendance judiciaire, elles ont provoqué des manifestations massives dans tout le pays et accentué la polarisation de l’opinion publique[26]. Naftali Bennett puis Yair Lapid ont tenté de maintenir la cohésion de la coalition, mais ils ont dû faire face à une opposition virulente de Benjamin Netanyahu, qui a instrumentalisé le mécontentement populaire pour fragiliser davantage le gouvernement[27].
Gestion sécuritaire fragmentée et pression extérieure
Le manque de consensus politique sur les questions sécuritaires a aussi affaibli la crédibilité d’Israël sur la scène internationale⁵. L’incapacité du gouvernement à adopter une ligne unifiée sur la gestion des tensions en Cisjordanie, notamment face aux confrontations entre colons israéliens et Palestiniens, a alimenté un climat d’instabilité intérieure croissante.
Par ailleurs, les mesures sécuritaires drastiques prises pour contenir les violences – telles que les démolitions de structures palestiniennes ou les limitations de circulation – ont exacerbé les tensions communautaires et déclenché de vives critiques internationales, remettant en cause la légitimité de certaines actions aux yeux des partenaires d’Israël[28].
Influence croissante de l’extrême droite et radicalisation politique
La montée en puissance de l’extrême droite israélienne, prônant une approche plus dure envers la population palestinienne et rejetant toute solution à deux États, a radicalisé davantage la scène politique.
Des députés issus de partis ultranationalistes ont intégré la coalition en imposant un agenda marqué par la promotion d’une politique de colonisation accrue et le refus de concessions diplomatiques, accentuant les fractures internes et isolant Israël sur la scène diplomatique.
Cette dynamique a nourri une polarisation extrême du débat public israélien, limitant la marge de manœuvre de l’exécutif pour mener des réformes de fond, tant sur le plan sécuritaire que social.
Conséquences sur la doctrine sécuritaire
La convergence de ces facteurs a non seulement fragilisé la gouvernance politique, mais aussi affecté la capacité opérationnelle des institutions sécuritaires.
Sous la pression constante, les forces de sécurité israéliennes ont été contraintes d’adapter en urgence leurs doctrines d’intervention, privilégiant souvent des logiques répressives au détriment des équilibres démocratiques traditionnels[29].
Les stratégies de riposte ont ainsi soulevé des questions éthiques et juridiques majeures, notamment concernant le recours accru aux technologies de surveillance de masse et la gestion musclée des manifestations, souvent jugées incompatibles avec les standards internationaux en matière de droits humains[30].
En résumé, l’addition de divisions internes, de radicalisation politique et d’une gestion sécuritaire contestée a contribué à un affaiblissement structurel de l’appareil étatique et sécuritaire israélien, exposant l’État à une double vulnérabilité : politique et stratégique.
Facteurs Externes Impactant la Stabilité Sécuritaire d’Israël sous le Gouvernement Bennett-Lapid
Durant le mandat du gouvernement Bennett-Lapid, la stabilité sécuritaire d’Israël a été fortement influencée par des facteurs externes complexes et évolutifs. Ces éléments ont contribué à reconfigurer la posture sécuritaire israélienne dans un contexte régional et international incertain.
Transformations géopolitiques régionales
L’environnement géopolitique du Proche-Orient a connu des mutations significatives, notamment à travers la normalisation diplomatique entre Israël et certains pays du Golfe tels que les Émirats arabes unis, Bahreïn, et l’Arabie saoudite.
Si ces rapprochements, héritiers des Accords d’Abraham, ont offert à Israël de nouvelles opportunités économiques et stratégiques, ils n’ont pas pour autant consolidé une stabilité durable. La question palestinienne, laissée en suspens dans ces accords, continue de conditionner la profondeur des relations diplomatiques[31]. Le manque de progrès sur ce dossier alimente des incertitudes stratégiques et maintient un climat de tension latent entre Israël et plusieurs puissances arabes[32].
Montée en puissance des acteurs non étatiques
La menace posée par les groupes armés non étatiques, notamment le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, a été un facteur constant d’instabilité. L’acquisition par ces groupes de missiles de plus en plus sophistiqués a mis à rude épreuve les systèmes de défense israéliens, malgré l’efficacité relative du Dôme de fer.
L’attaque du 7 octobre 2023 a brutalement mis fin à un équilibre fragile, soulignant la capacité du Hamas à mener des opérations complexes, malgré les dispositifs de sécurité israéliens renforcés. Ce choc stratégique a forcé Israël à revoir ses doctrines de dissuasion et à redoubler de vigilance dans la surveillance de ses frontière³.
Influence régionale et actions de l’Iran
L’Iran est resté un acteur omniprésent dans l’équation sécuritaire israélienne. Outre son soutien militaire et financier au Hezbollah et au Hamas, Téhéran a étendu son influence en Syrie et en Irak, consolidant un arc de forces pro-iraniennes dans la région[33].
Cependant, l’Iran est confronté à des fragilités internes – économiques, sociales et politiques – qui limitent sa capacité de projection. La capacité d’Israël à perturber certaines opérations sensibles en Iran, grâce à des actions clandestines attribuées au Mossad, a renforcé la perception de vulnérabilité du régime iranien, tout en maintenant la pression sur ses ambitions régionales[34].
Frontières sous tensions constantes
Les zones frontalières d’Israël sont demeurées des théâtres de tension quasi permanente :
La bande de Gaza, marquée par des tirs de roquettes et des incursions militaires régulières,
La frontière libanaise, sous l’influence du Hezbollah, théâtre d’incidents fréquents,
Le plateau du Golan, où les forces israéliennes ont mené plusieurs frappes préventives contre des positions iraniennes ou pro-iraniennes en Syrie[35].
Ces tensions frontalières ont contraint Israël à maintenir une posture défensive élevée tout en multipliant les stratégies de neutralisation préventive.
Répercussions sur la stratégie sécuritaire nationale
Face à cet environnement externe instable, Israël a dû :
Diversifier ses alliances stratégiques, en renforçant ses partenariats militaires et technologiques avec les États-Unis et certains pays arabes,
Moderniser ses capacités de renseignement pour mieux anticiper les actions asymétriques,
Renforcer ses moyens de défense anti-missiles en prévoyant de nouveaux déploiements du système « Dôme de fer » et du « Dôme de David ».
Cependant, cette posture défensive renforcée s’est accompagnée d’une polarisation accrue avec ses voisins, contribuant à rendre l’espace régional encore plus explosif[36]. L’équilibre sécuritaire d’Israël sous le gouvernement Bennett-Lapid a donc été un exercice d’équilibriste, entre opportunités de normalisation et gestion permanente des menaces asymétriques.
Influence des Tractations Politiques sur la Perception de Sécurité
Sous le gouvernement Bennett-Lapid, les tractations politiques internes et externes ont profondément influencé la perception de la sécurité en Israël. Sur le plan extérieur, les Accords d’Abraham ont constitué une avancée diplomatique majeure en établissant des relations officielles entre Israël et plusieurs pays arabes tels que les Émirats arabes unis, Bahreïn et, de manière plus discrète, l’Arabie saoudite[37]. Ces rapprochements ont offert de nouvelles perspectives économiques et stratégiques, mais n’ont pas réglé les tensions historiques liées au conflit israélo-palestinien. L’absence de progrès significatifs dans le processus de paix a limité l’impact stabilisateur de ces accords, renforçant l’idée selon laquelle la normalisation diplomatique ne saurait se substituer à une résolution globale du conflit.
Au niveau national, le gouvernement Bennett-Lapid a expérimenté une approche dite de “rétrécissement du conflit”, visant à atténuer l’impact du conflit israélo-palestinien sans en résoudre les causes fondamentales. Cette stratégie pragmatique, basée sur des améliorations économiques et sociales en Cisjordanie et à Gaza, a été partiellement interrompue après l’intensification des violences et des tensions politiques internes. Les divergences au sein du gouvernement quant à la manière de gérer le terrorisme palestinien ont exposé des fractures idéologiques, compromettant la cohésion gouvernementale et affectant la perception générale de sécurité nationale[38].
Rôle Historique de la Doctrine de Sécurité Nationale Israélienne
Depuis sa création dans les années 1950, la doctrine de sécurité nationale israélienne repose sur un socle d’impératifs stratégiques destinés à assurer la survie de l’État face à un environnement régional perçu comme hostile. Inspirée par l’expérience tragique de la Shoah et les guerres successives avec ses voisins arabes, cette doctrine privilégie :
– Le maintien d’une force militaire supérieure,
– Le recours à des opérations préventives,
– La recherche constante d’un soutien diplomatique international,
– Et l’autonomie stratégique sur les plans militaire et politique.
Après la guerre des Six Jours de 1967, Israël a mis davantage l’accent sur la profondeur stratégique, en contrôlant certains territoires pour mieux se prémunir contre d’éventuelles attaques surprises. Toutefois, cette stratégie a aussi compliqué sa position diplomatique, notamment après la guerre du Kippour en 1973, où l’absence de flexibilité politique a été lourdement critiquée.
Depuis la fin de la guerre froide, Israël a adapté sa doctrine aux réalités d’un monde multipolaire, où de nouveaux acteurs régionaux et des menaces transnationales – telles que le terrorisme et la cyberguerre – imposent une révision permanente des stratégies traditionnelles. La coopération sécuritaire internationale, particulièrement avec les États-Unis, ainsi que l’intégration de dispositifs de cyberdéfense, illustrent cette adaptation continue.
Enjeux Géostratégiques Régionaux et Internationaux
Au niveau régional, Israël doit faire face à une multiplication des défis sécuritaires. Le conflit israélo-palestinien reste une source d’instabilité majeure : l’expansion des colonies en Cisjordanie, les démolitions de maisons palestiniennes à Jérusalem-Est et les tensions intercommunautaires alimentent une dynamique conflictuelle persistante[39]. Ces actions, bien qu’ayant pour objectif d’accroître la sécurité territoriale d’Israël, contribuent paradoxalement à accroître l’isolement diplomatique du pays.
Parallèlement, les Accords d’Abraham ont ouvert de nouvelles avenues économiques et sécuritaires, mais cette normalisation n’a pas éliminé la menace posée par des acteurs comme l’Iran, le Hezbollah et le Hamas[40]. L’Iran, notamment, par son programme nucléaire et son soutien logistique aux milices armées en Syrie, en Irak et au Liban, constitue une menace stratégique existentielle pour Israël, obligeant ce dernier à maintenir une posture de vigilance permanente.
À l’international, Israël doit composer avec la réorganisation du système mondial vers un équilibre multipolaire. L’émergence de puissances comme la Chine, l’Inde ou la Russie complexifie les alliances traditionnelles[41]. Israël, s’appuyant sur sa supériorité technologique en matière de cybersécurité, d’intelligence artificielle et de défense antimissile, cherche à maintenir sa pertinence stratégique tout en diversifiant ses partenaires économiques et militaires.
La politique étrangère d’Israël sous Bennett-Lapid a donc oscillé entre consolidation des alliances traditionnelles (notamment avec les États-Unis) et adaptation à un monde de plus en plus complexe, tout en faisant face à des défis sécuritaires internes croissants. Le maintien de la stabilité sécuritaire dépend aujourd’hui autant des capacités militaires que de la capacité diplomatique à naviguer dans ce nouvel environnement stratégique.
Evolutions et Mutations de l’Appareil Sécuritaire Israélien
Mutation des structures de renseignement et contre-espionnage et Réorganisation des services de défense et de renseignement
L’évolution du paradigme sécuritaire israélien, notamment sous le gouvernement Bennett-Lapid, repose en grande partie sur une profonde mutation des structures de renseignement et de contre-espionnage. Ces transformations sont dictées par la permanence du conflit israélo-palestinien et par l’émergence de nouvelles menaces dans un Moyen-Orient en recomposition rapide.
Parmi les évolutions les plus emblématiques figure la montée en puissance de l’Unité 8200, fleuron du renseignement électromagnétique israélien¹. Spécialisée à l’origine dans l’écoute téléphonique, l’interception de communications et le décryptage de codes, cette unité a su s’imposer comme un acteur central non seulement dans le dispositif sécuritaire israélien mais aussi dans l’économie numérique nationale. Elle est devenue un vivier de talents dans les domaines du cyberespionnage et de la cybersécurité, contribuant à la création de nombreuses entreprises technologiques spécialisées[42].
Sur le plan institutionnel, des discussions ont été engagées pour envisager la transformation de l’Unité 8200 en une véritable agence nationale de renseignement électromagnétique, dotée d’une autonomie renforcée[43]. Cette perspective traduit la volonté d’Israël de centraliser et d’optimiser ses ressources de renseignement afin de répondre plus efficacement aux défis de l’ère numérique, notamment à ceux posés par la cyberguerre.
Par ailleurs, l’implication d’anciens membres de l’Unité 8200 dans le développement de logiciels espions de haute technologie, comme Pegasus, a révélé l’aptitude israélienne à concevoir des outils d’influence et de surveillance sophistiqués[44]. Toutefois, cette dynamique soulève des controverses internationales, certains logiciels ayant été associés à des pratiques de surveillance politique ou de violations des droits humains[45]. Cette ambivalence met en lumière le dilemme éthique auquel Israël est confronté : entre innovation sécuritaire et respect des standards internationaux en matière de libertés fondamentales.
En parallèle, la posture défensive israélienne s’est renforcée face aux menaces persistantes du régime iranien et de ses alliés régionaux. Le Mossad, service de renseignement extérieur, a modernisé ses méthodes opérationnelles, en intensifiant ses opérations d’identification, de sabotage et d’élimination ciblée. Ses unités spécialisées, telles que Césarée et Kidon, ont joué un rôle crucial dans les assassinats ciblés de responsables stratégiques, illustrant la flexibilité et l’agressivité du modèle israélien d’action clandestine[46].
Ces transformations institutionnelles et opérationnelles soulignent la capacité d’adaptation du système sécuritaire israélien face à un environnement stratégique de plus en plus complexe. Toutefois, l’évaluation de leur efficacité doit prendre en compte plusieurs critères :
La contribution effective à la doctrine israélienne de sécurité nationale,
Le respect des limites légales et éthiques imposées par le droit international et par les attentes démocratiques internes,
La capacité d’intégration des mutations technologiques dans une stratégie de défense globale cohérente.
Enfin, les mutations actuelles posent des défis fondamentaux concernant l’équilibre entre sécurité nationale et protection des droits humains. Le recours croissant à des technologies intrusives et à des opérations clandestines doit être analysé à l’aune de leur impact potentiel sur la stabilité intérieure d’Israël et sur sa crédibilité sur la scène internationale.
Adaptations des forces de sécurité face aux menaces hybrides
L’adaptation des forces de sécurité israéliennes face aux menaces hybrides constitue un volet essentiel de l’évolution du paradigme sécuritaire israélien, particulièrement au cours de la période du gouvernement Bennett-Lapid. Les menaces hybrides, incarnées notamment par des acteurs tels que le Hezbollah et le Hamas, combinent des stratégies militaires classiques, des opérations clandestines et des campagnes de désinformation, rendant la réponse sécuritaire complexe et nécessitant des ajustements rapides[47].
Face à ces défis, Israël a engagé une profonde transformation de son dispositif sécuritaire en intégrant des technologies de rupture telles que l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive³. Ces outils permettent notamment d’améliorer la détection, la surveillance et la neutralisation préventive de cibles potentielles, en réduisant considérablement le délai entre l’identification de la menace et la riposte opérationnelle.
Un exemple majeur de cette adaptation est la création de la Multi-Domain Strike Division au sein de l’armée israélienne (IDF). Cette nouvelle division vise à coordonner les capacités aériennes, terrestres, navales, cybernétiques et spatiales pour répondre de manière synchronisée aux attaques hybrides³. Cette réforme s’inscrit dans le cadre du plan stratégique “Momentum”, qui ambitionne de transformer structurellement l’armée israélienne pour l’adapter aux réalités des conflits contemporains, en particulier face aux défis posés par des acteurs comme le Hezbollah et le Hamas[48].
Le renseignement joue également un rôle clé dans cette lutte contre les menaces hybrides. Des structures telles que l’Unité 8200 et le Mossad ont renforcé leurs capacités d’interception électromagnétique, de cyberespionnage et d’analyse comportementale[49]. L’essor de logiciels de surveillance sophistiqués, développés par d’anciens membres de l’Unité 8200, illustre la sophistication croissante des outils mis à la disposition du renseignement israélien¹. Cependant, l’utilisation de ces outils a suscité des controverses internationales, soulevant des interrogations sur les risques d’atteintes aux droits fondamentaux[50].
Dans ce contexte, Israël est confronté à un double impératif doctrinal :
Maintenir une posture défensive robuste et agile face à l’extension des menaces hybrides,
Et respecter les normes juridiques internationales ainsi que les principes éthiques relatifs aux droits humains².
Cette tension permanente entre sécurité et légalité est accentuée par la pression internationale et par la vigilance accrue des ONG de défense des libertés publiques. Elle impose aux autorités israéliennes de trouver un équilibre subtil entre efficacité opérationnelle et légitimité internationale.
En définitive, l’adaptation des forces de sécurité israéliennes aux menaces hybrides ne se limite pas à une évolution technologique ou doctrinale ; elle engage une réflexion stratégique de long terme sur la place d’Israël dans un environnement géopolitique instable. Cette transformation nécessite également une coopération renforcée avec les partenaires internationaux pour anticiper, contrer et limiter l’impact de ces menaces hybrides[51].
Sous le gouvernement Bennett-Lapid, la réorganisation des services de défense et de renseignement israéliens s’est imposée comme une nécessité stratégique face à la montée des menaces hybrides, portées notamment par des acteurs tels que le Hezbollah et le Hamas[52]. Ces menaces, combinant opérations militaires conventionnelles, cyberattaques, désinformation et infiltration sociale, ont remis en cause les doctrines sécuritaires traditionnelles. Israël a ainsi entamé une refonte profonde de ses structures sécuritaires, visant à améliorer la réactivité, la coordination interservices et la polyvalence opérationnelle. L’accent a été mis sur la centralisation du renseignement, avec des efforts de synchronisation entre l’IDF, le Mossad, le Shabak, et l’Unité 8200, renforçant ainsi la capacité d’anticipation et d’intervention rapide sur plusieurs théâtres simultanés[53]. Cette évolution structurelle a également été accompagnée d’une réforme des circuits décisionnels, afin de réduire les délais de réaction face aux signaux faibles et aux menaces latentes[54].
Parallèlement aux ajustements organisationnels, Israël a développé une révision doctrinale profonde. L’approche classique axée sur la domination militaire a été enrichie de concepts hybrides : dissuasion cognitive, actions clandestines non revendiquées, cyber-guerre offensive, et guerre de l’information. Des outils issus des nouvelles technologies, tels que l’intelligence artificielle prédictive, la surveillance massive par algorithmes et l’analyse comportementale avancée, sont désormais intégrés aux pratiques des services de renseignement. L’Unité 8200, acteur central dans cette dynamique, a vu ses compétences évoluer pour passer d’une fonction classique d’interception à une fonction d’anticipation cybernétique proactive contre les réseaux hostiles. En même temps, l’armée israélienne a lancé, via le plan “Momentum”, la création de nouvelles unités multidomaines (terre, mer, air, cyber) capables de déployer des ripostes synchronisées contre des menaces asymétriques.
Cependant, cette transformation accélérée s’accompagne de limites et défis éthiques majeurs. Les tensions interinstitutionnelles entre le Mossad, le Shabak et l’IDF, malgré les mécanismes de coordination mis en place, persistent et freinent parfois l’efficacité de la réponse sécuritaire[55]. De plus, le recours massif aux technologies de surveillance intrusive et aux logiciels espions, dont certains issus des anciens cadres de l’Unité 8200, soulève des critiques croissantes quant au respect du droit international humanitaire et des droits fondamentaux[56]. L’usage de procédés de guerre de l’ombre, s’il accroît l’efficacité tactique, expose Israël à des risques de délégitimation diplomatique. Ainsi, la réorganisation des services de défense et de renseignement israéliens apparaît aujourd’hui comme un double défi : assurer une efficacité opérationnelle maximale contre les menaces hybrides tout en garantissant une conformité éthique et juridique indispensable à la préservation de sa crédibilité internationale.
Contexte et Enjeux de la Réorganisation
Historiquement, Israël a structuré son appareil sécuritaire autour de trois grandes agences spécialisées : le Mossad pour les opérations de renseignement extérieur, le Shin Bet pour la sécurité intérieure, et Aman pour le renseignement militaire[57]. Si cette spécialisation fonctionnelle a permis de développer une expertise sectorielle remarquable, elle a également engendré une fragmentation des informations et une coordination imparfaite entre les services. Cette faiblesse structurelle a été cruellement exposée lors des événements du 7 octobre 2023, où les attaques du Hamas ont pris de court l’ensemble de l’appareil sécuritaire israélien, révélant des lacunes majeures dans la synchronisation du renseignement[58]. La difficulté à anticiper et à répondre efficacement aux menaces hybrides a ainsi souligné l’urgence d’une révision organisationnelle profonde.
En réponse à cette vulnérabilité, Israël a entrepris de moderniser son système de renseignement en favorisant l’intégration interservices et en s’inspirant de modèles étrangers performants, tels que celui de la Direction du Renseignement Militaire (DRM) en France[59]. Cette réorganisation vise à instaurer une architecture collaborative entre le Mossad, le Shin Bet et Aman, dans laquelle les informations seraient croisées, partagées et exploitées de manière convergente. L’objectif est de pouvoir analyser plus rapidement les menaces complexes — notamment celles qui mêlent actions militaires, cyberattaques et campagnes d’influence — et d’y répondre par des opérations coordonnées et adaptatives. Ce tournant stratégique reflète la nécessité d’une vision intégrée du renseignement, capable de faire face à des adversaires comme le Hezbollah et le Hamas, dont les stratégies exploitent les zones grises entre guerre conventionnelle et subversion sociopolitique.
Nouvelles Technologies et Innovations
Dans le cadre de la réorganisation de ses services de défense, Israël a placé l’intégration des nouvelles technologies au cœur de sa stratégie d’adaptation face aux menaces hybrides. L’émergence de cybermenaces, de campagnes de désinformation et d’attaques asymétriques a imposé une modernisation accélérée de l’arsenal technologique national. L’utilisation croissante d’outils de renseignement avancés, notamment ceux basés sur l’intelligence artificielle appliquée à l’analyse prédictive, ainsi que le développement de logiciels espions sophistiqués issus de l’expertise de l’Unité 8200, ont considérablement renforcé la capacité d’Israël à identifier, surveiller et neutraliser des cibles stratégiques de manière préventive[60]. Ces outils permettent d’anticiper les mouvements adverses, de cartographier les réseaux ennemis, et d’intervenir avant que les menaces ne se concrétisent pleinement, dans un contexte où la rapidité d’action est devenue un facteur décisif.
Cependant, cette innovation technologique accélérée n’est pas exempte de défis éthiques et juridiques. La collecte massive de données sensibles, l’utilisation de techniques de surveillance intrusive et la conduite d’opérations de cyberespionnage soulèvent de sérieuses interrogations sur le respect des normes du droit international humanitaire et des principes relatifs aux droits de l’homme[61]. L’équilibre délicat entre la nécessité de protéger la sécurité nationale et l’obligation de respecter les libertés fondamentales demeure un enjeu central dans l’évolution de la doctrine sécuritaire israélienne. Le risque de détérioration de la légitimité internationale d’Israël augmente si les technologies utilisées à des fins sécuritaires sont perçues comme menaçant la vie privée ou enfreignant les droits fondamentaux, tant au niveau national qu’international. Ainsi, l’intégration des nouvelles technologies dans l’architecture de défense israélienne impose une réflexion permanente sur l’articulation entre innovation, efficacité opérationnelle et éthique stratégique.
Mesures Coercitives et Stratégies Préventives
Face à l’intensification des menaces hybrides et asymétriques, Israël a renforcé son approche de défense proactive en articulant de manière complémentaire mesures coercitives et opérations préventives. Cette stratégie repose sur l’idée de neutraliser les risques à leur source tout en imposant des coûts stratégiques dissuasifs à l’adversaire. Un exemple significatif de cette doctrine a été observé dans la réponse israélienne aux tirs de missiles du Hezbollah, où les forces israéliennes ont systématiquement ciblé les zones de lancement tout en déclenchant des feux de contrebatterie pour dissuader la répétition des attaques¹. Cette méthode vise non seulement à perturber les capacités opérationnelles immédiates de l’ennemi, mais aussi à envoyer un signal clair de dissuasion sans nécessairement franchir le seuil de l’escalade généralisée.
Au-delà des réponses tactiques ponctuelles, Israël développe une approche globale pour intégrer ces mesures dans un cadre stratégique cohérent. La combinaison d’actions directes et ciblées avec des stratégies de communication adaptées vise à conserver l’initiative opérationnelle tout en limitant les risques d’internationalisation du conflit. Cette posture défensive proactive reflète une volonté de préserver la stabilité régionale tout en assurant la sécurité nationale par des opérations calibrées, rapides et proportionnées. Toutefois, cette stratégie comporte aussi des défis : le maintien de cet équilibre entre riposte efficace et contenu de l’escalade reste délicat, en particulier face à des acteurs non étatiques flexibles comme le Hezbollah, qui utilisent des tactiques de guérilla et de dissimulation pour échapper aux représailles conventionnelles.
Évaluation et Respect de la Doctrine Nationale de Sécurité
L’efficacité de la réorganisation des services de défense et des mesures de sécurité israéliennes doit impérativement être évaluée à l’aune de la doctrine nationale de sécurité, qui impose un cadre d’action respectueux des normes juridiques internationales et des principes éthiques fondamentaux[62]. Il est crucial que les mesures adoptées n’entraînent pas de violations des droits humains ni d’atteintes à la légitimité diplomatique d’Israël sur la scène internationale[63]. Naviguant entre l’impératif de préserver la sécurité nationale et les pressions exercées par les partenaires internationaux, le gouvernement israélien est confronté à un équilibre délicat : renforcer la résilience sécuritaire sans tomber dans des excès pouvant nuire à son image mondiale. L’expérience récente, notamment les lacunes stratégiques révélées lors de l’attaque du 7 octobre 2023[64], souligne l’importance d’une gouvernance sécuritaire rigoureuse et transparente, capable de conjuguer efficacité opérationnelle et respect des engagements éthiques.
La réorganisation des services de renseignement et de défense constitue un processus continu, qui doit s’adapter en permanence aux mutations des menaces hybrides tout en maintenant un équilibre étroit entre protection de la sécurité nationale et respect des contraintes éthiques et juridiques⁴. L’importance d’une coopération internationale élargie et d’une stratégie globale et intégrée se révèle déterminante pour faire face aux défis complexes du nouvel environnement géopolitique. Renforcer la résilience nationale passe ainsi par l’innovation technologique, la modernisation doctrinale et l’intégration de mécanismes juridiques de contrôle, afin de concilier efficacité sécuritaire, respect du droit international, et crédibilité diplomatique sur le long terme[65]. À défaut, les stratégies sécuritaires, même techniquement efficaces, risqueraient de se heurter à des limites politiques et diplomatiques dommageables pour Israël.
Impact Institutionnel sur les Méthodes de Contrôle et de Coercition
Les transformations récentes de l’appareil sécuritaire israélien, particulièrement sous le gouvernement Bennett-Lapid, ont profondément modifié les méthodes de contrôle et de coercition employées par l’État. La volonté d’accroître l’efficacité face aux menaces hybrides, telles que celles posées par des groupes comme le Hamas et le Hezbollah, a conduit à une réorganisation majeure des services de renseignement et de défense[66]. Cette dynamique a favorisé une approche intégrée, visant à renforcer la coordination et la synergie entre les différentes agences sécuritaires, tout en augmentant leur capacité à identifier, surveiller et neutraliser les menaces émergentes.
Parallèlement, l’intégration de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle et les logiciels espions développés par d’anciens membres de l’Unité 8200, a considérablement amélioré les capacités de surveillance stratégique[67]. Toutefois, cette évolution technologique soulève des questions éthiques et juridiques cruciales concernant la protection des droits de l’homme et le respect du droit international[68]. Israël, en exportant ces technologies à d’autres États, influence également les bureaucraties étrangères en matière de surveillance et de contrôle social, contribuant parfois à la légitimation de pratiques coercitives visant à réprimer des mouvements sociaux ou politiques.
Sur le plan institutionnel, l’extension de ces stratégies coercitives dépasse le cadre purement sécuritaire pour influencer le système judiciaire et législatif. Certaines législations adoptées sous prétexte de renforcer la sécurité nationale peuvent conduire à une restriction des libertés civiles, compromettant ainsi l’équilibre fragile entre sécurité et droits fondamentaux. La coopération sécuritaire d’Israël avec des pays tels que le Guatemala, où des formations en surveillance et en techniques de contrôle coercitif ont été exportées, illustre cette diffusion des pratiques coercitives dans d’autres contextes institutionnels[69].
À un niveau plus global, l’utilisation du contrôle coercitif par les administrations publiques peut prendre des formes ouvertes (répressions policières, restrictions des manifestations) ou discrètes (surveillance de masse, intimidations politiques). Si ces méthodes peuvent être efficaces à court terme pour maintenir l’ordre public, elles entraînent souvent une érosion de la légitimité institutionnelle à long terme, en affaiblissant la confiance entre l’État et les citoyens. Cela est particulièrement visible dans la gestion des protestations sociales ou des groupes dissidents, où l’utilisation disproportionnée de la coercition suscite des critiques tant internes qu’internationales.
Enfin, le contexte des mutations sécuritaires sous le gouvernement Bennett-Lapid montre que de telles transformations créent des périodes de vulnérabilité politique et sociale, pouvant intensifier les fractures internes. Cela impose une réflexion critique approfondie non seulement sur la doctrine nationale de sécurité, mais aussi sur les conséquences institutionnelles des politiques coercitives. Maintenir une posture défensive robuste, tout en préservant la légitimité internationale et les principes fondamentaux de l’État de droit, demeure un défi central pour Israël dans son environnement stratégique actuel.
Analyse des politiques de sécurité internes versus externes
L’analyse des politiques de sécurité intérieure et extérieure sous le gouvernement Bennett-Lapid révèle une dynamique complexe, où les menaces extérieures, telles que celles posées par l’Iran et les factions palestiniennes, influencent profondément la gestion des tensions internes. Sur le plan domestique, Israël a dû faire face à l’augmentation des clivages communautaires entre Arabes israéliens et Juifs, ainsi qu’à des divisions croissantes entre milieux religieux et séculiers[70]. Cette fragmentation sociale, combinée à la faible majorité parlementaire de la coalition, a compliqué l’adoption de réformes structurelles, rendant la gouvernance instable et les politiques internes souvent incohérentes.
À l’échelle extérieure, Israël est confronté à des menaces stratégiques majeures, notamment l’avancement du programme nucléaire iranien et le soutien de Téhéran aux mouvements armés palestiniens. La réponse sécuritaire israélienne s’est appuyée sur une stratégie de dissuasion active, cherchant à neutraliser les capacités adverses sans provoquer d’escalade régionale immédiate[71]. Néanmoins, face à l’influence iranienne indirecte via les factions de Gaza, Israël envisage parfois des approches d’escalade contrôlée visant à modifier le statu quo local et régional[72]. Cette stratégie hybride entre containment et démonstration de force révèle la complexité de maintenir un équilibre sans basculer dans une confrontation généralisée.
En termes d’évaluation du travail des organes de la sécurité nationale, il est clair que leurs actions restent orientées vers la préservation de la sécurité immédiate, mais nécessitent une réévaluation continue pour garantir leur conformité à la doctrine de sécurité nationale israélienne, centrée sur la protection des citoyens et le respect des normes internationales. Le recours à des mesures coercitives, notamment par l’usage de technologies de surveillance avancées, soulève de sérieux défis éthiques et juridiques, particulièrement en matière de respect des libertés fondamentales[73]. Ces dérives potentielles mettent en évidence la nécessité d’un examen critique permanent des politiques sécuritaires, afin de préserver la légitimité institutionnelle aussi bien sur le plan national qu’international.
Dans ce contexte, le gouvernement Bennett-Lapid a également tenté d’installer une stabilité régionale fragile par le biais d’initiatives diplomatiques. Par exemple, Naftali Bennett a pris un rôle de médiateur durant la guerre russo-ukrainienne, soulignant l’importance des stratégies de neutralité et des relations bilatérales pour protéger les intérêts d’Israël[74]. Toutefois, ces efforts diplomatiques restent conditionnés par les rapports sensibles entretenus avec d’autres puissances régionales comme l’Iran, l’Arabie Saoudite et la Turquie. La gestion des menaces internes et externes nécessite donc une politique équilibrée, combinant sécurité proactive et prudence diplomatique, pour éviter une escalade incontrôlée dans la région.
Enfin, en lien avec l’impact institutionnel des méthodes de contrôle et de coercition analysées précédemment, il apparaît que le gouvernement Bennett-Lapid a dû naviguer entre priorités contradictoires : renforcer la résilience nationale tout en maintenant une stabilité politique intérieure fragile. Cette navigation délicate dans un environnement géopolitique instable souligne l’urgence d’une stratégie de sécurité globale, coordonnée et ancrée dans le respect des droits fondamentaux et du droit international, pour assurer à Israël sécurité durable et légitimité internationale.
Conséquences sur la formation et la doctrine militaire
Les transformations du paradigme sécuritaire israélien sous le gouvernement Bennett-Lapid ont eu des implications significatives sur la formation, la doctrine militaire et l’organisation de l’appareil sécuritaire. Dans un contexte de menaces internes et externes croissantes, ces mutations ont imposé une révision substantielle des stratégies d’engagement et des priorités doctrinales.
Historiquement, la doctrine militaire israélienne repose sur la dissuasion active et la supériorité qualitative afin de compenser la faible profondeur stratégique du territoire. Cette approche implique des missions offensives préemptives, visant à neutraliser les menaces avant leur matérialisation complète[75]. Toutefois, les divisions internes, exacerbées par les clivages communautaires entre religieux et séculiers, ont commencé à affecter l’équilibre sociologique de l’armée israélienne, avec une croissance visible des influences religieuses au sein de Tsahal[76]. Cette évolution soulève des enjeux institutionnels majeurs quant à la cohésion des forces armées et leur capacité à incarner un projet national unifié dans un contexte sociopolitique polarisé.
Sur le plan technologique, l’intégration des innovations issues de la Revolution in Military Affairs (RMA) a profondément transformé la doctrine israélienne[77]. L’armée israélienne investit massivement dans des capacités de précision, des systèmes de renseignement avancés et des plateformes d’attaque multi-domaines pour mieux répondre aux conflits asymétriques, notamment contre des groupes armés non étatiques opérant en milieu urbain (Gaza, Liban). Cette modernisation impose une reconfiguration des stratégies d’entraînement et des schémas tactiques, en privilégiant l’adaptabilité face à des menaces de type guérilla plutôt qu’une confrontation conventionnelle[78].
En parallèle, l’évolution des menaces, notamment la montée en puissance de groupes technologiquement sophistiqués, impose une révision constante des méthodes d’engagement. Tsahal a dû passer d’une approche fondée sur les grands déploiements conventionnels à des opérations de contre-insurrection et de gestion des guérillas urbaines⁴. Cette transition vers des formes de conflits plus fragmentés et imprévisibles demande non seulement une adaptation structurelle, mais aussi une reformulation doctrinale pour conserver l’avantage stratégique.
Enfin, la nécessité d’équilibrer impératifs sécuritaires et respect des normes internationales pèse lourdement sur la doctrine militaire israélienne. L’usage accru de technologies de surveillance, de cybercapacités et d’opérations ciblées soulève d’importants défis éthiques et juridiques. L’armée doit en permanence évaluer la conformité de ses actions au droit international humanitaire afin de maintenir sa légitimité institutionnelle et d’éviter l’érosion de son capital diplomatique international[79]. Cette tension entre efficacité sécuritaire et respect des droits humains constitue aujourd’hui un axe de réflexion incontournable pour l’évolution future de la doctrine militaire israélienne.
Conclusion :
La transformation du paradigme sécuritaire israélien sous le gouvernement Bennett-Lapid s’inscrit dans une période de recomposition politique, stratégique et institutionnelle d’une rare intensité. À travers les mutations observées — aussi bien dans l’organisation interne des services de sécurité que dans la posture régionale d’Israël — se dessine un processus d’adaptation accélérée à des menaces de plus en plus hybrides, complexes et déterritorialisées. La fragilité politique interne, accentuée par les divisions idéologiques et communautaires, a révélé combien le système israélien, pourtant fondé sur une tradition de résilience, pouvait se trouver déstabilisé lorsque l’unité stratégique et la confiance institutionnelle venaient à se fissurer.
Dans ce contexte, la singularité du régime israélien apparaît avec force : un État démocratique en apparence solide, mais traversé par des tensions identitaires profondes ; une armée technologiquement avancée mais confrontée à de nouveaux défis asymétriques ; une doctrine de sécurité historique, fondée sur la supériorité qualitative et l’anticipation, mais désormais contrainte de composer avec les contraintes du droit international, les attentes de ses alliés et l’évolution rapide du cadre géopolitique mondial.
Le système sécuritaire israélien, longtemps perçu comme un modèle d’efficacité pragmatique, se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. L’enjeu n’est plus seulement de préserver une supériorité militaire face à des menaces externes, mais aussi de refonder la cohésion sociale intérieure, de moderniser les doctrines d’engagement, et de restaurer une légitimité internationale parfois écornée par les excès de certaines pratiques de contrôle et de coercition.
Ainsi, la transformation en cours n’est pas une simple réforme technico-stratégique : elle révèle une dynamique beaucoup plus profonde, où le système israélien est contraint d’inventer de nouvelles équations de sécurité, alliant résilience nationale, innovation technologique, gouvernance éthique et diplomatie agile, pour rester un acteur central et crédible dans un Moyen-Orient en recomposition permanente.
Bibliographie :
Amicale Nationale des Transmissions Aéroportées. (2024, avril 2). Unité 8200 : La sentinelle furtive d’Israël. https://amicalenationaledestransmissionsaeroportees.fr/2024/04/02/unite-8200-la-sentinelle-furtive-disrael/
BESA Center for Strategic Studies. (2023). Israel and the Threat of Terror Armies. https://besacenter.org/israel-terror-armies-threat/
Byman, D. (2022). A High Price: The Triumphs and Failures of Israeli Counterterrorism. Oxford University Press.
CAREP Paris. (2023). Israël : un gouvernement d’extrême droite face à une opposition fragmentée. https://www.carep-paris.org/recherche/lendemain-delections-en-israel-un-gouvernement-dultra-droite-face-a-une-opposition-eparpillee/
Centre Canadien du Contrôle Coercitif. (n.d.). Impacts du contrôle coercitif. https://controlecoercitif.ca/fr/bibliotheque-de-contenus/impacts-du-controle-coercitif
Chronique de Palestine. (n.d.). Mode opératoire des assassinats menés par le Mossad. https://www.chroniquepalestine.com/mode-operatoire-assassinats-menes-par-mossad/
Coface. (2024). Fiche risques pays : Israël. https://www.coface.fr/actualites-economie-conseils/tableau-de-bord-des-risques-economiques/fiches-risques-pays/israel
Diploweb. (2024). Actualité géopolitique : Vers un monde multipolaire. https://www.diploweb.com/Actualite-des-livres-geopolitiques-720.html
ENM. (n.d.). Le contrôle de proportionnalité en droit. https://www.enm.justice.fr/api/getFile/sites/default/files/RJA24-le-controle-de-proportionnalite.pdf
Futuribles. (n.d.). Et si Israël bombardait l’Iran ? https://www.futuribles.com/et-si-israel-bombardait-liran/
FMES. (2024). La meilleure défense, c’est l’attaque : évolution de la stratégie israélienne sur son front nord depuis octobre 2023. https://fmes-france.org/la-meilleure-defense-cest-lattaque-evolution-de-la-strategie-israelienne-sur-son-front-nord-depuis-octobre-2023/
Gendarmerie Nationale Française. (n.d.). L’Union européenne face aux menaces hybrides. https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/onists/publications-scientifiques/les-publications-exterieures-pour-la-securite/l-union-europeenne-face-aux-menaces-hybrides
Gouvernement du Canada. (2024). Conseils de sécurité pour Israël, la Cisjordanie et Gaza. https://voyage.gc.ca/destinations/israel-la-cisjordanie-et-la-bande-de-gaza
Haaretz. (2023). Israel’s Political Crisis: Judiciary Reform and Its Discontents. https://www.haaretz.com
Human Rights Watch. (2024). Israel/Palestine: Human Rights Under Threat. https://www.hrw.org
Institut EGA. (n.d.). Les enjeux sécuritaires pour Israël – Actualité et perspectives. https://www.institut-ega.org/l/les-enjeux-securitaires-pour-israel-actualite-et-perspectives/
Interpeace. (2022). Les sceaux d’une gouvernance sécuritaire inclusive et participative. https://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2022/09/Les-sceaux-dune-gouvernance-securitaire-inclusive-et-participative.pdf
IRIS France. (2025). La menace hybride : enjeux sécuritaires pour l’Europe et Israël. https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2025/01/ProgEurope_2025_01_menace-hybride_Note.pdf
IRSEM. (2023). Étude stratégique sur l’évolution de la stratégie israélienne. https://www.archives.defense.gouv.fr/content/download/487494/7799293/file/Etude_Irsem_n46.pdf
La Croix. (2023, avril 12). Espionnage : découverte d’un nouveau logiciel venu d’Israël. https://www.la-croix.com/Monde/Espionnage-decouverte-dun-nouveau-logiciel-venu-dIsrael-2023-04-12-1201263081
Le Grand Continent. (2024, octobre 7). Le tournant stratégique du 7 octobre : Israël dans la nouvelle géopolitique du Levant. https://legrandcontinent.eu/fr/2024/10/07/le-tournant-strategique-du-7-octobre-israel-dans-la-nouvelle-geopolitique-du-levant/
Le Monde. (2024, octobre 6). En Israël, l’enquête impossible sur le fiasco sécuritaire. https://www.lemonde.fr/international/article/2024/10/06/en-israel-l-enquete-impossible-sur-le-fiasco-securitaire_6344892_3210.html
Middle East Eye. (2022). Israël : le gouvernement Bennett-Lapid face aux défis internes. https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/israel-netanyahou-bennett-lapid-droite-nouveau-gouvernement-opposition
Miller, A. (2021). The Abraham Accords: Normalization and its Discontents. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. (n.d.). Présentation d’Israël. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/presentation-d-israel/
Morin, J.-F. (2013). Politique étrangère et théorie. Université Laval. https://www.chaire-epi.ulaval.ca/sites/chaire-epi.ulaval.ca/files/publications/morin_jf_2013_politique_etrangere_theori.pdf
Nations Unies. (2024). Conseil de sécurité – Note de presse sur Israël et le Moyen-Orient. https://press.un.org/fr/2024/cs15958.doc.htm
Open Edition Journals. (n.d.). Terrorisme, dissuasion et doctrine sécuritaire en Israël. https://journals.openedition.org/conflits/1813
Policy Center for the New South. (2023). Israël : Équilibres politiques et sécurité nationale. https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2023-11/PB_43_23%20(Bassou)_0.pdf
RAND Corporation. (2020). Israeli Intelligence: Organizational Structures and Counter-Hybrid Operations. https://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP285.html
Revue Historique des Armées. (n.d.). Transformations doctrinales et cyberstratégie israélienne. https://journals.openedition.org/rha/1843
SSRN. (2024). Israël et les défis sécuritaires face à l’Iran. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4929147
The Times of Israel. (2022). Bennett, Lapid, and the Collapse of the Coalition Government. https://www.timesofisrael.com
Transnational Institute. (2023). Israel: The Model Coercive State. https://longreads.tni.org/stateofpower/israel-the-model-coercive-state
Université du Québec à Montréal (UQAM). (n.d.). Les enjeux juridiques de l’action militaire israélienne. https://archipel.uqam.ca/6990/1/M13381.pdf
U.S. Department of Defense. (2023). Annual Threat Assessment Report. https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2023.pdf
United Nations Office of Counter-Terrorism. (2023). Understanding Definitions of Terrorism. https://www.un.org/counterterrorism/understanding-definitions
UNDP. (2022). Election Guide: Israel – Analysis of Political Divisions. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/1938-electionguide-low.pdf
Vie Publique. (n.d.). Portrait institutionnel des mutations du renseignement israélien. https://www.vie-publique.fr/files/collection_number/portrait/photo/3000000000043.pdf
[1] Institut EGA. (n.d.). Les enjeux sécuritaires pour Israël – Actualité et perspectives. consulté en Avril 2025 https://www.institut-ega.org/l/les-enjeux-securitaires-pour-israel-actualite-et-perspectives/
[2] Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. (n.d.). Présentation d’Israël :
consulté en Avril 2025 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/presentation-d-israel/
[3] Nations Unies. (2024). Conseil de sécurité – Note de presse. https://press.un.org/fr/2024/cs15958.doc.htm
[4] International Crisis Group. (2022). The Israeli-Palestinian Conflict: Strategic Risks and Policy Responses. consulté en Avril 2025 https://www.crisisgroup.org
[5] United Nations Office of Counter-Terrorism. (2023). Understanding Definitions of Terrorism. consulté en Avril 2025 https://www.un.org/counterterrorism/understanding-definitions
[6] Byman, D. (2022). A High Price: The Triumphs and Failures of Israeli Counterterrorism. Oxford University Press.
[7] Katz, Y. (2021). Israel vs Iran: The Shadow War. The Jerusalem Post. consulté en Avril 2025 consulté en Avril 2025 https://www.jpost.com
[8] U.S. Department of Defense. (2023). Annual Threat Assessment Report :
consulté en Avril 2025 consulté en Avril 2025 https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2023.pdf
[9] Miller, A. (2021). The Abraham Accords: Normalization and its Discontents. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org
[10] Haaretz. (2023). Israel’s Political Crisis: Judiciary Reform and Its Discontents. consulté en Avril 2025 consulté en Avril 2025 https://www.haaretz.com
[11] Human Rights Watch. (2024). Israel/Palestine: Abuses at the Heart of the Conflict. consulté en Avril 2025 https://www.hrw.org
[12] Institut EGA. (n.d.). Les enjeux sécuritaires pour Israël – Actualité et perspectives. consulté en Avril 2025 https://www.institut-ega.org/l/les-enjeux-securitaires-pour-israel-actualite-et-perspectives/
[13] Le Monde. (2024, octobre 6). En Israël, l’enquête impossible sur le fiasco sécuritaire. consulté en Avril 2025 https://www.lemonde.fr/international/article/2024/10/06/en-israel-l-enquete-impossible-sur-le-fiasco-securitaire_6344892_3210.html
[14] Open Edition Journals. (n.d.). Terrorisme, dissuasion et doctrine sécuritaire en Israël :
https://journals.openedition.org/conflits/1813
[15] Futuribles. (n.d.). Et si Israël bombardait l’Iran ? : consulté en Avril 2025 https://www.futuribles.com/et-si-israel-bombardait-liran/
[16] UNITAR. (2024). Rapport sur l’instabilité politique en Israël. :
https://unitar.org/sites/default/files/media/file/French%20Full%20Report.pdf
[17] Université du Québec à Montréal (UQAM). (n.d.). Les enjeux juridiques de l’action militaire israélienne. https://archipel.uqam.ca/6990/1/M13381.pdf
[18] Interpeace. (2022). Les sceaux d’une gouvernance sécuritaire inclusive et participative : consulté en Avril 2025 https://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2022/09/Les-sceaux-dune-gouvernance-securitaire-inclusive-et-participative.pdf
[19] Middle East Eye. (2022). Israël : le gouvernement Bennett-Lapid face aux défis internes. :
consulté en Avril 2025 https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/israel-netanyahou-bennett-lapid-droite-nouveau-gouvernement-opposition
[20] Institut EGA. (n.d.). Les enjeux sécuritaires pour Israël – Actualité et perspectives. consulté en Avril 2025 https://www.institut-ega.org/l/les-enjeux-securitaires-pour-israel-actualite-et-perspectives/
[21] The Times of Israel. (2022). Bennett, Lapid, and the Collapse of the Coalition Government:
consulté en Avril 2025 https://www.timesofisrael.com
[22] Nations Unies. (2024). Conseil de sécurité – Note de presse sur les tensions au Moyen-Orient. https://press.un.org/fr/2024/cs15958.doc.htm
[23] Human Rights Watch. (2023). Israel/Palestine: Abuses at the Heart of the Conflict. consulté en Avril 2025 https://www.hrw.org
[24] Coface. (2024). Fiche risques pays : Israël. consulté en Avril 2025 https://www.coface.fr/actualites-economie-conseils/tableau-de-bord-des-risques-economiques/fiches-risques-pays/israel
[25] UNDP. (2022). Election Guide: Israel – Analysis of Political Divisions:
consulté en Avril 2025 https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/1938-electionguide-low.pdf
[26] CAREP Paris. (2023). Israël : un gouvernement d’extrême droite face à une opposition fragmentée. consulté en Avril 2025 https://www.carep-paris.org/recherche/lendemain-delections-en-israel-un-gouvernement-dultra-droite-face-a-une-opposition-eparpillee/
[27] OpenEdition. (n.d.). Les défis institutionnels d’Israël contemporains. :
https://books.openedition.org/pum/6384?lang=en
[28] Policy Center for the New South. (2023). Israël : Équilibres politiques et sécurité nationale. consulté en Avril 2025 https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2023-11/PB_43_23%20(Bassou)_0.pdf
[29] OpenEdition. (n.d.). Les défis institutionnels d’Israël contemporains :
https://books.openedition.org/pum/6384?lang=en
[30] Human Rights Watch. (2024). Israel/Palestine: Human Rights Under Threat. consulté en Avril 2025 https://www.hrw.org
[31] Coface. (2024). Fiche risques pays : Israël. consulté en Avril 2025 https://www.coface.fr/actualites-economie-conseils/tableau-de-bord-des-risques-economiques/fiches-risques-pays/israel
[32] Nations Unies. (2023). Avancées et défis dans le processus de paix israélo-palestinien. consulté en Avril 2025 https://www.un.org/osaa/sites/www.un.org.osaa/files/un_advocacy_brief_en_final_justified_fr_web.pdf
[33] Gouvernement du Canada. (2024). Conseils de sécurité pour Israël, la Cisjordanie et Gaza. https://voyage.gc.ca/destinations/israel-la-cisjordanie-et-la-bande-de-gaza
[34] Le Grand Continent. (2024, octobre 7). Le tournant stratégique du 7 octobre : Israël dans la nouvelle géopolitique du Levant. https://legrandcontinent.eu/fr/2024/10/07/le-tournant-strategique-du-7-octobre-israel-dans-la-nouvelle-geopolitique-du-levant/
[35] Gouvernement du Canada. (2024). Conseils de sécurité pour Israël, la Cisjordanie et Gaza. https://voyage.gc.ca/destinations/israel-la-cisjordanie-et-la-bande-de-gaza
[36] Coface. (2024). Fiche risques pays : Israël. consulté en Avril 2025 https://www.coface.fr/actualites-economie-conseils/tableau-de-bord-des-risques-economiques/fiches-risques-pays/israel
[37] Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. (n.d.). Présentation d’Israël :
consulté en Avril 2025 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/presentation-d-israel/
[38] Institut EGA. (n.d.). Les enjeux sécuritaires pour Israël – Actualité et perspectives. consulté en Avril 2025 https://www.institut-ega.org/l/les-enjeux-securitaires-pour-israel-actualite-et-perspectives/
[39] Interpeace. (2022). Les sceaux d’une gouvernance sécuritaire inclusive et participative. consulté en Avril 2025 https://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2022/09/Les-sceaux-dune-gouvernance-securitaire-inclusive-et-participative.pdf
[40] Nations Unies. (2024). Conseil de sécurité – Note de presse sur Israël et le Moyen-Orient :
https://press.un.org/fr/2024/cs15958.doc.htm
[41] Diploweb. (2024). Actualité géopolitique : Vers un monde multipolaire. consulté en Avril 2025 https://www.diploweb.com/Actualite-des-livres-geopolitiques-720.html
[42] Amicale Nationale des Transmissions Aéroportées. (2024, avril 2). Unité 8200 : La sentinelle furtive d’Israël. https://amicalenationaledestransmissionsaeroportees.fr/2024/04/02/unite-8200-la-sentinelle-furtive-disrael/
[43] Vie Publique. (n.d.). Portrait institutionnel des mutations du renseignement israélien. consulté en Avril 2025 https://www.vie-publique.fr/files/collection_number/portrait/photo/3000000000043.pdf
[44] Revue Historique des Armées. (n.d.). Transformations doctrinales et cyberstratégie israélienne. https://journals.openedition.org/rha/1843?lang=en
[45] La Croix. (2023, avril 12). Espionnage : découverte d’un nouveau logiciel venu d’Israël. consulté en Avril 2025 https://www.la-croix.com/Monde/Espionnage-decouverte-dun-nouveau-logiciel-venu-dIsrael-2023-04-12-1201263081
[46] Chronique de Palestine. (n.d.). Mode opératoire des assassinats menés par le Mossad. consulté en Avril 2025 https://www.chroniquepalestine.com/mode-operatoire-assassinats-menes-par-mossad/
[47] IRIS France. (2025). La menace hybride : enjeux sécuritaires pour l’Europe et Israël. consulté en Avril 2025 https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2025/01/ProgEurope_2025_01_menace-hybride_Note.pdf
[48] BESA Center for Strategic Studies. (n.d.). Israel and the Threat of Terror Armies. https://besacenter.org/israel-terror-armies-threat/
[49] Rand Corporation. (n.d.). Israeli Intelligence: Organizational Structures and Counter-Hybrid Operations. consulté en Avril 2025 https://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP285.html
[50] Gendarmerie Nationale Française. (n.d.). L’Union européenne face aux menaces hybrides. consulté en Avril 2025 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/onists/publications-scientifiques/les-publications-exterieures-pour-la-securite/l-union-europeenne-face-aux-menaces-hybrides
[51] University of Texas, El Paso (UTEP). (n.d.). An Analysis of Hezbollah’s Use of Irregular Warfare. consulté en Avril 2025 https://www.utep.edu/liberalarts/nssi/_files/docs/an-analysis-of-hezbollah-s-use-of-irregular-warfare-mulhern.pdf
[52] Interpeace. (2022). Les sceaux d’une gouvernance sécuritaire inclusive et participative. Genève : Interpeace. Disponible sur : consulté en Avril 2025 https://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2022/09/Les-sceaux-dune-gouvernance-securitaire-inclusive-et-participative.pdf
[53] Ministère de l’Éducation Nationale (France). (n.d.). Sécurité et gestion des risques. Paris : Devenir Enseignant. Disponible sur : consulté en Avril 2025 https://www.devenirenseignant.gouv.fr/media/14146/download
[54] RAND Corporation. (2020). Israeli Intelligence: Organizational Structures and Counter-Hybrid Operations. Santa Monica : RAND Corporation. Disponible sur : consulté en Avril 2025 https://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP285.html
[55] IRIS France. (2025). La menace hybride : enjeux sécuritaires pour l’Europe et Israël. Paris : Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Disponible sur : consulté en Avril 2025 https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2025/01/ProgEurope_2025_01_menace-hybride_Note.pdf
[56] BESA Center for Strategic Studies. (2023). Israel and the Threat of Terror Armies. Ramat Gan : BESA Center. Disponible sur : https://besacenter.org/israel-terror-armies-threat/
[57] Nations Unies. (2024). Conseil de sécurité – Note de presse sur Israël et le Moyen-Orient. https://press.un.org/fr/2024/cs15958.doc.htm
[58] Institut EGA. (n.d.). Les enjeux sécuritaires pour Israël – Actualité et perspectives. consulté en Avril 2025 https://www.institut-ega.org/l/les-enjeux-securitaires-pour-israel-actualite-et-perspectives/
[59] Interpeace. (2022). Les sceaux d’une gouvernance sécuritaire inclusive et participative. consulté en Avril 2025 https://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2022/09/Les-sceaux-dune-gouvernance-securitaire-inclusive-et-participative.pdf
[60] Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. (n.d.). Présentation d’Israël. consulté en Avril 2025 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/presentation-d-israel/
[61] Institut EGA. (n.d.). Les enjeux sécuritaires pour Israël – Actualité et perspectives. consulté en Avril 2025 https://www.institut-ega.org/l/les-enjeux-securitaires-pour-israel-actualite-et-perspectives/
[62] Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. (n.d.). Présentation d’Israël. https://fr.timesofisrael.com/abbas-envisagerait-de-remplacer-son-chef-des-services-de-renseignement/
[63] Vie publique. (n.d.). Portrait institutionnel des services de renseignement. consulté en Avril 2025 https://www.vie-publique.fr/files/collection_number/portrait/photo/3000000000043.pdf
[64] RAS-NSA Canada. (n.d.). Israël-Hamas : la surprise stratégique dans l’attaque du 7 octobre. https://ras-nsa.ca/fr/israel-hamas-la-surprise-strategique-dans-lattaque-du-7-octobre/
[65] FMES. (2024). La meilleure défense, c’est l’attaque : évolution de la stratégie israélienne sur son front nord depuis octobre 2023. https://fmes-france.org/la-meilleure-defense-cest-lattaque-evolution-de-la-strategie-israelienne-sur-son-front-nord-depuis-octobre-2023/
[66] Transnational Institute. (2023). Israel: The Model Coercive State. https://longreads.tni.org/stateofpower/israel-the-model-coercive-state
[67] Morin, J.-F. (2013). Politique étrangère et théorie. Chaire EPI, Université Laval. consulté en Avril 2025 https://www.chaire-epi.ulaval.ca/sites/chaire-epi.ulaval.ca/files/publications/morin_jf_2013_politique_etrangere_theori.pdf
[68] ENM. (n.d.). Le contrôle de proportionnalité en droit. consulté en Avril 2025 https://www.enm.justice.fr/api/getFile/sites/default/files/RJA24-le-controle-de-proportionnalite.pdf
[69] Centre Canadien du Contrôle Coercitif. (n.d.). Impacts du contrôle coercitif. https://controlecoercitif.ca/fr/bibliotheque-de-contenus/impacts-du-controle-coercitif
[70] Martens Centre for European Studies. (2023). Israeli Security and Political Challenges under the New Government. consulté en Avril 2025 https://www.martenscentre.eu/multimedia/israels-security-and-political-challenges-under-the-new-government/
[71] SSRN. (2024). Israël et les défis sécuritaires face à l’Iran. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4929147
[72] IRSEM. (2023). Étude stratégique sur l’évolution de la stratégie israélienne. consulté en Avril 2025 https://www.archives.defense.gouv.fr/content/download/487494/7799293/file/Etude_Irsem_n46.pdf
[73] Coface. (2024). Fiche risques-pays Israël : risques politiques et sécuritaires. consulté en Avril 2025 https://www.coface.fr/actualites-economie-conseils/tableau-de-bord-des-risques-economiques/fiches-risques-pays/israel
[74] Institut EGA. (n.d.). Les enjeux sécuritaires pour Israël – Actualité et perspectives. consulté en Avril 2025 https://www.institut-ega.org/l/les-enjeux-securitaires-pour-israel-actualite-et-perspectives/
[75] Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. (n.d.). Présentation d’Israël. consulté en Avril 2025 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/presentation-d-israel/
[77] CF2R. (2024). Le culte de l’offensive dans la doctrine militaire israélienne. https://cf2r.org/tribune/le-culte-de-loffensive-dans-la-doctrine-militaire-israelienne/
[78] Armée de Terre française. (2023). Doctrine d’emploi de Tsahal : entre rupture et continuité :
consulté en Avril 2025 https://www.terre.defense.gouv.fr/ccf/doctrine-demploi-tsahal-entre-rupture-continuite
[79] IFRI. (2023). Les mutations sécuritaires et stratégiques israéliennes :
consulté en Avril 2025 https://www.ifri.org/sites/default/files/migrated_files/documents/atoms/files/notes_10.pdf