Bouncing beyond the limits of horror: the semiotic transgression of the diegetic scenario in “DACHRA” by Abdelhamid Bouchnek
Rebondir au-delà des limites de l’horreur: la transgression sémiotique du scénario diégétique dans « DACHRA » de Abdelhamid Bouchnek
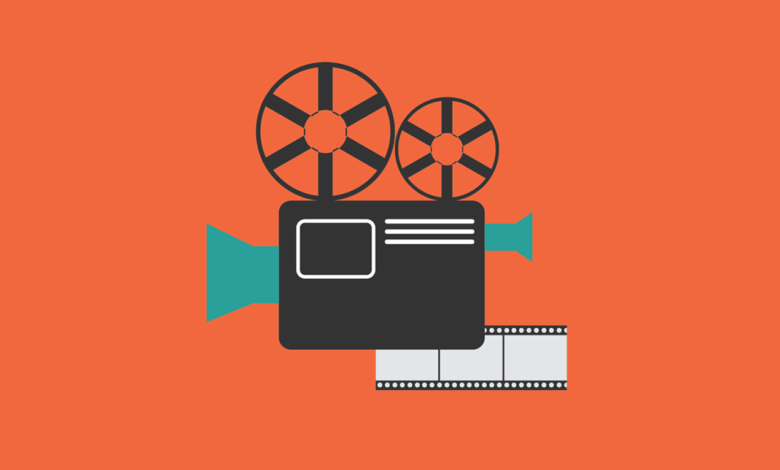
Prepared by the researche : Mejda Achour – University of Manouba, maître assistante contractuelle ESSTED Tunisia
Democratic Arabic Center
Journal of Social Sciences : Thirty-second Issue – June 2024
A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin
:To download the pdf version of the research papers, please visit the following link
Abstract
The horrific universe has been shaped in literature and cinema since the twentieth century. However, it has been theorised and delimited by well-defined laws. The various multidisciplinary creations attempt, each time, to transgress the theories of the literary and cinematographic genre, giving rise to innovative ramifications of upsetting sensations. Our study thus aims to identify the limits and conceptualisation of the horror genre in prolific cinema. Furthermore, our problematic revolves around the limits and boundary transgressions of horrific territory, assuming that horrific semiotic expressivity could unveil the extradiegetic unspoken transgressing genre and filmic scenario in Abdelhamid Bouchnek’s ‘Dachra’
Résumé
L’univers horrifique a été façonné dans la littérature puis dans le cinéma depuis le vingtième siècle. Cependant, il a été théorisé et délimité par des lois bien déterminées. Les créations diverses pluridisciplinaires tentent, à chaque fois, de transgresser les théories du genre littéraire et cinématographique, donnant naissance à des ramifications novatrices de sensations bouleversantes. Ainsi, notre étude vise à identifier les limites et la conceptualisation du genre horreur dans le cinéma prolifique. En outre, notre problématique s’articule autour des limites et des transgressions de limites du territoire horrifique, supposant que l’expressivité sémiotique horrifique pourrait dévoiler le non-dit extradiégétique transgressant le genre et le scénario filmique dans ‘Dachra’ de Abdelhamid Bouchnek
- L’oscillation entre fiction et réalité
La perception filmique de l’horreur inflige essentiellement les sentiments de la peur, de la frayeur et du dégoût, articulant une conceptualisation étudiée de divers artefacts cinématographiques. Notre sujet de recherche va se focaliser dans toutes sortes de limites et de transgressions des limites dans le cinéma d’horreur.
En effet, l’horreur est tout d’abord un genre cinématographique unique, délimité et bâti sur une identité spécifique reconnaissable à travers un langage cinématographique bien déterminé. En revanche, l’état émotionnel du récepteur plonge dans le registre de la peur, de la frayeur, du dégoût etc…Ceci dit, il y aurait des liaisons qui nouent chaque signe fictionnel à une réalité ancrée dans notre subconscient, ce qui donne cette impression de sensibilité réelle stimulée par divers concepts et techniques cinématographiques articulés dans l’élaboration du scénario, à travers l’incorporation de cette horreur dans la diégèse filmique façonnant, via l’image cinématographique, des espaces diégétiques horrifiques.
Ainsi notre problématique interroge les diverses limites de l’expressivité horrifique filmique dans l’élaboration du scénario diégétique. Cependant, quels sont les divers signes de l’identité horrifique visibles dans l’expressivité filmique.
Notre hypothèse suppose que la détermination du genre horrifique dans l’identité filmique pourrait exposer des problématiques diégétiques et extradiégétiques. Autrement dit, l’expressivité filmique spatiale et imagée, pourrait transgresser les limites de l’histoire fictionnel pour construire un discours cinématographique racontant « le non-dit », le réel et l’éthique humaine.
Ainsi, nous allons expliquer dans notre socle épistémologique, nos concepts clés, cherchant les lois qui déterminent les limites de l’horreur étant un genre spécifique dans le cinéma fictionnel. Puis nous allons analyser les messages intrinsèques et extrinsèques du film d’horreur « Dachra » de Abdelhamid Bouchnek. Enfin nous allons synthétiser que l’horreur ne serait pas seulement un effet filmique, mais un genre cinématographique montrant l’essence de la réflexion résultante des problématiques réelles de notre société actuelle.
Autrement dit, l’horreur oscille et se métamorphose entre la fiction et la réalité façonnant deux phases majeures qui s’intègrent dans un cercle vicieux, démarrant du créateur et allant vers le récepteur. Dans la première phase est une étape de conception filmique inspirée de la réalité et articulé avec l’imaginaire des créateurs. La seconde phase est la phase de la réception de l’horreur qui reste toujours subjective selon la nature spécifique, sociale spirituelle du spectateur. Le même signe fictionnel pourrait déclencher chez les spectateurs, en creusant et stimulant dans leur background personnel enregistré durant leur vécu réel, surgissant, pour chacun, des émotions différentes.
- Le cinéma d’horreur : loi, limite et transgression
Notre démarche scientifique démarre via la sémantique de l’horreur balayant les sciences sociales et les significations philosophiques, littéraires, psychologiques…pour aboutir aux problématiques cinématographiques du terme, afin de pouvoir, en premier lieu, bâtir notre socle épistémologique qui définira les lois et les limites de l’horreur.
En second lieu, nous allons appliquer ces limites et ces lois sur notre corpus, qui est le film de « Dachra » de « Abdelhamid Bouchnek », pour arriver à définir et à exploiter tous genres de limites de l’horreur dans ce film, à travers les divers signes de l’identité horrifique visibles.
En troisième lieu, en se basant sur nos résultats expérimentaux filmiques, nous allons articuler les significations sémiotiques pour la construction du scénario filmiques, puis le discours cinématographique diégétique et extradiégétique, nouant des liaisons directes et indirectes entre la fiction et la réalité. Ainsi dans cette dernière partie, nous pourrons affirmer ou infirmer notre hypothèse.
II.1 : La polysémie de l’horreur : délimitation du genre
L’étymologie de l’horreur provient du Latin ‘horror’, signifiant l’«Hérissement, frémissement qui fait dresser les cheveux et donne la chair de poule (…). Impression causée par la vue ou la pensée d’une chose affreuse. » (LeGrandRobert, 1976). En effet, c’est un sentiment, une sensation provenant de l’âme, causé par la perception d’un stimulus classé répulsif, provoquant le dégoût sensoriel accompagné ou non d’une sensation de la peur, de la terreur, de l’effroi, de l’effrayant, de la frisson…
En effet, selon Sartre, l’horrible est provocateur d’émotion lorsqu’il nous submerge, il nous envoute. « L’émotion n’est donc pas un comportement pur c’est le comportement d’un corps bouleversé, dont le bouleversement survit à la conduite. La conscience ne se contente donc pas de projeter une signification comme celle de l’horrible sur le monde qui l’entoure; elle vit ce monde, s’y précipite et s’y dégrade pour elle, l’horrible est une qualité substantielle de la chose. » (NOUDELMANN & PHILIPPE, 2004). Le corps puis le subconscient, subit un instant, refoule parfois, puis projette et se défoule via des comportements émotionnels, signes du bouleversement. Entre l’instant horreur sensoriel stimulateur et la réaction répulsive du corps, il y a un vécu de l’âme bouillonnante cherchant à assimiler le choc étrange.
En psychanalyse, Sigmund Freud s’est intéressé à un concept complexe contingent à l’horreur qui est « L’inquiétante étrangeté », par motif que la psychanalyse étudie des fibres particulières de la vie émotive, cernant que cette inquiétante étrangeté « (…) est apparenté à ceux d’effroi, de peur, d’angoisse, et il est certain que le terme n’est pas toujours employé dans un sens strictement déterminé, si bien que le plus souvent il coïncide avec ce qui provoque l’angoisse » (Freud, 1919). Certes, la naissance de l’effet de ce concept résulte de la sensibilité. Néanmoins, le degré de cette dernière est relative aux divers individus confrontés à ce genre de situation repoussante et pénible. « L’inquiétante étrangeté » est une sensation classé négative, ayant majoritairement comme origine une action ou/et un environnement non familier, inconnu, parfois dangereux ou donnant l’impression du danger, qui frisonne et provoque l’insécurité.
Néanmoins, l’étrangeté ou « L’inquiétante étrangeté » est un qualificatif de l’horreur mais pas l’essence du terme, cela veut dire que ce qualificatif pourrait provenir de l’horreur mais aussi du fantastique. Partant de l’horreur pur, qui est une source réelle, dégageant une inquiétante étrangeté, c’est parce que l’horreur pur provient du réel contenant un stimulus dérangeant, dégoûtant, effrayant, menaçant ou et dangereux, mais tout cela reste dans le contexte du réel inquiétant et étrange. En revanche, le fantastique, intrinsèquement hors norme et métaphysique, est, par définition, inquiétant et étrange, qui pourrait devenir une horreur en ajoutant le dégoût, l’effrayant, la menace, la peur… « Le fantastique noir est un environnement de refus de toutes contraintes et règles du surmoi. Il se caractérise par un univers terrifiant où dominent la noirceur et le lugubre, cet univers englobe tous les éléments qui symbolisent la mort. En effet, il stimule l’effet de la peur et de la frisson morbide. La mort demeure toujours inconnue pour l’être humain, c’est pour cela elle reste une partie mystérieuse importante du fantastique » (Achour, 2021). En associant le noir au fantastique[1], nous levons le voile sur les mystères du lugubre surnaturel virant petit à petit vers l’horreur lorsque les sensations et les tentions menaçantes de la peur persiste. En revanche le fantastique et l’horreur trouvent un territoire sémantique en commun lorsque les deux concepts s’entrecroisent. En effet, les thèmes de la mort, la morbidité et l’au-delà, formant l’univers de l’inconnu mystère, oscillant entre les sciences physiques et métaphysiques, sont majoritairement présents dans l’horreur et dans le fantastique.
Ainsi, l’horreur et le fantastique devinrent et demeurent, les deux territoires contingents et populaires de la littérature et du cinéma. Cependant, l’horreur et le fantastique ont été théorisés depuis la littérature prolifique et admis au cinéma comme deux genres cinématographiques distincts. Et selon les recherche de « Bueno » explorant le territoire inquiétant du fantastique, dans lequel se trouve « la contrée Horreur » qui dépasse même la limite du fantastique et construit au-delà de ce territoire irréel un nouvel univers réel hors de la zone du fantastique (BUENO, 2018). « Cette contrée se situe aux confins du territoire fantastique, dans la partie la plus sombre, et s’étend bien au-delà de ses frontières. On s’aperçoit alors que la métaphore géographique perd de sa vigueur puisque nous n’avons pas un territoire à l’intérieur d’un autre ni un territoire à côté d’un autre mais bien deux zones dont les limites s’entrecroisent » (BUENO, 2018). Cependant, Nous pouvons éclaircir plus cette théorie avec un schéma explicite dans lequel la couleur rouge va symboliser et délimiter l’horreur. En revanche la couleur jaune symbolisera et délimitera le territoire du fantastique.
Figure 1: Horreur ou Fantastique[2]
A travers les limites des deux genres qui s’entrecroisent nous pouvons synthétiser, en premier lieu, la délimitation de deux genres distincts dans lesquels il y a l’exposition des lois à l’intérieure des cadres correspondants. En second lieu, l’intersection des deux cadres phares, donne naissance à une surface orange symbolisant une zone d’entrecroisement entre l’horreur et le fantastique. En troisième lieu, la délimitation de cette zone orange construit dans cette bordure une autre sous-catégorie que nous allons expliciter plus bas.
Ainsi, ces entrecroisements, alliant l’horreur et le fantastique, fructifient les genres cinématographiques purs, en hybridant les concepts pour mener vers des territoires hybrides. Cependant, ses territoires se sont diversifiés en quatre zones :
- L’horreur pure : lorsque la peur et le dégoût surgissent des éléments ou des personnages naturels démunis de tout aspect surnaturel ou de déviation vers d’autres genres contingents.
- Le fantastique pur : lorsque les trois lois du fantastique s’appliquent en associant les thèmes du diable, possession, magie ou tous autres thèmes inhérents à l’extraordinaire, au surnaturel et à la métaphysique mais ne contenant pas le mode de la peur.
- L’horreur-fantastique ou le fantastique-horreur : c’est un mélange entre l’horreur et le fantastique où toutes les lois s’entrecroisent avec des degrés différents. Ainsi, le monde de la terreur s’installe dans l’univers surnaturel. C’est-à-dire la peur provient d’une source métaphysique.
- L’horreur d’origine inconnu : lorsque le film se situe directement sur la limite de l’entrecroisement avec une ambiance où règne la tension la terreur et la peur provenant d’une source d’origine inconnue. Nous parlons ici de l’origine de la source qui ne pourrait pas être identifiée. Le spectateur et/ou les personnages sont perplexes et sceptiques, hésitant s’il s’agit d’une menace naturelle expliquée par les sciences ou bien une menace surnaturelle, métaphysique inexpliquée.
Cependant, parlons des forces inconnues dans la citation suivante de Lovecraft: « Le vrai conte fantastique est autre chose qu’un meurtre caché, des os ensanglantés, (…). Il doit y avoir exprimée une atmosphère de terreur incontrôlable et inexplicable, engendrée par des forces extérieures et inconnues » (LOVECRAFT, 1969). Les sémantiques des mots, meurtre caché, os ensanglantés, terreur incontrôlable, donnent des indices scripturaux de l’univers horreur pur, car il existe une ambiance de peur, de tension ingérable. En revanche, il y a des forces extérieures inconnues et des phénomènes inexplicables signifiant que cette atmosphère provient d’un monde surnaturel. Ceci dit, si nous essayerons de catégoriser le genre du film d’après cette citation, ce n’est ni le genre fantastique, comme affirme LOVCRAFT, ni le genre horreur seulement, mais un univers où les deux genres se mélangent et s’hybride nécessitant une longue recherche pour savoir lequel des deux domine. Ainsi, nous pouvons affirmer que ce genre de film, s’inscrit dans la troisième catégorie indiquée plus haut, c’est-à-dire soit le fantastique-horreur ou bien l’horreur-fantastique. Autrement dit, l’horreur provient d’une origine bien déterminé hors norme et surnaturel. Donc, nous ne pourrons pas classer, ce genre de film, dans la quatrième catégorie où la source de l’horreur est inconnue.
Nous avons ainsi établi, dans notre socle épistémologique, la délimitation des genres Horreur et fantastique dans divers domaines et sciences, précisant leurs diverses lois et caractéristiques, formant deux genres cinématographiques distincts. En revanche, la littérature et le cinéma adoptent ces lois et la délimitation de ces deux genres, puis arrivent, grâce à la production prolifique, à transgresser ces limites, allant à chaque fois vers le territoire de l’autre genre contingent, afin de fusionner deux ambiances complémentaires. Cependant, ce fusionnement et cette hybridation furent nécessaires pour la conceptualisation de l’histoire et la diégèse, pour le but d’accomplir le suspense et l’innovation, et certainement pour d’autres finalités commerciales.
Cherchons ainsi, dans l’axe suivant, à travers notre corpus cinématographique déclaré commercialement comme un film d’horreur, les diverses limites intrinsèques et extrinsèques, et les transgressions de limites s’ils existent !
II.2 : L’expressivité de l’horreur dans « Dachra » de Abdelhamid Bouchnek
Nous procédons dans notre analyse par la décortication des signes perceptifs, donnant les significations de l’horreur via la première séquence du film, articulant la lumière, la température de couleur et les espaces diégétiques. Ensuite, nous allons analyser les plans et les mouvements spécifiques, mettant en relief les techniques cinématographiques, façonnant la symbiose de l’horreur et du fantastique dans l’élaboration du scénario diégétique[3].
Dès le début du film et dans la majorité des séquences, nous percevons une oscillation entre deux ambiances paradoxales. La première séquence nocturne, serait une entrée choquante pour la réception, qui est une méthode conceptuelle narrative accentuée par plusieurs artefacts cinématographiques. En premier lieu, nous nous trouvons dans un univers visuel lugubre, sombre, morbide, sous-exposées, alternant entre le cloisonnement et le décloisonnement, accompagné par une lenteur instable des mouvements de la caméra, montrant, en amorce, une silhouette d’un corps non identifié, dégagée par les floues des lumières lointaines, façonnées par des « bokehs » dansants sur la ligne d’horizon. Nous suivons ce corps inconnu en train de transgresser le vide aspatial intriguant camouflé par le voilement des ombres ténébreuses. La perception des lieux et des espaces noirs à travers des plans serrés, inflige aux spectateurs une ambivalence crispée accompagnée d’une tension narrative provoquée par cette lenteur allongée, à la fois silencieuse et rythmée par le bruitage des pas du personnage, puis par le frottement des armes tranchantes et le crépitement du feu. Dans ce plan séquence, il y a la coexistence d’une noirceur tenace et des lumières éblouissantes. Ce contraste accentue ce choc visuel émotif intensifiant le mode de la tension et de la peur. Jusqu’ ici l’ambiance de l’horreur domine, et les signes de la peur règnent tout l’univers. En l’occurrence, des voix soudaines présentent des indices des croyances surnaturelles expliquant le motif de cette scène de crime animale d’un petit enfant, jeté sur une énorme pierre, tué avec un gros couteau. Le choc visuel s’allonge balayant deux actions juxtaposées, l’une après l’autre, à l’aide d’une caméra portée. La première action montre les mains d’un personnage creusant la tombe de cette victime, tandis que dans la seconde action, deux secondes après, sur cette grosse pierre, figurent des mains tenant la tête du petit, bouche entrouverte montrant des dents de lait. En ouvrant l’œil du petit surgit une voix disant « voici la clé figurant dans son œil ».[4]
| Figure 2: La clé de la magie noire | Figure 3: Le Crime monstrueux |
Tout de suite après, la main égorge brutalement les veines de la petite victime via un va et vient de l’énorme couteau sur la chair de l’enfant, en silence avec froideur, accentuant la cruauté de l’acte avec la monstration de l’éjaculation abondante du sang accompagnée d’un suivi auditif du dernier souffle de l’âme en train de se débattre avec la mort. « (…) ces scénarios de pratiques assez sombres et effrayantes, nous poussent à trembler, au point de se sentir en train de vivre toute situation décrite, que nous trouvons si répugnante et écœurante. » (RIDENE, 2020). Un tel spectacle expressivement douloureux, conçu pour un public arabo-musulman, dévoile le tabou des pratiques diaboliques de la magie noire. L’acte du sacrifice, qui nous rappelle la fête du sacrifice de ‘l’Aïd al-Adha’, mène à d’autre connotation. Et si nous comparons les signes du sacrifice fictif aux référents réels religieux. Sacrifier un animal pour dieu est un acte religieux sacré symbole de l’iman, c’est-à-dire la foi de l’islam se référant au prophète Ibrahim qui a voulu sacrifier son fils pour dieu. Le miséricordieux a remplacé le cher fils humain par un animal…
Par l’horreur et la cruauté de cette fiction filmique, le réalisateur a montré explicitement le sacrifice du cher petit fils pour l’obtention du trésor selon les histoires légendaires. Cette analyse sémiotique et sémio-pragmatique[5] touche le plus profond du sacré chez le public arabo-musulman. Ainsi elle stimule et alerte les perceptions les moins sensibles dès le début de la diégèse.
| Figure 4: L’externalisation de l’âme | Figure 5: Cannibalisme |
Parallèlement, le concept du dégoût a été développé graduellement dans toutes les phases dramatiques de « Dachra », commençant par l’exposition esthétique du sang dans tous ses états, dans toutes ses formes et dans plusieurs séquences, comme celle de la douche ou dans la scène de la purification du cadavre. Mise à part que la mise en scène du sang, avec sa teinte rouge extrême assombrie parfois vers le noir, donne les significations du danger, de l’alerte, du crime, de la mort, virant vers le désespoir, le réalisateur y attribue d’autres interprétations lorsqu’il compose, de cet écoulement mouvementé, des morphologies et des corps. Cependant, le sang de cette victime a été externalisé sous forme d’un corps de monstre mouvant. Cette action précède le plan du corps de la vraie victime en train de se débattre avec les djinns voulant se nourrir avec son âme. Non seulement, cette mise en scène a exposé la mutilation du corps humain et la torture de l’âme, mais aussi elle a simulé la vivification du sang écoulé.
Le concept du dégoût a été mis en valeur avec l’exploitation du cannibalisme et l’exposition de la chair humaine dans tous ses états. En premier lieu, dans la mise en scène écœurante du diner de famille, nous voyons les personnages féroces de « Dachra » en train d’arracher la chaire élastique avec leur bouche et leurs mains, mettant en relief la cruauté de l’homme animal et son instinct féroce.
En second lieu, la chair humaine a été exposée autrement. A l’entrée du village, nous sentons et nous percevons partout, des tonnes de chair séchées et étalées comme des linges. La mise en exergue de la chair humaine continue dans d’autres séquences, montrant ses visqueuses formes exposées crues, à tort et à travers, mais bien composées dans des plans serrés, détaillant des cervelles ensanglantés ou des abats et des viandes diverses, bouillonnant dans des grosses marmites sur le feu dégageant des fumées brouillant toute la pièce écœurante de saletés. La température de couleur ambiante persiste dans la froideur dominée par une lumière verdâtre signe du dégoût, en gardant un fort contraste entre l’ombre et la lumière, entre le visible et l’invisible inconnu source du mystère. Tous ses signes audiovisuels présents à travers les diverses techniques cinématographiques, confirment la coexistence de l’univers de l’horreur et du fantastique ensembles dès le début du film, en articulant de plus en plus d’indices du surnaturel et des pratiques métaphysiques de la magie noire devenant la source unique de la terreur, de l’effroi et de la peur.
| Figure 6: Sorcellerie | Figure 7: Magie noire |
La sorcellerie et la magie noire présentent d’autres indices audiovisuels alternant entre les ustensiles et les panoplies du surnaturel, renforçant les contextes légendaires arabo-musulmanes et la mises en valeur des fragments corporels de la sorcière, tels que ses longs ongles sales, toujours en cachant les visages des serviteurs du monstre. Nous comprenons ainsi, pourquoi le réalisateur a dévoilé le véritable monstre à la fin de la dernière séquence du film. En effet, le réalisateur « (…) n’en mettra pas moins en lumière un point central de l’esthétique de la peur : la suggestion de la menace qui pèse sur le spectateur et non sa monstration » (LAFOND, 2007). Le jeu du voilement et du dévoilement s’articule à travers les artefacts cinématographiques diverses telle que la lumière. En revanche, ils existent d’autres moyens de jeu entre le visible et l’invisible suscitant l’inquiétude et la peur du spectateur, car la figuration de l’obscure centralise l’attention du récepteur. « Le hors‐champ, principale source d’ambiguïté et d’horreur, devient un espace à exploiter dans la veine fantastique, qui investit aussi l’ombre et l’obscurité. Ce qui est caché, suggéré suscite une beaucoup plus grande inquiétude chez les spectateurs. » (GADOMSKA, 2017). En outre, un second jeu entre le champ et le hors champ concentre l’attention du spectateur hors des limites du cadre à la recherche de l’inconnu, du mystère et de la vérité effrayante. Le réalisateur emploie d’autres techniques précises de l’image pour mettre en exergue, l’objet ou une partie de l’objet, en cachant et en floutant le second plan inscrit dans les limites du cadre. Autrement dit, à travers la technique de la profondeur de champ, en articulant les paramètres de la caméra, le cadreur pourrait flouter une zone bien particulière de l’image arrivant jusqu’à l’invisibilité totale des détails. En conséquent, une petite profondeur de champ façonne l’isolement net de la petite zone précise, tout en concentrant un flou intense aux alentours de la mise au point.
| Figure 8: Transgression 1 |
Transgresser les limites à travers les visages nous communique d’autres messages inhérents au discours cinématographique. Un gros plan cadre la tête du personnage éclairé avec une lumière en douche accentuant les cernes indices de la terreur. La tête est placée devant un rayon plein de livres dans une bibliothèque, dont la limite du cadre divise sa figure en deux parties et cache un œil dans l’hors champ. Cette mise en scène montre que ce personnage est proche du savoir mais détient seulement la moitié de la vérité. La monstration des bouquins à travers la grande profondeur de champ est un indice majeur dans l’articulation du discours cinématographique. L’œil second dans l’hors champ est l’outil perceptif du savoir, tant qu’il est caché, nous détenons seulement la moitié de la vérité.
En alignant deux plans d’une conversation champ/contre-champ où chaque personnage est pris à part, placé dans l’extrémité du cadre, nous allons percevoir la longue distance qui sépare les deux individus, voulant dire que la véritable communication est absente, donc il y a une discontinuité ou une rupture du dialogue.
| Figure 9: Rotation de la caméra 1 | Figure 10: Rotation de la caméra 2 |
A travers les deux figures précédentes, nous allons démontrer d’autres connotations des transgressions de limites via des rotations allongées effectuées par des mouvements de caméras spéciaux. La première figure est conçue par un angle de prise de vue complétement plongé, littéralement au-dessus du personnage, effectuant une rotation circulaire dépassant les trois cent degrés, avec un mouvement assez rapide. Les pieds du personnage circulent dans le sens indiqué par la flèche sur la figure ci-dessus. Son corps est en contact avec la terre fraiche pleine d’os humain. La perception de ce mouvement met en relief l’étourdissement et l’instabilité du personnage provoqués par le choc des évènements diégétiques précédents. Ces derniers dévoilent la vérité atroce de l’histoire et prédissent le future morbide du personnage. En parallèle, dans la figure suivante, l’étourdissement et le désarroi sont plus intenses, à travers un gros plan, un mouvement plus accéléré en faisant une double rotation circulaire coupée par divers flash-back constituant le rassemblement des dernières pièces du puzzle.
A travers nos analyses sémiotiques et en articulant les indices, nous avons pu dégager les signes formés par les artefacts cinématographiques de l’horreur et du fantastique. « (…) Des êtres inhumains par leur nature (diable, esprits, morts-vivants, signes géants, créatures hybrides en tout genre) ou par leur comportement (sorciers, savants fous) peuplent les espaces inquiétants (cryptes, cimetières, châteaux en ruines, demeures hantées, maisons isolées, constructions anciennes…) du fantastique et de l’horreur (…) » (Moine & Raphaelle, 2008). Nous allons ainsi assembler les résultats de nos analyses pour, en premier lieu, déterminer la catégorisation pointue du film Dachra de Abdelhamid Bouchnek dans l’axe synthétique suivant. En second lieu, nous allons affirmer ou infirmer notre hypothèse qui suppose que le dépassement des limites pourrait transgresser le scénario diégétique et raconter le non-dit et les faits réels de notre quotidien.
II.3 : L’horreur diégétique et extradiégétique : la transgression des limites du scénario fictionnel
Dans la conception de la diégèse canonique cinématographique fictive, suivant le cheminement d’une courbe dramatique standard, figure, premièrement, dès le début d’un film, la phase de l’exposition, où il y a la présentation des cadres spatio-temporels, les personnages de l’histoire, mettant en relief la stabilité dramatique de la diégèse. Ensuite, dès le début de la seconde phase du développement, surgit la perturbation du nœud principal qui va déterminer la quête de l’histoire.
En revanche, le réalisateur de ‘Dachra’ a camouflé les personnages et les lieux à l’aide de cette noirceur et d’autres techniques cinématographiques visant le suspense et la terreur. Cependant, la succession narrative standard a été bouleversé, en mettant le point sur la quête de l’histoire qui est de découvrir la vérité sur les diverses pratiques métaphysiques de la magie noire. En concision, nous avons expliqué une première transgression à travers le montage, qui a commencé avec une séquence perturbante au lieu de montrer la sérénité et le déroulement constant des faits de l’histoire. Ce genre de montage pourrait être spécifique à l’horreur et au surnaturel.
La seconde transgression est dégagée dès le début de notre analyse concernant la détermination du genre filmique. En effet, cette transgression extrinsèque globale est perçue lorsque la sémiotique a démontré que les signes audiovisuels ont dépassé les limites de l’horreur vers le territoire du fantastique.
Nous allons, ainsi, synthétiser les techniques phares employées, dégagées des analyses spécifiques dans l’axe précédant, mettant en valeur l’entrecroisement des concepts de l’horreur et du fantastique pour pouvoir établir une catégorisation pointue du genre filmique de « Dachra ». A travers un tableau explicite, nous procéderons alors par la conceptualisation de cette hybridation entre les deux genres en dégageant toutes sortes de transgressions intrinsèques à l’élaboration technique et conceptuelle du film.
| Genre | Fantastique + Horreur |
| Concepts et thèmes |
Peur Dégoût frayeur Instabilité Danger Alerte Crime Menace Magie noire Sorcellerie Sorcière Diable Monstre Démon Cannibalisme Mal/Bien Pouvoir/Impuissance Mort /Au-delà Innocence/Enfant |
| Approche | Exposition du choc Montage Monstration graduelle Illusion Simulation Suggestion
Perturbation Voilement/Dévoilement Visibilité/invisibilité Messages codés Implicite Ambiguïté |
| Techniques cinématographiques Image | Transgression des limites du cadre
Transgression de la spatio-temporalité Transgression de la diégèse fictive Profondeur de champ Champ contre champ Champ et hors champ Lumière : La sous-exposition Noirceur Lugubre Morbidité Froideur lourdeur, Température de couleur verdâtre grisâtre |
| Moyens décors | Exposition du Sang La fumé le feu
Le cadavre La Chair Humaine |
Tableau 1 Conceptualisation de l’horreur-fantastique
A travers ce tableau ci-dessus, nous avons présenté une conceptualisation de la fiction horreur-fantastique en présentant, en premier lieu, l’entrecroisement des concepts et des thèmes de l’horreur et du fantastique. Cet entrecroisement illustre la phase primaire avant la conceptualisation, qui est une phase passant, essentiellement, par l’idéation. C’est-à-dire, nous voulons, à travers cette décortication d’idées, comprendre comment le réalisateur/scénariste a puisé son idée primaire. Cet entrecroisement prouve que la source de l’horreur (peur, dégoût, frisson…), provient du fantastique métaphysique (Magie noire, sorcellerie, paranormal…). Ceci-dit, cette phase d‘idéation provient d’une source d’inspiration irréelle légendaire.
La seconde étape de la conceptualisation expose les approches monstratives de la réalisation figurant la manière de faire du réalisateur construisant l’empreinte du créateur. En troisième lieu, nous avons mis en relief, une synthèse issue de notre seconde partie analytique concernant les techniques cinématographiques visuelles de la spécialité image, employées pour la matérialisation des concepts et des approches du scénario diégétique et extradiégétique[6]. En dernier lieu nous avons décortiqué l’un des moyens cinématographiques, qui est le décor employé dans notre film « Dachra », illustrant spécifiquement le concept de l’horreur à travers le dégoût.
| Figure 11: Transgression du scénario 1 | |
| Figure 12 : Transgression du scénario 3 | Figure 13: Transgression du scénario 4 |
Nous allons expliquer, à travers les trois figures précédentes, l’approche du réalisateur dans la narratologie en montrant la différence entre la transgression diégétique et extradiégétique. Dans la figure 11, la réalisation joue via les messages codés et arrive à transgresser le scénario en choisissant un background blanc où figure, en premier lieu, trois ouvertures sombres verticales. Ces trois ouvertures représentent les trois amis étudiants. Près de la 3ème ouverture décalée vers la droite, il y a une affiche où figure l’œil du démon qui espionne les deux personnages en train de marcher sur l’allée. Cependant, le réalisateur informe le récepteur implicitement que le 3ème personnage est un traitre espion. Ainsi, ce message difficilement décodable, est une transgression du scénario diégétique car il démasque l’esprit diabolique de leur camarade avant l’heure diégétique.
En revanche, la figure 12 représente l’une des rares compositions centrées du film, montrant l’union des deux personnages clés de la diégèse. A travers cette composition spécifique, nous pouvons comprendre que toute l’histoire tourne autour de ces deux personnages. Ainsi, ces deux figures précédentes dévoilent des secrets de l’histoire avant la temporalité diégétique programmée du film. Cette anticipation codée est une transgression du scénario.
La dernière figure est aussi une transgression du scénario car elle cache des messages extradiégétiques à travers la composition de l’image et la grande profondeur de champ. En effet, cette scène dévoile des pratiques interdites transgressant la loi de l’institution publique tunisienne. Cette transgression des lois publiques, existe fréquemment dans la société tunisienne via la corruption.
| Figure 14: Pancarte début du film | Figure 15: Pancarte fin du film |
Revenons principalement à la source d’inspiration dans l’idéation du scénario. A travers ces deux pancartes, le réalisateur affirme l’origine de son inspiration : ‘Inspiré de faits réels’[7]. Ensuite, à la fin du film, il a déclaré que la sorcellerie a causé des centaines d’enfants morts en Afrique du nord. D’ailleurs, lors d’une interview disant : « Vous pouvez me demander si cette histoire est véridique ou pas ! Je garde le secret pour moi ? Ça pourrait exister »[8] (Bouchnek, 2018) .
Cependant, nous remettons en question la détermination du genre filmique de Dachra puisque le réalisateur affirme que les faits principaux de l’histoire diégétique sont inspirés de la réalité. Ceci dit, l’origine de la peur et de l’horreur pourrait être une pratique réelle existante dans la société. Ainsi nous pourrons catégoriser le film, d’après notre socle épistémologique, dans la limite entourant l’entrecroisement entre l’horreur et le fantastique puisque nous ignorons l’origine de l’horreur : Est-ce-que c’est une origine réelle ou une origine surnaturelle ?
Le réalisateur a bouleversé toute l’histoire en affichant ces deux pancartes, car non seulement il a remis en question la catégorisation filmique, mais encore il a bouleversé les repères du fantastique. En effet, la définition du fantastique est une invasion de l’irréel dans le réel. L’affirmation de ces deux pancartes introduit les pratiques de sorcellerie et de la magie noire dans l’univers du réel. Ce qui est illogique, complétement métaphysique et absurde. La question qui se pose. Le secret du réalisateur déclaré dans l’interview, serait-il un jeu participant dans la narratologie filmique ou pourrait-il exister réellement dans la société ?
En suivant la première supposition, nous pourrons dire que le réalisateur continue de jouer le jeu narratologique pour accentuer la perplexité du spectateur en dehors du film, après la réception. Donc, dans ce cas c’est une transgression extradiégétique.
En l’occurrence, si nous nous penchons vers la seconde hypothèse, nous allons soupçonner le réalisateur d’avoir des informations secrètes concernant ces pratiques diaboliques de la magie noire existantes dans la vie réelle.
- La subjectivité horrifique de la réception
La conception de l’horreur démarre d’un fait réel, d’un dégoût amer ou d’une peur dérangeante, signalant via des messages explicites inhérents aux constitutifs articulant le langage cinématographique en relation avec la diégèse du film fictionnel.
En revanche, ce même langage enveloppe et cache, via les artefacts filmiques, des messages codés implicites visant le non-dit et les problématiques de la réalité. Donc, dans cette première phase, qui est la conception de la diégèse filmique, l’horreur oscille entre la fiction et la réalité, étant à la fois la source d’inspiration, l’ambiance et le genre du film.
Néanmoins, dans la seconde phase concernant la réception, l’horreur devient un stimulus pour le spectateur rappelant, à travers le choc fictif, un réel désastre de la vie quotidienne. Ainsi, partant de la réalité fusionnante avec divers imaginaires, commence la conception de l’innovation des genres cinématographiques exposant les diverses limites intrinsèques et extrinsèques.
En effet, nous avons exposé dans notre première partie épistémologique les diverses limites de l’expressivité horrifique en générale, en mettant en relief les possibilités de transgression du genre vers le territoire fantastique. Ensuite, dans l’étude analytique de notre corpus présentant le film de ‘Dachra’ de Abdelhamid Bouchnek, nous avons répondu à notre problématique exposant toutes sortes de limites et de transgressions de limites de l’expressivité horrifique, inhérentes à la conception filmique. En outre, nous avons validé notre hypothèse affirmant que ses diverses transgressions a pu dépasser le diégèse fictionnel, démontrant que les problématiques exposées sont des réelles situations existantes dans la vie quotidienne blâmant la société tunisienne.
En revanche, la détermination précise du genre cinématographique reste toujours perplexe, conditionnée et indéfinissable, et cela revient à plusieurs facteurs. En premier lieu, les déclarations de Abdelhamid Bouchnek, dans les pancartes et dans l’interview, nous laisse penser que cette réalisation est une œuvre d’art fictive combinant les jeux émotifs des mensonges diaboliques. Certainement, cette déduction émane d’une catégorie de spectateur bien particulière doté d’un esprit canonique, scientifique, sceptique, creusant plus bas vers les métaphores qui illustrent les pratiques maléfiques des personnes méchantes vivant dans notre société. En second lieu, une seconde catégorie de spectateur superstitieux, plongera entièrement dans la peur du surnaturel, en doutant que ces sorcelleries diaboliques existent réellement dans la société.
En concision, ces deux catégories de spectateur aiment plonger dans cet univers hybridant l’horreur et le fantastique, cherchant un besoin complexe qui pourrait être un défoulement, une stimulation intense d’émotions, ou tout simplement un remède extraordinaire propulsant l’âme vers un monde inconnu. « Cette fascination de la laideur serait d’abord thérapeutique, puisqu’elle se présente comme un miroir des angoisses et des craintes de ses spectateurs qui peuvent ainsi « vivre leurs désirs profonds sans danger, ne risquant rien », puisque « la projection ne dépasse jamais les limites de l’écran. » » (Lamontagne, 2004). Avoir très peur sans risque est l’objectif essentiel du réalisateur de film d’horreurs. L’art de l’horreur fantastique est de nourrir les cœurs et les esprits avec l’angoisse et l’incertitude balayant entre la fiction et la réalité, déclarant le non-dit et blâmant implicitement la société réelle à travers un discours cinématographique éthique pour le bien-être de l’humanité.
Références bibliographiques
Achour, M. (2021). Le fantastique: de l’écrit à l’écran. Tunis: Thèse de doctorat Esac Université de Carthage.
Bouchnek, A. (2018, 11 06). JCC interview: Dachra. (T. JCC, Intervieweur) Récupéré sur https://www.youtube.com/watch?v=D1usbQSAmF0
BUENO, M. (2018, 02 06). AUX FRONTIERES DE L’HORREUR… . Rumal. evista e investigación obre o Fantástico, pp. 75–83. .
Chateau, D. (2006). Esthétique du cinéma. Paris: Armand Colin.
Freud, S. (1919). L’inquiétante étrangeté. Paris : Editions Gallimard 1933.
GADOMSKA, K. (2017). Les techniques anxiogènes dans le cinéma d’horreur et dans la littérature d’épouvante. Cahiers ERTA, (Vol. 11, 2017, s. 403-420).
LAFOND, F. (2007). Introduction In : Jacques Tourneur, les figures de la peur . Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Lamontagne, D. (2004). Compte rendu de L’art de faire peur. Des récits légendaires aux films d’horreur. Les Presses de l’Université Laval, 339-342.
LeGrandRobert. (1976). Le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Société du nouveau Littré.
LOVECRAFT, H. P. (1969). Épouvante et surnaturel en littérature. Paris: Christian Bourgeois Editeur.
Moine, & Raphaelle. (2008). Les genres du cinéma. Paris : Armand Colin.
NOUDELMANN, F., & PHILIPPE, G. (2004). DICTIONNAIRE SARTRE. Paris: HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR.
RIDENE, R. F. (2020, 06 01). Quand ‘Dachra’ oscille entre coin de magie noire et titre de film horteur : lecture esthétique et analytique. Revue algérienne AFAAK CINIMAIYA, pp. 537-557.
Sacré, S. (2013). Fantastique, merveilleux et fantasmatique dans Quand vient la nuit de Daniel Sernine : la perméabilité des genres. revue-analyses, vol. 8, nº 2, p204.
Todorov, T. (1970). Introduction dans la littérature du fantastique. Paris: Seuil.
[1] Les lois du fantastique sont déterminé depuis la littérature du 19ème siècle et empruntés pour bâtir le genre cinématographique du fantastique. « Hésitation entre le naturel et le surnaturel (selon Todorov [1970]) ou intrusion brutale et scandaleuse du phénomène surnaturel dans le monde réel (selon Vax [1965] et Caillois [1966]), (…). » (Sacré, 2013).
« Le fantastique, (…), manifeste un scandale, une déchirure, une irruption insolite, presque insupportable dans le monde réel. » (Todorov, 1970).
[2] Source : Conception de l’auteur
[3] Nous parlons de diégèse, non pas par opposition de mimésis, mais en rapport avec la fiction, c’est à dire l’histoire et le scénario : « Dans toutes ces définitions, la diégèse correspond au monde dans lequel se situent les évènements de l’histoire » (Chateau, 2006).
[4] Traduction par l’auteur de cet article. La version originale de la réplique est en dialecte Tunisien :
. « هوكة عندوا المفتاح في عينوا »
[5] Nous nous référons dans nos analyses sémiotiques à Greimas: « La sémiotique spécifique repose sur les théories sémiotiques visuelles articulant la sémiotique figurative et la sémiotique plastique. La sémiotique figurative s’applique sur les supports imagés représentant le monde, telles que les peintures, les photographies et les images filmiques. En second lieu, la sémiotique plastique s’intéresse à la constitution inhérente à l’image composée de ligne, de couleurs, de textures, de formes, de vide et de plein. » (Achour, 2021). Et à travers des analyses sémio-pragmatique de Roger Odin nous allons articuler les connotations avec la réception. « En effet, cette nouvelle approche combine l’étude des signes, qui est un langage de communication entre l’image et le récepteur, et l’ampleur interactive du spectateur. L’approche sémio-pragmatique est une science articulant le langage des signes iconiques et leurs impacts sur l’émotionnel du récepteur dans le cinéma fictionnel. C’est-à-dire, l’ambivalence et la sublimation perceptive sont en relation directe avec l’intensité dramatique fictionnelle figurée dans l’image cinématographique sous forme de signes et de symboliques. » (Achour, 2021).
[6] Nous allons montrer plus tard, à travers quelques exemples comment les idées diégétiques se transforment en idées extradiégétiques.
[7] Traduction par l’auteur de cet article.
[8] Traduction par l’auteur de cet article. La version originale de la réplique est en dialecte Tunisien :
.« تنجموا تقوللي لحكاية هذه بالحق ولا لا. انا مانيش باش نجاوبكم فالموضوع »




