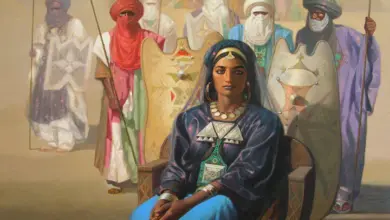Quel rôle des collectivités territoriales dans le financement des soins de santé au Maroc Etude juridique et comparative
What is the role of local authorities in financing healthcare in Morocco A legal and comparative study

Prepared by the researche
- Ennajar Omar – PHD in public law – Sidi Mohammed Ben Abdellah University
- Ariche Aouattef – PHD student in public law – Sidi Mohammed Ben Abdellah University
Democratic Arabic Center
Journal of Constitutional Law and Administrative Sciences : Twenty-seventh Issue – May 2025
A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin
:To download the pdf version of the research papers, please visit the following link
Résumé
Depuis son indépendance, le Maroc s’est engagé dans un long processus de décentralisation visant la démocratisation, la responsabilisation et la proximité dans la gestion des affaires locales. Grace à des réformes successives, le statut et les responsabilités des collectivités territoriales se sont considérablement renforcés. Toutefois, leurs compétences en matière de santé demeurent marginales. Dans le contexte actuel marqué par la priorisation des politiques de santé et la généralisation de la protection sociale, les collectivités territoriales doivent, à travers un financement adéquat, participer activement à ces efforts.
En analysant le cadre juridique et en invoquant certaines expériences étrangères, cet article a pour objet d’explorer les outils permettant aux collectivités territoriales de mieux contribuer à l’amélioration de l’offre de soins et à la mise en œuvre effective du droit à la santé.
Abstract
Since its independence, Morocco has engaged in a long process of decentralization aimed at democratization, accountability, and proximity in the management of local affairs. Thanks to successive reforms, the status and responsibilities of the territorial communities have been considerably strengthened, however, their health competences remain marginal. In the current context marked by the prioritization of health policies and the generalization of social protection, this communities must actively participate in these efforts through adequate funding.
By analysing the legal framework, and invoking certain foreign experiences, the purpose of this article is to explore the ways by which the territorial communities can better contribute to the improvement of healthcare provision and the effective implementation of the right to health.
Le droit à la santé est mondialement reconnu depuis la déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), et surtout le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de 1966. Si depuis, la portée de ce droit était très large, selon la constitution de l’OMS qui affirme que « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité », ce droit tend aujourd’hui à être synonyme seulement de droit d’accès aux soins de santé de qualité.
En effet l’optimisme affiché par les constituants de l’OMS en intégrant les déterminants sociaux comme le logement, l’éducation, le revenu dans la considération de bonne santé, est réaffirmé par le PIDESC en insistant sur ces déterminant sociaux. L’article 12 du pacte dispose que « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre », ce même article est bien interprété et complété par l’Observation générale n° 14 (2000) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en réaffirmant que ce droit est étroitement lié à d’autres droits de l’Homme et dépend de leur réalisation. Il s’agit des droits énoncés dans la Charte internationale des droits de l’Homme, à savoir les droits à l’alimentation, au logement, au travail, à l’éducation, à la dignité humaine, à la vie, à la non-discrimination et à l’égalité, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit au respect de la vie privée, le droit d’accès à l’information et les droits à la liberté d’association, de réunion et de mouvement. Ces droits et libertés, notamment, sont des composantes intrinsèques du droit à la santé.
Le Maroc faisant partie de la communauté internationale, reconnaît ce droit en mettant en place les mesures, les infrastructures, et surtout le cadre juridique nécessaire. L’article 31 de la constitution prévoit que « l’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit :
- Aux soins de santé ;
- A la protection sociale, à la couverture médicale, et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat ;… ». Cet énoncé constitutionnel a d’importantes implications que ce soit en rapport avec la portée et la dimension de ce droit, ou bien en ce qui concerne les acteurs ou les détenteurs d’obligations.
Ces derniers, principaux duty bearers, sont donc l’Etat, les établissements publics, et les collectivités territoriales (C.T). Si le rôle des deux premiers est relativement définis et claires, celui des C.T ainsi que leurs compétences dans la concrétisation et la mise en œuvre effective du droit à la santé sont marginaux et ne sont en revanche pas très bien définis.
Ce papier explore les lacunes et les contraintes à une intervention efficace des C.T au financement de la santé, ainsi que les possibilités, et les outils de l’amélioration de cette intervention.
1- Une politique de décentralisation sans réelles responsabilités en santé
Les collectivités territoriales au Maroc ont vu leur statut évoluer depuis les premières années de l’indépendance. Cela traduit une préoccupation des autorités marocaines à la décentralisation des pouvoirs et la territorialisation de la gestion locale et sa démocratisation. Au fils des décennies qui suivent, et à travers les révisions constitutionnelles et l’adoption des lois sur la décentralisation, le statut et surtout les responsabilités des C.T ne cessent d’évoluer, sans pour autant, inclure de véritables attributions dans le domaine de la santé.
Pour le système national de santé, il s’agit plutôt d’une déconcentration et d’une délégation de compétences vers des structures administratives territoriales, pour accompagner ce processus de décentralisation.
1.1- Un renforcement de décentralisation face à une déconcentration de santé
Le processus de décentralisation a débuté par la charte communale de 1960, qui a créé les communes, seul niveau de collectivités locales jusqu’alors, si vrai avec des compétences restreintes, et un exécutif bicéphale, mais cette charte a constitué le premier jalon de la construction de l’Etat décentralisé. Les communes ont vu ensuite leur statut renforcé par la charte communale de 1976 avec des compétences plus étendues et des domaines d’intervention variés, intéressant la vie économique, sociale, et les services de proximité, avec une tutelle allégée. Mais avant cette réforme, le processus de décentralisation fut conforté par la promulgation de la constitution de 1962, qui a institué le deuxième niveau de décentralisation, à savoir les provinces[1].
La constitution de 1992 a créé la région comme nouvelle collectivité locale à vocation surtout économique, avant de concrétiser sa place primordiale dans cette politique, dans le cadre de la régionalisation avancée officiellement prévue dans la constitution de 2011. C’est aux premières réformes (en particulier les chartes communales) que revient le fait d’attribuer certains services de santé aux collectivités.
La gestion territoriale du système de santé connaît, en parallèle une déconcentration de responsabilités, d’abord par la mise en place des provinces sanitaires (délégations provinciales et préfectorales du ministère de la santé), servant en principe à la mise en œuvre et l’exécution des politiques nationales en particulier, la lutte contre les épidémies, et autres programmes sanitaires. L’accompagnement de la dynamique de création des régions en 1997, a été traduit par la création, à partir de 2005, des régions sanitaires (directions régionales de santé) avec un partage de responsabilité avec le ministère[2].
La décentralisation par service ou fonctionnelle (sous forme d’établissements publics) va guider ensuite les réformes actuelles, par la création des groupements sanitaires territoriaux (GST), et par le nouveau cadre de gouvernance introduit par les lois relatives au système de santé. La concrétisation de ce mode de gestion territorial et régional a connu une étape importante par le relèvement de ces GST au rang des établissements publics stratégiques, une décision adoptée par le conseil des ministres présidé par le roi, le 01 juin 2024.
1.2- Un cadre législatif limitant l’engagement des collectivités territoriales en santé
Les lois organiques relatives aux C.T, définissent des compétences propres, d’autres partagées avec l’Etat, et celles qui sont transférées par ce dernier. La santé est en général une compétence partagée ou transférée selon les cas.
S’agissant des compétences propres, l’article 80 de la loi 111-14 relative aux régions évoque juste des missions de contribution au développement durable dans le cadre de promotion de développement intégré et durable, en particulier par l’outil du programme de développement régional (PDR).
L’article 91 en énumérant les compétences partagées n’a aucunement évoqué le financement ou la gestion de services de santé, même dans la rubrique « développement social ». L’article 93 a remédié à cette situation en laissant la possibilité à ce type de financement en partenariat avec l’Etat « La région peut, à son initiative et moyennant ses ressources propres, financer ou participer au financement de la réalisation d’un service ou d’un équipement ou à la prestation d’un service public qui ne font pas partie de ses compétences propres et ce, dans un cadre contractuel avec l’Etat, s’il s’avère que ce financement contribue à atteindre ses objectifs.
La santé apparait enfin clairement comme domaine de compétences transférable de l’Etat aux régions, sur la base du principe de subsidiarité (article 94), et que cette transférabilité doit prendre en compte les principes de progressivité et de différenciation entre les régions, et surtout implique de réintégrer le domaine en question dans les compétences propres, ce qui exige bien évidemment la modification de la loi organique (article 95).
Ce cadre législatif qui n’est pas en faveur d’un rôle avancé des régions dans le domaine de la santé s’explique, en partie, par le fait que ces collectivités se voient attribuer en particulier, la mission du développement économique. La mission du développement social est souvent invoquée pour les préfectures et provinces.
En effet, la loi 112-14 relative aux préfectures et provinces stipule que la santé est parmi les compétences propres de la préfecture/province, mais l’article 79 limite cette compétence en un « diagnostic des besoins en matière de santé,… », Ce diagnostic entre dans le cadre du programme de développement de la préfecture / province (PDP) qui doit être établi pour 6 ans avec la participation des autres intervenants, et qui définit les actions prioritaires pour la préfecture/province, les coûts y afférents, et en prenant compte des ressources disponibles.
L’article 86 en énumérant les compétences partagées définit la santé comme domaine d’intervention des préfectures/provinces par « la mise à niveau du monde rural », ceci peut être compris comme la réalisation des petits centres de santé ou dispensaires ruraux, ou leur équipement. Comme c’est le cas pour les régions, les préfectures / provinces, peuvent financer la réalisation d’un service ou d’un équipement public qui ne fait pas partie de leur domaine de compétences propres en recourant aux mécanismes de contractualisation (article 88).
Concernant les communes, la loi 113-14 leur attribue des compétences propres relatives aux services de proximité. Il s’agit de prestations de santé publique et de la promotion de santé dans un sens plus large, comme « – la distribution de l’eau potable ; l’assainissement liquide et solide et les stations de traitement des eaux usées ; la préservation de l’hygiène ; le transport des malades et des blessés ; le transport de corps et l’inhumation ; la création et l’entretien des cimetières… » (Article 83).
Parmi les compétences partagées avec l’Etat, la santé ne figure que dans un seul domaine à savoir « l’entretien des dispensaires » (article 87). Alors que l’article 89 ouvre la voie, à l’instar des autres C.T aux commune de participer au financement « d’un service ou d’un équipement ou à la prestation d’un service public qui ne fait pas partie de ses compétences propres et ce, dans un cadre contractuel avec l’Etat ».
Cette brève lecture du cadre juridique montre que le domaine de la santé peut bénéficier de l’appui financier des CT, au moins dans certains niveaux d’intervention. De Cette lecture se dégage l’existence d’un mécanisme très important mis par le législateur à la disposition des CT pour prendre part dans les investissements et le financement consacrés à la santé, ce mécanisme concerne partenariat et de contractualisation.
2- Aspects et limites d’une réelle intervention financière
Selon les comptes nationaux de santé 2018, les collectivités territoriales n’ont contribué qu’à la hauteur de 2% des dépenses totales de santé (DTS), alors que l’Etat a contribué à environs 24%, tandis que les paiements directs des ménages ont dépassé 49% des DTS. Si la raison avancée est l’extension progressive de l’assurance maladie obligatoire (AMO) qui devra à l’avenir constituer le premier financeur de soins (29,3% en 2018), la contribution des CT demeure ainsi faible [3]. Ces limites s’illustrent dans la modeste expérience des communes dans le financement du RAMED, et résultent non seulement de l’insuffisance du cadre juridique, mais aussi d’un problème qui lui est étroitement lié : la faible autonomie financière des CT.
2.1- Une modeste expérience des Communes avec le RAMED
L’expérience des communes avec le régime d’assistance médicale (RAMED) est révélatrice. Certes les résultats (de gestion et non de l’impact sur l’accessibilité) ne devraient pas être de la seule responsabilité des communes, car les faiblesses marquaient presque tout le processus de la mise en œuvre du programme, et sa gouvernance, mais plusieurs voix ont critiqué le rôle de ces collectivités dans le financement de ce régime.
En effet, le livre III de la loi 65-00 a prévu, dans son titre III, que le financement de ce régime est assuré principalement par l’Etat et les collectivités locales (article 125). Si le législateur n’a pas désigné le niveau de collectivités locales concerné par la contribution à ce régime, le décret d’application n° 2-08-177 a par contre, tranché la question, en attribuant aux seules communes cette responsabilité. Le décret a fixé donc, la contribution à 40 Dh/an/bénéficiaire en situation de pauvreté dans le ressort territorial, comme participation à la prise en charge de la gratuité des soins. Les communes devaient procéder avant le 31 mars de chaque année au virement des sommes dues à un compte d’affectation spéciale nommé « Fonds spécial de la pharmacie centrale » (article 27).
Même si la loi 65-00 dans son article 126 stipule que la contribution des communes soit inscrite dans leurs dépenses obligatoires, celles-ci ne s’acquittaient pas toujours de leurs contributions dues au régime. La cour des comptes a signalé que « l’absence d’un mécanisme de suivi de ces contributions ne permet pas d’avoir le montant réellement versé et la contribution de chaque commune par rapport aux montants prévus » [4]. L’Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM), l’organe gestionnaire du RAMED en communiquant au ministère de l’intérieur les états et les estimations des personnes pauvres de chaque commune et les montants correspondants, a constaté que la situation était marquée par un écart important entre estimations et réalisations effectives de la collecte des participations des communes. À titre d’illustration, en 2016 le montant collecté ne dépassait pas 77% des estimations établies par l’agence [5]. Le faible financement de la santé par les C.T n’est pas isolé, en réalité il est lié à une problématique plus large qui est celle de la gouvernance et en particulier, de l’autonomie financière locale.
2.2- Faible autonomie financière des collectivités territoriales
Si l’article 136 de la constitution prévoit le principe de libre administration dans la gestion et l’organisation des C.T, la pratique montre que l’insuffisance des ressources propres constitue la première contrainte à une action locale efficace.
Cette insuffisance s’aperçoit dans la part importante des recettes fiscales et des subventions qui sont transférées par l’Etat. Les principales recettes fiscales proviennent d’une part fixe de grands impôts et taxes gérées par le pouvoir central, en l’occurrence la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur le revenu (IR) ou l’impôt sur les sociétés (IS). De plus, pour les taxes locales, elles sont souvent gérées par l’Etat pour le compte des C.T, de plus elles sont prévues et encadrées par la loi, alors que le rôle des organes exécutifs territoriaux est limité. Ces organes n’ont qu’une marge limitée de décision consistant en général à fixer le taux dont la fourchette est préalablement établie par voie législative.
En effet, la dépendance des C.T au financement par l’Etat est évidente puisque les ressources transférées par celui-ci ont constitué en moyenne plus de 61% de l’ensemble des ressources globales de ces collectivités hors emprunt sur la période 2002-2021. Tandis que les recettes provenant de la fiscalité gérée directement par ces CT n’ont constitué que 9% en moyenne sur la même période[6].
La dépendance à l’Etat est encore visible, plus ou moins, dans le contrôle exercé par les représentants du ministère de l’intérieur par visa sur les budgets des C.T et les autres documents à caractère financier. Les dépenses obligatoires, même si elles visent une certaine stabilité et rationalisation, elles sont aussi de nature à restreindre les choix de dépenses et ainsi les programmes à financer y compris dans le domaine de la santé.
Que ce soit alors au niveau du cadre juridique, ou budgétaire et financier, la situation est marquée ainsi, par l’existence de multiples contraintes à une intervention réelle et efficace des C.T dans l’offre de soins et services de santé. Les communes ont été les plus engagées dans l’offre de soins, que ce soit par le financement du RAMED ou par leurs services techniques en l’occurrence les Bureaux Municipaux d’Hygiène (BMH) qui ont assuré les prestations de base et les services élémentaires de la prévention et de la santé publique.
3- Perspectives d’amélioration à la lumière des systèmes comparés
La régionalisation avancée et la déconcentration administrative sont des réformes qui ont pour implication le renforcement de l’action territoriale et une responsabilité croissante et élargie des acteurs locaux. De plus, les expériences internationales montrent une décentralisation des systèmes de santé avec un engagement des entités territoriales dans l’effort de financement de la santé. Les C.T au Maroc en s’inspirant de ces expériences, doivent contribuer davantage dans l’amélioration de l’accès de la population aux soins de santé que ce soit dans le cadre de leurs compétences classiques ou par le recours aux outils de gestion modernes et innovants.
3.1- La décentralisation de la santé dans les systèmes étrangers :
Le degré de la décentralisation en santé suit souvent le modèle de l’organisation des Etats et la répartition des compétences entre le centre et les territoires. Le fédéralisme, l’autonomie, la régionalisation sont autant de modèles qui influencent bien évidemment le degré de la décentralisation (dans son sens plus large) de santé.
Les pays scandinaves connus par leurs dépenses élevées en santé, en particulier par le biais des ressources publiques constituent un exemple d’intervention plus avancée des régions et des autres niveaux décentralisés dans l’offre des services de santé. En Suède, où les DPS est de 11,4% du PIB en 2020, les 21 comtés (régions) s’organisent en deux à sept comtés pour collaborer et desservir ainsi un territoire interrégional plus vaste et garantir une couverture de soins plus large à leurs populations. Ce collaboratif interrégional possède au moins un hôpital universitaire, les comtés possèdent aussi leurs propres hôpitaux d’urgences, en plus des autres structures spécialisées. Les municipalités en nombre de 290 ont la responsabilité surtout des soins à des groupes sociaux comme les personnes âgées, les handicapés, et les soins à domicile. Ces municipalités contribuent à une part importante des dépenses de santé du pays (environs 25%). Les comtés et municipalités sont ainsi le premier financeur des soins de santé contribuant à environs 56% des dépenses de santé par le biais de leurs propres taxes en plus des subventions de l’Etat central [7].
Au Danemark voisin, les comtés (régions) en nombre de 7 ont des compétences importantes dans la gestion et le financement des hôpitaux et des soins secondaires et spécialisés, le paiement des actes des médecins généralistes, des dentistes ainsi que des produits pharmaceutiques. Tandis que les 98 municipalités prennent la responsabilité des soins de longue durée, les soins à domicile, les services communautaires de psychiatrie, et les soins aux personnes en situation de handicap. Si les municipalités ont des ressources propres importantes (impôt sur le revenu, sur le foncier) en plus de subventions du gouvernement central, les régions par contre, s’appuient essentiellement sur les subventions de celui-ci (86% en 2023) [8].
En Espagne et en Italie, une longue tradition de la décentralisation des deux systèmes de santé est observée. Après la révision constitutionnelle de 2001, les 19 régions italiennes se voient dotées de larges compétences. Par conséquent, elles disposent aussi des pouvoirs étendus dans le domaine de la santé. Elles sont chargées de programmer, d’établir les règles d’autorisation et d’accréditation, gérer directement des hôpitaux, et de la prestation des services de santé en général à travers les autorités locales de santé. A cet effet, elles mettent en place des plans triennaux de la santé. Dans le cadre de la conférence Etat- régions, il est convenu annuellement de financement qui profitera à chaque région, selon des critères bien définis (démographiques et économiques). Le gouvernement central procède à une estimation des revenus propres pour la santé que peut générer chaque région par ses taxes et impôts, et la différence entre les besoins de financement et cette estimation est couverte par un fond de péréquation alimenté essentiellement par le produit de la TVA nationale pour combler les disparités interrégionales.[9].
En Espagne, aussi, les 17 autorités autonomes (comunidades autónomas CA) assurent la programmation, la planification, et l’allocation des ressources, comme elles détiennent la décision de l’achat et la fourniture de prestations. [10]. Ces autorités autonomes sont représentées, en plus du ministère central de la santé, dans le Conseil interterritorial du système national de la santé (CISNS), devenu, depuis la loi sur la cohésion et de la qualité du SNS de 2003 (article 69) une autorité suprême au sein du SNS espagnole, chargée de coordination, de coopération, de communication, et d’information entre les CAs et l’administration centrale [11], et [12]. Le processus de dévolution a été achevé en 2001 par le transfert de compétences en santé au niveau régional, car les CAs sont désormais responsables de différents aspects de l’offre de services et de soins de santé y compris la tarification, l’achat et le financement. Bien que les communautés autonomes espagnoles jouissent d’une importante autonomie fiscale, elles financent, cependant non seulement la santé, mais les autres services de base. C’est pour cette raison que des fonds de péréquation et de subvention qui visent la réduction des disparités entre les régions sont prévus à l’échelon national [13].
La décentralisation domine l’organisation des systèmes de santé et leur financement aussi en dehors de l’Europe. Le Canada, la plupart des pays d’Amérique latine, ainsi que plusieurs pays d’Afrique ont des soins de santé décentralisés, certainement à des degrés différents selon l’organisation du pouvoir et de l’administration de l’Etat.
Au Canada, certaines provinces ont initié la préfiguration de leurs systèmes de santé dès les années 1940 en établissant un système de l’assurance maladie légale[14]. Le fédéralisme constitutionnel octroie aux provinces et territoires (P.T) une compétence générale sur l’administration non seulement de la santé, mais des autres programmes et services. La santé fait partie de responsabilité commune entre l’Etat fédéral et les P.T, dans le sens où 13 régimes de l’assurance maladie des provinces constituant ensemble le régime public sont administrés et règlementés par les ministères provinciaux de la santé, les P.T assurent aussi la tarification des actes médicaux, et le paiement des soins hospitaliers. Le financement de la santé au Canada est majoritairement public (70% en 2018)[15], assuré conjointement par la fiscalité des gouvernements fédéral et des P.T. Ces derniers contribuent à hauteur de 78% alors que le gouvernement fédéral assure le reste à travers le transfert canadien en matière de santé (TCS)[16].
En Amérique latine, les systèmes de santé sont de plus en plus décentralisés, même en dehors du cadre du fédéralisme (au Brésil) par exemple. Les constitutions de ces pays reconnaissent explicitement le droit à la santé aux citoyens, et les régimes de couverture sont une composante essentielle des politiques sociales qui caractérisent la région. Au brésil, les soins de santé primaires dans ce pays à système de santé unifié (SUS) pour plus de 200 millions d’habitants, sont de la responsabilité des municipalités. La santé communautaire y est développée avec des résultats importants de l’adhésion de la population aux programmes et politiques de santé[17]. Les Etats brésiliens fédérés sont aussi impliqués par les autorités et conseils de santé, et participent activement au financement des soins. Le processus de décentralisation a été renforcé depuis l’année 2006 avec un transfert de compétences et de ressources aux organismes exécutifs des Etats et des municipalités. Au cours de la même année, les Etats fédérés ont contribué à plus de 20% des dépenses publiques de santé, presque la même part était la participation des municipalités, alors que l’Etat fédéral a financé environs 50% de ces dépenses[18].
En Colombie, le système de santé se base sur la couverture maladie dans le cadre de la protection sociale, il est l’un des systèmes les plus performants des Amériques. Les réformes des années 1990 ont beaucoup transformé la situation de l’accès aux soins et leur financement. Les deux principaux régimes de couverture sont le régime contributif basé sur les contributions salariales et patronales et le régime subventionnel financé par l’impôt. Les entités territoriales (départements, et municipalités), en plus de transfert national, consacrent des ressources propres pour la santé. Ces ressources proviennent de la fiscalité locale principalement à travers des taxes sur les boissons, l’alcool, les cigarettes, et sont affectées en partie au régime subventionnel, et aussi à la gestion territoriale directe des programmes de santé et au financement de la santé publique, et de la couverture de certaines catégories de bénéficiaires et services non couverts[19].
En Afrique, bien que le contexte socio-économique soit difficile à une implantation efficace d’une politique de territorialisation de santé, et les défis demeurent toujours de taille, des expériences importantes et courageuses sont menées et nécessitent d’être examinées. Au Rwanda par exemple, en sortant de la guerre civile des années 1990, l’infrastructure et l’offre de soins étaient en situation catastrophique, quelques années après, les politiques de santé dans ce pays ont été reconnues intéressantes et inspirantes par plusieurs organisations internationales, l’OMS, en particulier. Le taux de la couverture par le régime d’assurance maladie à base communautaire (AMBC) s’est remarquablement amélioré depuis son lancement en 2005 (il couvre plus de 93% des rwandais âgés entre 15 et 49 ans en 2019 et vise le secteur informel)[20]. Les réformes qui ont été entreprises dans le pays dès 2005 ont porté aussi sur la décentralisation et le renforcement des pouvoirs locaux en matière de santé. Avec la politique de décentralisation et la loi nº 87/2013, les provinces et surtout les districts sont devenu des gouvernements locaux, et l’acteur local principal avec des mécanismes de participation de la communauté dans la prise de décision, et des compétences étendues dans le domaine de la santé, qui étaient auparavant détenues par les gouvernements central et provincial[21]. Les provinces comme niveau intermédiaire entre le national et le local (district) s’occupent dans le cadre de la décentralisation, de la gestion, du management et de la mise en œuvre des politiques de santé, ainsi que la fourniture et le soutien technique, et administratif. Les directions provinciales veillent aussi à la répartition adéquate et équitable des ressources. Les districts comme niveaux opérationnel ou périphérique sont responsables de l’organisation des services dans les centres de santé et les hôpitaux de district, en particulier, le fonctionnement administratif, le paquet minimum de soins, l’approvisionnement en médicaments, et la supervision des agents communautaires de santé. À tous les niveaux du district sanitaire, les décisions sont prises collectivement par le biais de divers comités, qui servent de véhicules à la participation communautaire dans le secteur de la santé[22] .
Plusieurs autres systèmes de santé en Afrique sont aussi décentralisés, car dans ces pays, il s’agit d’un choix qui permet de faire face aux grandes difficultés, par l’intégration de la communauté et la participation des citoyens dans les décisions et le financement des politiques de santé. Comme la décentralisation est un processus/politique complexe, elle diffère d’un pays à l’autre suivant les facteurs et déterminants de l’histoire, de la dynamique politique, de la géographie, de l’appareil administratif, et des caractéristiques démographiques et sanitaires de chaque pays.
Au Ghana, au Nigeria, en Ethiopie, à l’Uganda, et en Tanzanie, par exemple, des expériences de décentralisation sont plus au moins identifiables. Dans ces expériences, il s’agit en général, d’une responsabilisation des entités locales dans la gestion et la fourniture des soins de santé primaires, de promotion de santé, mais aussi des soins secondaires, ainsi qu’une compétence de gestion de ressources humaines et financières transférées, et dans certaines situations, la gestion des caisses ou de mutuelles santé au niveau territorial [23].
3.2- Vers une participation optimale des C.T dans les services de santé
Dans le contexte marocain, si le législateur, à travers les textes de loi relatifs aux collectivités territoriales (voir cadre juridique ci-dessus) n’a pas prévu ni des transferts budgétaires à des fins de financement de la santé, ni une intervention effective de ces collectivités dans la gestion et la fourniture des services de soins, il a cependant laissé une marge de manœuvre exploitable par les conseils élus de ces collectivités. En d’autres termes, même le système de santé marocain est centralisé, ces conseils ne sont pas totalement privés des outils de participation à l’amélioration de l’offre de soins au niveau local.
Le législateur, en d’autre part, à travers les lois relatives au système de santé, cette fois ci, n’a pas attribué de larges compétences aux collectivités territoriales. Une lecture dans la loi cadre 06-22 relative au système national de santé, et surtout la loi 08-22 portant création des GST montre une orientation plutôt vers une déconcentration comparable au modèle français de l’organisation des soins.
L’influence du modèle français sur la réforme et la gouvernance du secteur de la santé se manifeste clairement dans la délégation ou transfert des compétences de gestion et du pilotage à des organismes publics crées dans chaque région et dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière (Agences Régionales de Santé ARS en France, et GST au Maroc). Cette influence s’aperçoit aussi dans la conservation par les autorités centrales de ses grandes compétences, en particulier les politiques et stratégies, le contrôle, le financement et l’assurance maladie.
Comme c’est le cas pour les textes de la décentralisation, ceux relatifs au système de santé ont également prévu des mécanismes permettant aux C.T de contribuer au financement de santé. Ainsi, l’article 4 de la loi 08-22 précitée prévoit la possibilité de conclure des contrats de coopération entre les établissements de santé implantés dans la région, d’une part, et les administrations publiques et les collectivités territoriales, d’autre part. Selon les dispositions du même article, ces établissements peuvent également faire appel à des partenariats avec le secteur privé.
En effet, des outils comme le partenariat et la coopération, sont efficace pour améliorer la participation des C.T dans le domaine de la santé, en particulier à l’ère de la généralisation de la protection sociale, et la mise en œuvre du droit à la santé pour tous les marocains. Le rôle des C.T devient alors indispensable, car ces politiques requièrent l’augmentation des fonds consacrés à l’assurance maladie, et aux infrastructures sanitaires.
Le partenariat est le choix privilégié alors pour les C.T pour surmonter les contraintes de compétences, car comme mode innovant de financement, il permet de mieux orienter les investissements et les fonds vers les la satisfaction des besoins les plus prioritaires de la population locale en matière de santé.
Les principaux domaines pouvant faire objet du partenariat sont essentiellement, les ressources humaines, et l’équipement. Cela signifie que les collectivités territoriales, les régions en premier lieu, peuvent prendre part dans la réalisation de tout projet d’infrastructure hospitalière ou ambulatoire, ou prendre en charge les dépenses du personnel soignant. Sur le dernier point, l’expérience de certains conseils provinciaux est à encourager et à généraliser surtout dans les régions qui connaissent un manque de professionnel de santé. Ces conseils ont créé de leurs propres budgets des postes d’emploi pour le recrutement des infirmiers afin de couvrir le manque dans certains centres hospitaliers provinciaux, et même dans des centres de santé ruraux.
D’autres collectivités territoriales ont activement participé dans l’acquisition du bien immobilier, ou la construction des hôpitaux. Dans ce sens, on note par exemple l’approbation du conseil de la région de l’Oriental au cours de sa session ordinaire du 02 mars 2020 de l’accord de partenariat visant la construction de 05 hôpitaux provinciaux [24], ou dans le même sens, le financement en totalité par le conseil de la région de Fès-Meknès de la construction d’un centre de diagnostic à Sefrou [25].
Ces initiatives, bien qu’elles ne soient pas fréquentes, montrent à quel point les collectivités territoriales, en présence de la volonté, et de la priorisation des objectifs de développement, peuvent rapprocher les services de santé à leurs populations et renforcer l’offre de soins sur le territoire.
Par ailleurs, le partenariat, comme alternative aux limites de compétences, permet, comme défini dans la littérature, de coordonner les actions, et de mutualiser les moyens pour l’atteinte des objectifs communs. En santé, ceci a d’importantes conséquences, comme l’implication davantage des acteurs locaux, la participation des représentants des citoyens et de la société civile, par des mécanismes de la démocratie participative et sanitaire dans les décisions et la mise en œuvre des programmes.
Le partenariat dont les collectivités territoriales sont partie, et par conséquent, une partie prenante, favorise la performance du système de santé, non seulement par l’adaptation de l’offre et la nature de services aux réalités et aux besoins locaux, mais aussi par la réduction des disparités interrégionales et entre les milieux rural et urbain.
Le cadre juridique et de gouvernance de la décentralisation, ainsi que l’organisation des pouvoirs entre le gouvernement central au Maroc et les collectivités territoriales, d’une part, et la centralisation du système de santé malgré les récentes réformes de déconcentration, d’autre part, sont autant d’éléments qui ne font pas du domaine de la santé une compétence essentielle des collectivités territoriales, contrairement à ce qui est observé dans plusieurs pays à travers le monde. Par conséquent, la contribution de ces collectivités à la prestation de services devrait rester modeste (promotion de santé, hygiène et assainissement). De même la participation au financement des soins à travers certains programmes (RAMED par exemple) atteste de la limite du rôle des C.T. Cependant, en attendant une vrai décentralisation des services et du financement de santé, des outils comme le partenariat, prévu à la fois par les lois organiques relatives à ces collectivités, et par les lois sur le système national de santé, peut pallier cette insuffisance et contribuer efficacement au renforcement la contribution des collectivités territoriales dans le financement du système de santé.
Ouvrages :
Bernal-Delgado, Enrique, Sandra García-Armesto, Juan Oliva, Fernando Ignacio Sánchez Martínez, José Ramón Repullo, Luz María Peña-Longobardo, Manuel Ridao-López, Cristina Hernández-Quevedo, et World Health Organization. « Spain: health system review », 2018.
Birk, Hans Okkels, Vrangbæk Vrangbæk, Andreas Rudkjøbing, Allan Krasnik, Astrid Eriksen, Erica Richardson, et Signe Smith Jervelund. « Denmark Health System Review 2024», Health Systems in Transition, 2024.
Couttolenc, B.F. et World Bank. Decentralization and Governance in the Ghana Health Sector. World Bank Studies. World Bank Publications, 2012. https://books.google.co.ma/books?id=IiNfIxm4czwC.
European Observatory on Health Systems and Policies. « State of Health in the EU Spain: Country Health Profile 2023 ». OCDE publishing, 2023.
García-Armesto, Sandra, María B Abadía-Taira, Antonio Durán, Cristina Hernández-Quevedo, Enrique Bernal-Delgado, et World Health Organization. « Spain: Health system review », 2010.
GIULIO DE BELVIS, Antonio, Michela MEREGAGLIA, Alisha MORSELLA, Andrea Adduci, Alessio Perilli, Fidelia Cascini, Alessandro Solipaca, Giovanni Fattore, Anna Maresso, et Giada Scarpetti. « Italy: health system review 2022 », 2022.
Articles de revues
El Khider, Abdelkader, et Hanaa Imichoui. « La régionalisation, nouveau mode de gouvernance du système de santé: état des lieux pour le cas du Maroc ». Eur Sci J 16 (2020): 154‑71.
Janlöv, Nils, Sara Blume, Anna H. Glenngård, Kajsa Hanspers, Anders Anell, et Sherry Merkur. Sweden: Health System Review. Health Systems in Transition, Vol. 25, no 4 (2023). Copenhagen Ø, Denmark: WHO Regional Office for Europe, 2023.
Lago, Miguel. « La santé publique en Amérique latine: un état des lieux ». Les Études du CERI, no 252‑253 (2021): 85‑99.
Marchildon, Gregory P, Sara Allin, et Sherry Merkur. « Canada: health system review ». Health Systems in Transition 22, no 3 (2020).
Melo-Becerra, Ligia Alba, Luis E Arango-Thomas, Óscar Ávila-Montealegre, Jhorland Ayala-García, Leonardo Bonilla-Mejía, Jesús Alonso Botero-García, Manuela Cardona-Badillo, Carolina Crispin-Fory, Daniela del Pilar Gallo-Montaño, et Clark Júnior Granger-Castaño. « Aspectos financieros y fiscales del sistema de salud en Colombia ». Revista Ensayos Sobre Política Económica; No. 106, octubre 2023. Pág.: 1-92, 2023.
Paim, Jairnilson, Claudia Travassos, Celia Almeida, Ligia Bahia, et James Macinko. « The Brazilian health system: history, advances, and challenges ». The Lancet 377, no 9779 (21 mai 2011): 1778‑97. https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (11)60054-8 .
Ridic, Goran, Suzanne Gleason, et Ognjen Ridic. « Comparisons of health care systems in the United States, Germany and Canada ». Materia socio-medica 24, no 2 (2012): 112.
Umuhoza, Stella M, Sabine F Musange, Alypio Nyandwi, Agnes Gatome-Munyua, Angeline Mumararungu, Regis Hitimana, Alexis Rulisa, et Parfait Uwaliraye. « Strengths and weaknesses of strategic health purchasing for universal health coverage in Rwanda ». Health Systems & Reform 8, no 2 (2022): e2061891.
Ressources électroniques
Agence Nationale de l’Assurance Maladie, Rapport d’activités, 2016. http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-social/sante/couverture-medicale/rapport-d-activites-de-l-agence-nationale-de-l-assurance-maladie-anam-2016
Association médicale canadienne. « Comment les soins de santé sont-ils financés au Canada ?» 2024. https://www.cma.ca/fr/comment-soins-sante-sont-ils-finances-au-canada
BENSOUDA, Noureddine. « Colloque : « autonomie fiscale locale et développement territorial : diagnostic et état des lieux » », 2 avril 2022. https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/b3c0a1fa-d6aa-4243-9661-dba583a0b97d/Intervention%2Bde%2BMonsieur%2Ble%2BTGR%2Bdu%2B02%2Bavril%2B2022.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b3c0a1fa-d6aa-4243-9661-dba583a0b97d
Conseil de la région de l’Oriental. « le Conseil de la Région de l’Oriental approuve la construction de 5 hôpitaux et la création de nouveaux emplois », 2020. https://conseilregionoriental.ma/fr/le-conseil-de-la-r%C3%A9gion-de-l%E2%80%99oriental-approuve-la-construction-de-5-h%C3%B4pitaux-et-la-cr%C3%A9ation-de
Conseil de la région Fès-Meknès, « Construction d’un centre de diagnostic à l’hôpital Mohamed V à Sefrou – Province de Sefrou ». Région Fès Meknès, 2020. https://www.region-fes-meknes.ma/fr/actualites/construction-dun-centre-de-diagnostic-a-lhopital-mohamed-v-a-sefrou-province-de-sefrou/
Cour des comptes, Rapport annuel, 2018. https://www.courdescomptes.ma/publication/rapport-annuel-au-titre-de-l-annee-2018/
Government of Rwanda. « Health Sector Policy », 2005. https://www.moh.gov.rw/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=26012&token=1ebde576f1e28f7fb60df9488d9c8097f7618ab4
Ministère de la santé. « Comptes nationaux de la santé- 2018 », 2018. https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/2021/CNS-2018.pdf
Ministerio de Sanidad. « Ministerio de Sanidad – Ministère – CC.AA y Ciudades Autónomas», 2024. https://www.sanidad.gob.es/fr/organizacion/ccaa/home.htm
Ministry of Health. « Rwanda’s Performance in Addressing Social Determinants of Health and Intersectoral Action : A Review against the Five Themes of the Rio Political Declaration», 2024. https://www.afro.who.int/publications/rwandas-performance-addressing-social-determinants-health-and-intersectoral-action
Portail national des collectivités territoriales. « 1959-1976 : Instauration des principales bases de la décentralisation », 2024. https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/fr/1959-1976-instauration-des-principales-bases-de-la-decentralisation
[1] Portail national des collectivités territoriales. « 1959-1976: Instauration des principales bases de la décentralisation », 2024. https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/fr/1959-1976-instauration-des-principales-bases-de-la-decentralisation
[2] El Khider, Abdelkader, et Hanaa Imichoui. « La régionalisation, nouveau mode de gouvernance du système de santé: état des lieux pour le cas du Maroc ». Eur Sci J 16 (2020): 154‑71.
[3] Ministère de la santé. « Comptes nationaux de la santé- 2018 », 2018. https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/2021/CNS-2018.pdf
[4] Cour des comptes, Rapport annuel, 2018. https://www.courdescomptes.ma/publication/rapport-annuel-au-titre-de-l-annee-2018/
[5] Agence Nationale de l’Assurance Maladie, Rapport d’activités, 2016.
[6] BENSOUDA, Noureddine. « Colloque : « autonomie fiscale locale et développement territorial : diagnostic et état des lieux » », 2 avril 2022. https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/b3c0a1fa-d6aa-4243-9661-dba583a0b97d/Intervention%2Bde%2BMonsieur%2Ble%2BTGR%2Bdu%2B02%2Bavril%2B2022.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b3c0a1fa-d6aa-4243-9661-dba583a0b97d
[7] Janlöv, Nils, Sara Blume, Anna H. Glenngård, Kajsa Hanspers, Anders Anell, et Sherry Merkur. Sweden: Health System Review. Health Systems in Transition, Vol. 25, no 4 (2023). Copenhagen Ø, Denmark: WHO Regional Office for Europe, 2023.
[8] Birk, Hans Okkels, Vrangbæk Vrangbæk, Andreas Rudkjøbing, Allan Krasnik, Astrid Eriksen, Erica Richardson, et Signe Smith Jervelund. « Denmark Health System Review 2024 », Health Systems in Transition, 2024.
[9] GIULIO DE BELVIS, Antonio, Michela MEREGAGLIA, Alisha MORSELLA, Andrea Adduci, Alessio Perilli, Fidelia Cascini, Alessandro Solipaca, Giovanni Fattore, Anna Maresso, et Giada Scarpetti. « Italy: health system review 2022 », 2022.
[10] European Observatory on Health Systems and Policies. « State of Health in the EU Spain: Country Health Profile 2023 ». OCDE publishing, 2023.
[11] García-Armesto, Sandra, María B Abadía-Taira, Antonio Durán, Cristina Hernández-Quevedo, Enrique Bernal-Delgado, et World Health Organization. « Spain: Health system review », 2010.
[12] Ministerio de Sanidad. « Ministerio de Sanidad – Ministère – CC.AA y Ciudades Autónomas », 2024. https://www.sanidad.gob.es/fr/organizacion/ccaa/home.htm
[13] Bernal-Delgado, Enrique, Sandra García-Armesto, Juan Oliva, Fernando Ignacio Sánchez Martínez, José Ramón Repullo, Luz María Peña-Longobardo, Manuel Ridao-López, Cristina Hernández-Quevedo, et World Health Organization. « Spain: health system review », 2018.
[14] Ridic, Goran, Suzanne Gleason, et Ognjen Ridic. « Comparisons of health care systems in the United States, Germany and Canada ». Materia socio-medica 24, no 2 (2012): 112.
[15] Marchildon, Gregory P, Sara Allin, et Sherry Merkur. « Canada: health system review ». Health Systems in Transition 22, no 3 (2020).
[16] Association médicale canadienne. « Comment les soins de santé sont-ils financés au Canada ? », 2024. https://www.cma.ca/fr/comment-soins-sante-sont-ils-finances-au-canada
[17] Lago, Miguel. « La santé publique en Amérique latine : un état des lieux ». Les Études du CERI, no 252‑253 (2021): 85‑99.
[18] Paim, Jairnilson, Claudia Travassos, Celia Almeida, Ligia Bahia, et James Macinko. « The Brazilian health system: history, advances, and challenges ». The Lancet 377, no 9779 (21 mai 2011): 1778‑97. https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (11)60054-8 .
[19] Melo-Becerra, Ligia Alba, Luis E Arango-Thomas, Óscar Ávila-Montealegre, Jhorland Ayala-García, Leonardo Bonilla-Mejía, Jesús Alonso Botero-García, Manuela Cardona-Badillo, Carolina Crispin-Fory, Daniela del Pilar Gallo-Montaño, et Clark Júnior Granger-Castaño. « Aspectos financieros y fiscales del sistema de salud en Colombia ». Revista Ensayos Sobre Política Económica; No. 106, octubre 2023. Pág.: 1-92, 2023.
[20] Umuhoza, Stella M, Sabine F Musange, Alypio Nyandwi, Agnes Gatome-Munyua, Angeline Mumararungu, Regis Hitimana, Alexis Rulisa, et Parfait Uwaliraye. « Strengths and weaknesses of strategic health purchasing for universal health coverage in Rwanda ». Health Systems & Reform 8, no 2 (2022): e2061891.
[21] Ministry of Health. « Rwanda’s Performance in Addressing Social Determinants of Health and Intersectoral Action : A Review against the Five Themes of the Rio Political Declaration », 2024. https://www.afro.who.int/publications/rwandas-performance-addressing-social-determinants-health-and-intersectoral-action
[22] Government of Rwanda. « Health Sector Policy », 2005. https://www.moh.gov.rw/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=26012&token=1ebde576f1e28f7fb60df9488d9c8097f7618ab4.
[23] Couttolenc, B.F. et World Bank. Decentralization and Governance in the Ghana Health Sector. World Bank Studies. World Bank Publications, 2012. https://books.google.co.ma/books?id=IiNfIxm4czwC
[24] Conseil de la région de l’Oriental. « le Conseil de la Région de l’Oriental approuve la construction de 5 hôpitaux et la création de nouveaux emplois », 2020. https://conseilregionoriental.ma/fr/le-conseil-de-la-r%C3%A9gion-de-l%E2%80%99oriental-approuve-la-construction-de-5-h%C3%B4pitaux-et-la-cr%C3%A9ation-de
[25] Conseil de la région Fès-Meknès, Nisrine. « Construction d’un centre de diagnostic à l’hôpital Mohamed V à Sefrou – Province de Sefrou ». Région Fès Meknès, 2020. https://www.region-fes-meknes.ma/fr/actualites/construction-dun-centre-de-diagnostic-a-lhopital-mohamed-v-a-sefrou-province-de-sefrou/