LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE: Essoufflement ou tournant historique
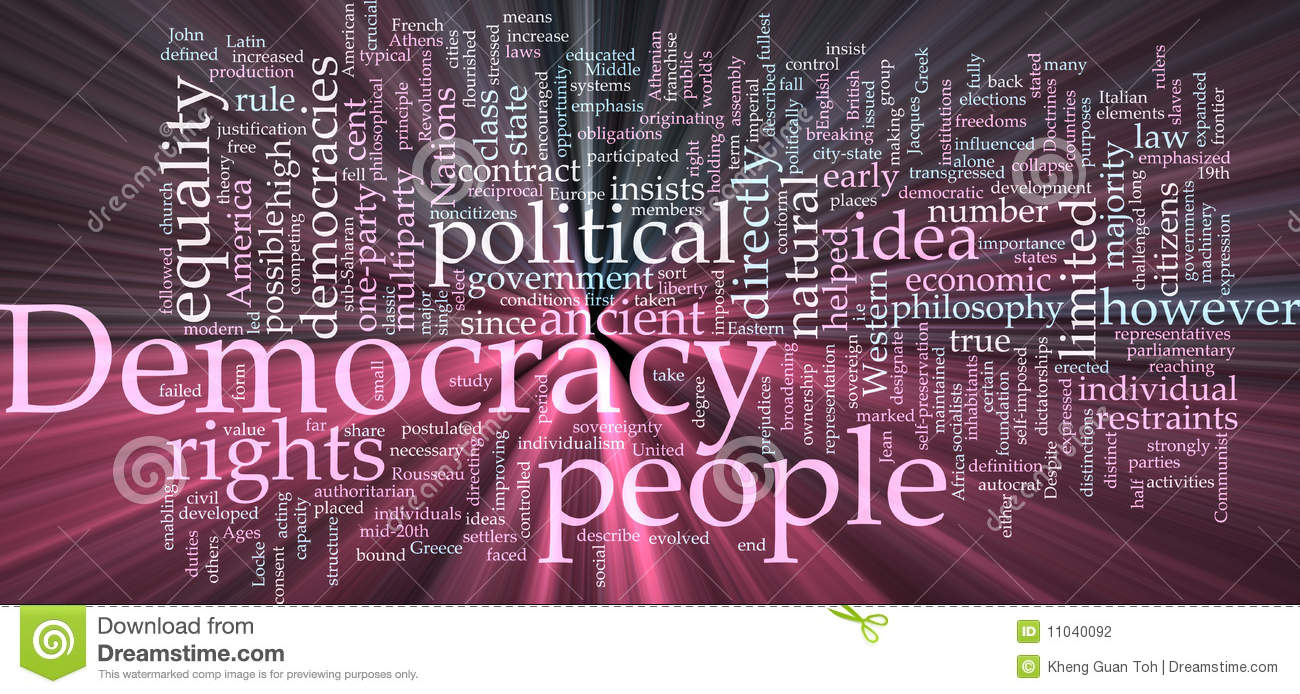
Prepared by the researche : IMANE TCHIECH – DOCTORANTE A LA FACULTE – DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES UNIVERSITE MOULAY ISMAIL – MEKNES
Democratic Arabic Center
Journal of Political Science and Law : Forty-fourth Issue – June 2025
A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
Journal of Political Science and Law
:To download the pdf version of the research papers, please visit the following link
Résumé
Si le système de représentation basé sur le vote a été pendant des siècles proclamé comme la voie la plus évidente pour une démocratie populaire, l’exercice réel et prolongé de sa pratique a abouti à une crise de représentativité. L’attraction des institutions et le rôle des élus se sont vus essoufflés et mis à mal. Désormais, l’abstention et le manque de confiance en les acteurs chargés de la gestion de la chose publique, le recul du civisme et de la citoyenneté deviennent les manifestations d’une crise que confrontent les gouvernements dans les pays dits démocrates. D’où la nécessité d’une analyse historique de la représentation et des causes et aspects de sa crise. Des perspectives à venir dépend l’avenir de la démocratie représentative et avec elle le sort des sociétés modernes.
Introduction:
A l’occasion de chaque nouvelle élection s’impose la question de la participation et avec celle-ci la question de la démocratie et de la représentation.
L’échec des gouvernements à asseoir des politiques publiques capables de répondre aux aspirations des populations : un plein emploi, un produit national en augmentation, baisse des prix de la vie, progrès technique soutenu, éducation et santé assurées… est l’élément essentiel qui amplifie la méfiance des citoyens envers le système basé sur la démocratie représentative.
Les scandales de corruption, du favoritisme et du clientélisme qui ternissent l’image des représentants nourrissent la crise de la représentation et du manque de confiance[1] que l’élu et le technocrate ne cessent de décrier.
Si quelques-uns voient en ces manifestations une crise d’application de la démocratie représentative, d’autres les perçoivent comme un échec du concept lui-même, en découle la problématique suivante : est-ce un essoufflement d’un concept qui a dominé le monde pendant des siècles, ou est-ce une impasse historique qui peut engendrer des rebonds et une refondation qui redorera le blason de la représentation et rendre le pouvoir au peuple ? Et quelle est la responsabilité des élus et des technocrates dans cet état des lieux et dans les perspectives à venir ?
Il est à noter que de cette question dépend la cohésion sociale et la stabilité des institutions représentatives. D’où l’intérêt du sujet et des questions qu’il suscite.
Cet article entend mettre le point sur un bref aperçu historique de la représentation, et comment s’est développée la crise de la démocratie représentative et quelles en sont les principales manifestations. On conclura par quelques pistes susceptibles de refonder la démocratie représentative comme pouvoir du peuple.
- Bref aperçu historique sur la représentation :
Si la crise de la démocratie représentative renvoie au besoin réclamé par un nombre croissant de citoyens d’une démocratie permanente forgeant les moyens d’infléchir les politiques publiques ayant des incidences néfastes ou insuffisantes sur le vécu des populations sans attendre les élections suivante[2], un bref rappel historique sur l’émergence de la représentation permettra de mettre le doigt sur les clivages qui ont alimenté ce qu’on appelle aujourd’hui la crise de la démocratie représentative.
1 Emergence de la représentation :
Selon «Pierre Rosanvallon», dans son ouvrage « Le peuple introuvable », le terme de démocratie représentative apparut dès les années 1770.[3] Alexander Hamilton fut le premier à l’asseoir dans une lettre au gouverneur Morris le 19 Mai 1777. Il ajoute que quelques ’uns considèrent ce concept comme un régime intermédiaire associant pouvoir populaire et valeurs aristocratiques. D’autres l’inscrivent dans une perception plus large d’une division des tâches qui fait de la politique un domaine spécialisé et géré par des experts.[4]
J.J Rousseau affirmait quant à lui dans «Du Contrat Social» que «l’idée de représentation est moderne : elle nous vient du féodal, de cet unique et absurde gouvernement dans lequel l’espèce humaine est dégradée, et où le nom de l’homme est en déshonneur. Dans les anciennes républiques et même dans les monarchie, jamais le peuple n’eut de représentants ».[5]
Pour Rousseau, L’homme ne doit pas être comme un vassal qui prête serment et allégeance à son suzerain dans le gouvernement féodal.
Si la «démocratie athénienne» fondée sur le tirage au sort était souvent sacralisée et présentée comme un régime politique, Montesquieu annonçait dans “De l’Esprit des Lois” que «le suffrage par le sort est de nature de la démocratie, le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie. Le sort est une façon d’élire qui n’afflige personne, il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie »[6]. Montesquieu considère que « La démocratie appelle le sort et l’aristocratie l’élection »[7].
Selon Dominique Rousseau le régime représentatif parait se démocratiser manifestement avec la généralisation du vote et l’introduction du peuple dans l’espace public …, le soutien majoritaire comme le système permettant aux électeurs de décider en choisissant un programme politique».[8]
Même si Montesquieu considérait le sort et l’élection comme deux formes faisant partie des lois fondamentales d’une république, il jugeait le tirage au sort comme défectueux par lui-même, à savoir qu’il peut désigner des incompétents. Et pour y remédier, il appelle des juges qui examineraient dignité et capacité des représentants. «Les gens devraient avoir de la répugnance à donner leur nom pour être tirés au sort».[9]
Le droit de vote et la généralisation du suffrage joueront un rôle extrêmement important dans la démocratie représentative de par l’exigence des masses de l’Etat de plus de représentativité. La liberté d’association et la consolidation du système partisan donneront une poussé considérable au développement du système représentatif.
2- La représentation au Maroc contemporain :
Depuis son indépendance, le Maroc fut l’un des pays qui ont encouragé la participation politique et c’est pourquoi il a instauré le multipartisme depuis les années 1960. Ainsi, il a expérimenté nombre de mode de suffrage et de scrutin dans les diverses élections législatives. La Constitution de 1962 prévoyait la mise en place de deux chambres. Le parlement, composé des représentants élus au suffrage direct, au scrutin majoritaire et uninominal à un tour. La chambre des conseillers est élue au suffrage indirect. Mais la dégradation du climat politique et l’annonce de l’Etat d’urgence en 1965, n’ont pas permis que ces deux chambres voient le jour.
Pendant la période de 1970 à 1996, le parlement est monocaméral avec une seule chambre qui combine suffrage direct et indirect.
Il faut attendre la réforme constitutionnelle de 1996 pour voir rétablie la deuxième chambre. A partir des élections de 1997, le parlement est élu complétement au scrutin uninominal à un tour. En 2002, le Maroc adopte le scrutin proportionnel plurinominal ou ce qu’on appelle le scrutin de liste[10].
La constitution de 2011, consolidera le système représentatif à deux chambres, mais apportera d’autres formes de participation susceptibles de consolider le rôle des citoyens dans la question publique.
- Les manifestations de la crise de la démocratie représentative :
L’instant électoral ravive les débats sur le fonctionnement des démocraties dites représentatives. Les médias et les réseaux sociaux présentent l’image d’un système représentatif menacé par la montée des discours populistes et l’hostilité envers les politiciens et les formes traditionnelles de participation à la vie politique, à savoir les partis et les syndicats. Cette désaffectation du politique se traduit par diverses formes que l’on va essayer d’aborder en se focalisant sur l’abstentionnisme et les critiques liées aux élus et au parlementarisme.
- Abstentionnisme : crise ou forme de participation ?
De nos jours, les citoyens boycottent de plus en plus les urnes car ils se sentent trahis par les représentants et par conséquent considèrent leur souveraineté mise en cause. Et si quelques-uns voient cet abstentionnisme comme une forme nouvelle de participation, d’autres y voient un signe de crise et de métamorphose de la démocratie en un régime d’une minorité coupée de tous liens avec la réalité et le vécu de la majorité des citoyens.
- Les effets politiques de l’abstentionnisme au Maroc :
Le phénomène de l’abstentionnisme ne cesse de progresser d’une échéance électorale à l’autre. En 2021 par exemple, le taux de participation a atteint 50.18% avec 13.63% de votes blancs. Un bref aperçu sur d’autres échéances confirmera l’idée du malaise électoral et la crise de la démocratie représentative tant sacralisé et défendue.
Ce pourrissement est du à plusieurs raisons dont l’incapacité des «élites» traditionnelles marocaines à capter l’attention des citoyens et à répondre à leurs aspirations surtout avec le manque de soutien habituel du pouvoir. Même l’ancienne opposition se voit pénaliser, critiquer et boycotter. La montée des technocrates et la place prépondérante qu’ils occupent désormais dans la sphère politico-économique et dans la gestion des chantiers de la gouvernance participative[11], aggrave le phénomène de l’abstentionnisme.
Les représentants se trouvent en dehors des décisions stratégiques dans le domaine politique, économique et social qui incombent au palais.
Les électeurs se sentent délaissés par la démagogie et le mensonge vu que les programmes politiques annoncés lors des élections ne se concrétisent pas et n’ont pas beaucoup d’incidence sur leur vécu quotidien des gens.
L’absence d’un projet de société résultant d’idée et d’intérêt[12] a amplement accru la crise militante. En acceptant les règles du jeu politique, les négociations et les compromis, les partis politiques dits de gauche sont devenus des partis de gouvernement d’où leur déracinement de leur masse électorale historique. La crise de confiance se manifeste désormais par le boycott et la défiance envers l’élu et les institutions.
Les acteurs politiques doivent innover en matière de l’offre électorale et lutter contre tous les facteurs de démobilisation pour inciter les citoyens à voter et de là à se réapproprier l’espace représentatif.
- Légitimité et citoyenneté en crise :
L’état des lieux de la réalité de la participation politique et de gestion de la chose publique renvoie à une perte de légitimité de plus en plus accrue auprès des citoyens, ce qui interpelle les représentants et les gouvernements et appelle une quête de légitimité et un renouveau des structures de la citoyenneté.
- La légitimité en malaise :
Si l’on s’accorde que dans les systèmes démocratiques le peuple est l’ultime source de légitimité, les pratiques qui s’en suivent ont mené à une crise que nombre de théoriciens ont abordée essayant de cerner le concept de légitimité et comment la société s’en sert.
Max Weber voit en la légitimité une relation de domination entre autorité qui domine et sujets dominés. «Il existe en principe trois raisons internes qui justifient la domination, et par conséquent trois fondements de légitimités. Tout d’abord, l’autorité de l’éternel hier… en second lieu l’autorité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d’un individu (charisme)… il y a enfin l’autorité qui s’impose en vertu de la légalité». Weber énumère trois types de légitimité : la domination traditionnelle, la domination charismatique et la domination rationnelle-légale ».[13]
Tout en acceptant la définition de Weber, Habermas déclare que «personne ne met en doute, dans la sociologie actuelle, l’unité de concept de légitimité qui permet de différencier, selon les formes et les contenus de légitimité…Ce qui fait, en revanche, l’objet d’une controverse, c’est le rapport des légitimations à la vérité.[14]
Habermas considère que la légalité doit dériver de la légitimité et non le contraire. «Un système de domination…doit être considéré comme un indice de légitimité… une procédure ne peut toujours légitimer que de manière indirecte, par référence à des instances étatiques qui doivent à leur tour être reconnues ».[15]
Les pouvoirs dans la mise en œuvre des actions publiques deviennent de plus en plus enfermés dans l’univers bureaucratisé et soumis aux dictats des dits experts. La démocratie représentative s’en trouve fragilisée et dépourvue de légitimité : la volonté du peuple n’est plus respectée et l’intérêt général méprisé laissant place à des intérêts douteux qui exercent une influence sur le pouvoir.
La domination et le progrès économique accentuent la crise de la légitimité. L’Etat actuel cède la place à des institutions privées : les agences de notations financières technocratiques et illégitimes, avec la multiplication des autorités administratives indépendantes, les entités informelles, des organisations non gouvernementales, les établissements autonomes, le Fond Monétaire International et la Banque Mondiale[16]. Cela explique en grande partie pourquoi l’action de l’Etat est devenue complexe, technique et incapable à répondre à certaines situations[17].
- Crise de la citoyenneté :
Tout le monde s’accorde que les démocraties traversent un Sahara de civisme et de nombreux symptômes de désintérêts à la citoyenneté sont alarmants. Les gens ne se soucient pas beaucoup des affaires de la communité. L’individualisme gagne du terrain, perte de confiance dans les politiciens, abstention, montée des incivilités, repli sur la sphère privée … sont des manifestations de ce qu’on appelle crise de la citoyenneté.
Le comportement des citoyens a changé ces derniers temps tandis que la classe politique tient un discours de crise qui se focalise sur les individus et non sur les institutions et l’Etat dans son intégralité.
Cette crise de citoyenneté se manifeste surtout dans la participation électorale ce qui donne lieu à un taux d’abstention record et un désintérêt de plus en plus croissant pour la collectivité. Les partis politiques et les syndicats s’en trouvent affectés. Leurs effectifs s’amoindrissent notoirement, l’engagement militant s’essouffle malgré des stratégies encourageante et indicative (l’adhérent partenaire, l’adhérent du projet, le militant associé).[18]
On peut dire avec Dominique Schnapper que «les définitions de la citoyenneté ne se recouvrent pas, elles sont le produit de conflits et de compromis entre conceptions diverses, entre des groupes sociaux opposés, selon les rapports de force qui s’établissent entre eux. La définition a évolué en cours du temps et continue à le faire…, la citoyenneté n’est pas une essence, donnée une fois pour toute, mais une histoire ».[19]
Le mot citoyenneté a été inventé dans la cité grecque. Il caractérisait un membre de la cité qui dispose d’un droit de suffrage dans les assemblées publiques, participe aux décisions, aux lois, à la guerre, la justice et l’administration, bien que les femmes et les esclaves fussent dépourvus de tous ces droits. La révolution Française a repris ce mot par opposition au sujet du roi. Désormais, il désigne l’homme sans notion de hiérarchie chère à la noblesse. De nos jours, le citoyen est une personne qui relève de la protection et de l’autorité d’un Etat, dont il est ressortissant. Il jouit des droits politiques et civiques et doit accomplir des devoirs.
Si l’Etat faillit à son engagement, la citoyenneté sera en crise : «L’apathie, la passivité, l’inaction sont des ennemis de la volonté d’agir, elles l’empêchent, l’annulent, la réduisent à l’inexistence. Ces mots nomment une absence des sentiments ou d’émotions. Ils sont caractéristiques d’un manque de motivation, de goût pour les autres individus et pour la vie sociale. Ce sont les plus grands dangers pour la citoyenneté ainsi contredite dans ses expressions et ses moyens».[20]
Tocqueville a insisté que «sans les ressources économiques et matérielles nécessaires pour le plein exercice de leurs droits, les citoyens sont incapables de participer pleinement aux affaires publiques».[21]
Son appel à l’égalité peut être un des moyens pour remédier à une crise qui ne cessent de s’aggraver. «Les avantages de l’égalité se font sentir dès à présent, et chaque jour on les voit découler de leur source… L’égalité fournit chaque jour une multitude de petites jouissances à chaque homme. Les charmes de l’égalité se sentent à tout moment, et ils sont à la portée de tous… La passion que l’égalité fait naître doit donc être à la fois énergique et générale».[22]
- Critique des représentants et du parlementarisme :
Le faussée qui ne cesse de s’aggraver entre les citoyens et les institutions représentatives remet en cause les fondamentaux de la démocratie. Les gens ne s’intéressent plus comme avant aux élections, aux débats publics. Ils se sentent trahis par les élus et délaissés par le système. Quels reproches assignent-ils donc aux représentants et au parlementarisme ?
- Discrédit des représentants :
De nos jours, les affaires et les scandales politiques sont à la une des médias, et l’image des gouvernants s’en trouve ternis. Désormais, on peut entendre que les élites politiques ne sont que des opportunistes, arrivistes et incapables de changer quoi que ce soit, si ce n’est leur situation et celle de leurs proches.
Les citoyens leurs reprochent de sacrifier les classes populaires au profit des magnats de la mondialisation et d’accumuler les privilèges à l’heure de la marchandisation du savoir, de l’emploi, de la santé, et le démantèlement de l’Etat-nation et des règles de droit.
Les représentants sont incapables de faire face à ce qui nuit aux intérêts des électeurs et à leur quotidien et bien-être : «mondialisation, la révolution numérique, Big Data, objets connectés, intelligence artificielle, robotisation, réseaux sociaux, printemps arabe, crise des subprimes, pollution, effets de serre, diminution programmée des ressources finies, terrorisme, ubérisation de l’économie… Autant de défis devant lesquels la classe politique est désarmée».[23]
On peut affirmer que «toute crise de confiance des citoyens envers leurs institutions à l’encontre des hommes et des femmes investis de la responsabilité de les faire fonctionner et qui tiendrait à l’absence, réelle ou supposée, de clarté dans le rapport de la politique avec l’argent, contribue à miner les fondations de la démocratie de la République».[24]
Regagner la confiance des citoyens exige de sanctionner les élus qui manquent à leur devoir ou accusés de profiter de leur mandat pour servir des intérêts personnels au détriment de l’intérêt général essence de leur mission et des institutions qu’ils représentent. Il faut «mettre en œuvre des mesures anti-blanchiment efficace : les sociétés anonymes et comptes bancaires secrets ne doivent pas servir à blanchir les revenus de la corruption. Ce qui est un enjeu : c’est une question d’intégrité, d’intérêt des investissements et de réputation pour tous les pays».[25]
Il est nécessaire d’adopter de nouvelles normes pour plus de transparence. Il faut mettre l’accent sur les avocats, comptables, agents immobiliers, intermédiaires, financiers et négociants en bien de luxe. Ceux qui rendent possible des achats extravagants avec l’argent mal acquis à l’étranger».[26]
- Crise du parlementarisme :
Selon Carl Schmitt, «la plus ancienne justification du parlement, reprise sans interruption durant des siècles, réside apparemment dans une considération «d’opportunité à proprement parler le peuple dans sa totalité effective devrait décider, comme c’était le cas autrefois, quand tous les membres de la commune pouvaient encore se rassembler sur la place du village, mais pour des raisons pratiques, il est devenu impossible, de surcroît, d’interroger tous et chacun sur son opinion particulière, c’est pourquoi l’on recourt avec raison à une commission élue de personnes de confiance, et c’est précisément le Parlement. C’est ainsi que naît la progression bien connue : le Parlement est une commission du peuple, le gouvernement est une commission du Parlement ».[27]
En l’occurrence, Schmitt donne une grande importance au parlement à l’encontre du gouvernement, mais l’exercice démocratique s’est révélé d’une autre nature : le pouvoir législatif s’est vu déplacé au second degré et le pouvoir exécutif domine désormais l’arène politique.
Les partis politiques ont vu leur rôle s’éroder puis disparaitre. L’individualisme l’emporte sur l’intérêt général.
Désormais, le parlement qui est censé être le lieu efficace de débats de société, et de la production des lois régissant l’action gouvernementale, s’en trouve démunit de ses pouvoirs au profit du gouvernement qui contrôle le jeu par le moyen de règlement, des mass-médias et l’ensemble des organes de l’Etat.
Rosanvallon considère que les élus sont délégués à des tâches purement politiques. Ce n’est plus vouloir pour la nation, comme concevaient les révolutionnaires français, mais leur fonction aujourd’hui est d’être au service de l’exécutif… Les parlements constituent aujourd’hui la fraction dominée, parce que relativement passive, de l’oligarchie gouvernante. En effet, les partis politiques sont désociologisés et bureaucratisés»[28].
Le revirement vers l’exécutif trouve son origine dans la rupture des élus avec l’ensemble de la société. Les hommes politiques sont issus des grandes écoles et la gestion de l’intérêt général s’est professionnalisée au fil du temps.
L’activité des partis politiques s’est vue elle-même réduite à la gestion de l’instant électoral, ce qui a laissé place à d’autres canaux de représentation : société civile, organisation démocratique de proximité, les mouvements contestataires… Ces formes nouvelles d’organisation tendent à contraindre les gouvernements à rendre compte, à écouter les citoyens, à assumer la responsabilité, à être transparent, ce qui couvre un champ d’implication des citoyens».[29]
Le pouvoir législatif s’en trouve aussi concurrencer par d’autres formes de représentation de l’opinion à savoir les sondages, les médias et le Conseil Constitutionnel.[30]
- Quel avenir pour la démocratie représentative :
Bien que la démocratie représentative se soit imposée dans son principe, elle s’est fragilisée dans son fonctionnement au point de parler d’une crise de représentation qui questionne le système libéral en général. L’angoisse et le malaise qui sévissent dans les sociétés modernes et qui se manifestent dans la baisse du pouvoir d’achat, hausse du chômage et des emplois précaires, la répression des manifestations et du droit d’expression… attisent la défiance des citoyens à l’encontre des institutions et des représentants.
Le vote qui était considéré comme le principal moyen de participation s’est vu biaisé et dépourvu de sacralisation qui l’a accompagné pendant des siècles, ce qui a donné lieu à d’autre forme de participation permettant aux citoyens de faire entendre leur revendication et d’instaurer plus de contrôle et de supervision sur le travail des politiciens.
- Emergence de nouvelles formes de participation :
La crise de la démocratie libérale a permis l’émergence du concept démocratie participative et qui entend impliquer les secteurs populaires dont les populations les plus déshérités dans la formation, l’exécution et le contrôle de la gestion des affaires publiques.
Désormais, ce n’est plus l’Etat seul qui doit être démocratique, mais aussi la société, chose irréalisable sans la transformation des relations de pouvoir inégales qui favorisent la minorité dominante. L’Etat est appelé à accompagner et à créer les conditions qui permettent aux citoyens de jouir de tous les droits sociaux, politiques et culturels.
On appelle au référendum[31] comme instrument de participation directe dans la vie politique (L’appel au RIP (Référendum d’Initiative Populaire) en France par exemple lors des manifestations des Gilets Jaunes).
Le droit de pétition est inscrit dans de nombreuses constitutions, et pour développer le contrôle des citoyens sur leurs élus, il est suggéré d’instaurer des procédures permettant de révoquer les élus avant le terme de leur mandat si l’on constate leur «inaction» ou des changements de ligne politique en cours de mandat. Ce recall permet un rééquilibrage du pouvoir entre les représentants et les représentés[32], même-si quelques risques persistent (instrumentalisation, poids des groupes d’intérêts).
Il ne s’agit donc pas de remettre en cause la représentation, mais de l’améliorer en la rendant plus attachée aux aspirations des citoyens, on peut alors parler d’une « démocratie continue»[33].
Les populations ne perçoivent plus simplement la participation dans l’exercice du suffrage mais tendent à intégrer le processus de formation et de mise en œuvre et du suivi des politiques publiques.
- Influence des nouvelles technologies :
Nul ne peut nier aujourd’hui les liens étroits entre politique et médias. La mondialisation exacerbée du champ politique oblige les acteurs politiques à donner une importance majeure à la presse et aux médias. L’irruption de la connexion dans les sociétés modernes et ce qu’elle engendre de nouvelles formes de communication et d’influence dans l’opinion publique est devenue le nouveau champ de bataille entre gouverneurs et gouvernés à propos du principe de la représentation et de l’intervention directe des citoyens dans l’élaboration des lois et dans leur application.
Cette nouvelle recherche d’une démocratie permanente s’appuie sur les nouveaux outils numériques mis à disposition d’une grande partie de la population désormais habituée à collecter des informations sur le net et les réseaux sociaux et à participer à des débats plus au moins éclairés sur l’actualité politique[34].
On peut avancer qu’ici s’exprime “l’attente d’une démocratie postmoderne ne dépendant plus d’un pouvoir technocratique lointain et centralisé mais mobilisant des contributions en réseau, de manière plus horizontale, s’élargissant à la participation du plus grand nombre, du moins de ceux qui savent utiliser internet et disposent du temps et du savoir-faire nécessaire pour s’impliquer réellement sans se contenter d’écouter les autres”[35].
Si les classes dominantes ont réussi à mettre la main sur le paysage médiatique traditionnel, les nouvelles technologies de communication sont devenues le nouveau champ de lutte entre pouvoir et citoyens qui rêvent d’un espace médiatique ouvert et permanent, qui rend la parole au peuple et permet la participation active et le contrôle citoyen sur les élus et sur l’ensemble de l’action publique.
On assiste à une nouvelle guerre démocratique entre le pouvoir d’une minorité de plus en plus oppressante et une communauté qui aspire à se réapproprier l’espace public.
Conclusion:
Pour remédier à la crise actuelle de démocratie représentative ; il faut encourager la participation populaire dans l’action publique, ce qui implique de redonner la parole au peuple, à tous ceux qui qui se sentent déconnectés des affaires publiques, et de raviver chez les citoyens l’envie de participer à la vie politique du pays.
La notion d’espace public doit se réinventer et avoir un sens attrayant permettant aux citoyens de prendre position sur des sujets qui peuvent agir directement sur leur vécu. Les gouvernants doivent cesser de mépriser le peuple et prendre conscience de sa valeur ainsi que de l’importance de ses apports potentiels dans la stabilité et le développement des sociétés.
Un réinvestissement de l’idéal démocratique par l’ensemble de la société et un renouveau de la citoyenneté, comme concept philosophique et opératoire[36]sont essentiels dans le combat d’une vraie représentation.
Les rôles des intellectuels, journalistes, écrivains, auteurs, enseignants, universitaires, groupes d’opinions, associations doivent être critiques et indépendants pour créer une opinion publique qui défend et édifie une démocratie citoyenne. Lorsque l’intellectuel sert le pouvoir ou l’Etat, il détruit l’opinion publique.[37]
L’éducation civique et l’engagement de toute la société dans le processus de redynamisation du débat d’idées autour des institutions représentatives et de la nécessité de réformes susceptibles d’améliorer le système démocratique en crise sont essentiels pour gagner le défi civilisationnel auquel fait face l’humanité.
BIBLIOGRAPHIE :
- Alain Goldberg, Social citizen strip and a reconstructed Tocqueville, American Sociological Review, 2001.
- Alain Touraine, La crise de la représentation politique, Les presses de l’université de Montréal, 1983.
- Alexis De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Pagnerre, 1848, tome 3.
- André Holleaux, L’éclatement et la dilution des pouvoirs, Revue : Politiques et management public, vol. n.9, 1991.
- Anne-Cécile Robert, Par-delà la crise de la démocratie, Le Monde Diplomatique, Octobre 2005.
- Carl Shmitt, Parlementarisme et démocratie, Ed. Seuil, 1988.
- Causey Kelso, “Démasquons les corrompus, cessons d’être un refuge pour les corrompus et leur bien mal acquis, Transparency International, Berlin, 2014. In https://www.transparency.org
- Dominique Rousseau, De la démocratie continue, Paris, La pensée juridique moderne, 1995.
- Rousseau, La démocratie continu: fondements constitutionnels et institutions d’une action continuelle des citoyens, Confluence des droits, 2020, n 2.
- Dominique Rousseau, Radicaliser la démocratie, propositions pour une refondation, Seuil, 2017.
- Dominique Shnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ? Folio actuel inédit, Gallimard, 2000.
- François Borella, les partis politiques dans la France d’aujourd’hui, seuil, 1977.
- Servant et N. Pages, “La procédure de recall aux USA: Un mécanisme de révocation politique au service d’une vision renouvelée de la démocratie représentative”, Blog Jus Politicum, 21 Juillet 2021.
- Haguette Labelle/Présidente Transparency International, extrait d’un discours prononcé lors de la conférence des Caraïbes, 2014, sur le thème “Vers des Caraïbes sans corruption ; éthique, valeurs et moralité”, 19 Mars 2014. In https://www.transparency.org
- J.Rousseau, Du Contrat Social, Lives III.ch, 15, œuvres complètes, vol III, Paris, Gallimard, 1964.
- Joseph-Barthélémy, la crise de la démocratie représentative, Rapport fait à l’Institut international de droit public, Marcel Giard, Paris, 1928.
- Jurgen Habermas, Raison et légitimité : crise de légitimité, problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé, Paris, Payot, 2012.
- Louis Albert Serrut, De la citoyenneté : histoire et émergence d’un concept en mutation, Paris, Ed. Du Cygne, 2016.
- Luc Rouban, La démocratie représentative est-elle en crise? Doc en Poche, 2018, La documentation Française.
- Max Weber, Le Savant et le politique, Paris, Plan, 1959.
- Fatin-Rouge Stéfanini, “Assemblée citoyenne et référendum ; quelques exemples étrangers à méditer”, Pouvoirs, 2020, n.175.
- Mohamed Tozy, élections au Maroc, entre partis et notables (2007-2009), Imprimerie Najah Aljadida, 2010.
- Montesquieu, De l’Esprit des lois, XI, chapitre 6, Ed. R.Dérathé, Paris, 1973, vol1.
- Muriel Le Dieu, La thèse d’une crise de citoyenneté, une construction inopérante, Université Lumière, Lyon II, Séminaire de recherches politiques, Culture, Espace public, 21 Juin 2005.
- Philippe Bloch, Tout va mal, je vais bien, comment vivre dans un monde de merde, Ed. Vantana, 2015, Introduction.
- Philipe Seguin, Politique et argent, Rapport sous la direction de l’assemblée nationale pour la clarification des rapports entre la politique et l’argent, Tome I, Paris, 1994.
- Pierre Muller, L’Etat en action revisité, Pôle Sud, n.21, 2004.
- Rosanvallon, le peuple introuvable, Gallimard, 1998.
- Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement, Seuil, 2015.
[1] « Il y’a une crise dans les idées, dans les esprits et, si je puis ajouter, dans les cœurs. Nos pères ont fait des révolutions pour avoir la démocratie représentative, on est à se demander aujourd’hui qui verserait son sang pour conserver des chambres, des députés, des sénateurs. La foi s’en va ; elle est morte ». Joseph-Barthélémy, la crise de la démocratie représentative, Rapport fait à l’Institut international de droit public, Marcel Giard, Paris, 1928, p.6.
[2] Luc Ruban, la démocratie représentative est-elle en crise ? La documentation Française.
[3] In P.Rosanvallon, le peuple introuvable, Gallimard, 1998.p 11 in The Paper of Alexander Hamilton, vo.1, 1768-1778, New York, Colombia University, Press, 1961, p.255.
[4] Ibid, p.11.
[5] J.J.Rousseau, Du Contrat Social, Lives III.ch, 15, œuvres complètes, vol III, Paris, Gallimard, 1964, p.134.
[6] Montesquieu, De l’Esprit des lois, XI, chapitre 6, Ed. R.Dérathé, Paris, 1973, vol1,p 179.
[7] Ibid,P.7.
[8] Dominique Rousseau, Radicaliser le démocratie, propositions pour une refondation, Seuil, 2017, p.25.
[9] Montesquieu, De l’Esprit des lois, op. Cité, p.18.
[10] Les partis politiques, dans les circonscriptions d’une grande taille, présentent des listes de candidats et non un candidat par circonscription.
[11] Mohamed Tozy, élections au Maroc, entre partis et notables (2007-2009), Imprimerie Najah Aljadida, 2010, p.48.
[12] François Borella, les partis politiques dans la France d’aujourd’hui, seuil, 1977, p.11.
[13] Max Weber, Le Savant et le politique, Paris, Plan, 1959, p.14.
[14] Jurgen Habermas, Raison et légitimité : crise de légitimité, problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé, Paris, Payot, 2012, p.13.
[15] Ibid. p.135.
[16] André Holleaux, L’éclatement et la dilution des pouvoirs, Revue : Politiques et management public, vol. n.9, 1991, p.52.
[17] Pierre Muller, L’Etat en action revisité, Pôle Sud, n.21, 2004, p.39.
[18] Muriel Le Dieu, La thèse d’une crise de citoyenneté, une construction inopérante, Université Lumière, Lyon II, Séminaire de recherches politiques, Culture, Espace public, 21 Juin 2005, p.9.
[19]Dominique Shnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ? Folio actuel inédit, Gallimard, 2000, p.16.
[20] Louis Albert Serrut, De la citoyenneté : histoire et émergence d’un concept en mutation, Paris, Ed. Du Cygne, 2016, p.37.
[21]Alain Goldberg, Social citizen strip and a reconstructed Tocqueville, American Sociological Review, 2001, p.294.
[22] Alexis De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Pagnerre, 1848, tome 3, p.190.
.
[23] Philippe Bloch, Tout va mal, je vais bien, comment vivre dans un monde de merde, Ed. Vantana, 2015, Introduction.
[24] Philipe Seguin, Politique et argent, Rapport sous la direction de l’assemblée nationale pour la clarification des rapports entre la politique et l’argent, Tome I, Paris, 1994, p.13.
[25] Haguette Labelle/Présidente Transparency International, extrait d’un discours prononcé lors de la conférence des Caraïbes, 2014, sur le thème “Vers des Caraïbes sans corruption ; éthique, valeurs et moralité”, 19 Mars 2014. In https://www.transparency.org
[26]Causey Kelso, “Démasquons les corrompus, cessons d’être un refuge pour les corrompus et leur bien mal acquis, Transparency International, Berlin, 2014. In https://www.transparency.org
[27] Carl Shmitt, Parlementarisme et démocratie, Ed. Seuil, 1988, p.41.
[28] Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement, Seuil, 2015, p.27.
[29]Ibid. p.37.
[30]Dominique Rousseau, De la démocratie continue, Paris, La pensée juridique moderne, 1995, p.11.
[31] M.Fatin-Rouge Stéfanini, “Assemblée citoyenne et référendum ; quelques exemples étrangers à méditer”, Pouvoirs, 2020, n.175, p.78-79.
[32]G. Servant et N. Pages, “La procédure de recall aux USA: Un mécanisme de révocation politique au service d’une vision renouvelée de la démocratie représentative”, Blog Jus Politicum, 21 Juillet 2021.
[33]D. Rousseau, La démocratie continu: fondements constitutionnels et institutions d’une action continuelle des citoyens, Confluence des droits, 2020, n 2.
[34] Luc Rouban, La démocratie représentative est-elle en crise? Doc en Poche, 2018, La documentation Française, p.9.
[35]Luc Rouban, Ibid. p.10.
[36]Anne-Cécile Robert, Par-delà la crise de la démocratie, Le Monde Diplomatique, Octobre 2005.
[37]Alain Touraine, La crise de la représentation politique, Les presses de l’université de Montréal, 1983, p.134.



