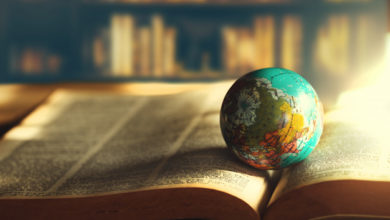Cinematic Language: Thresholds, Characters, and Passions in Moroccan Cinema ; A Study of the Film “Deserts” by Faouzi Bensaïdi
Le langage Cinématographique : Les seuils, les personnages et les passions dans le cinéma marocain ; Étude sur le film « Déserts » de Faouzi Bensaïdi
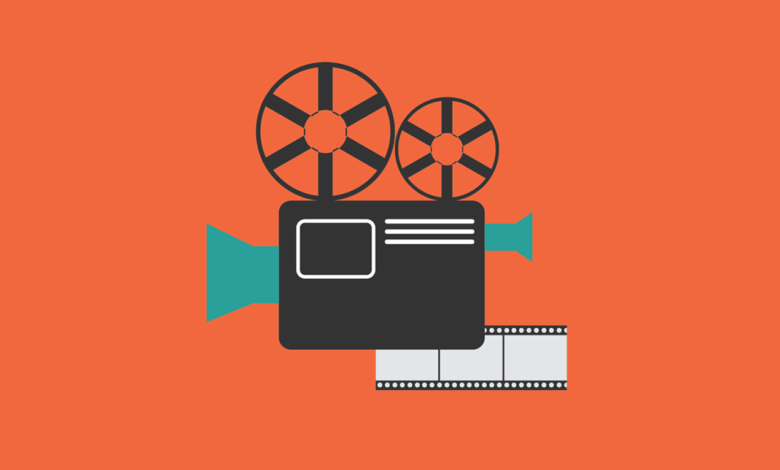
Prepared by the researche : Noureddine Mhakkak*1 & Sanae Ghouati2 – 1&2 Ibn Tofaïl University, Kenitra, Morocco
DAC Democratic Arabic Center GmbH
Arabic journal for Translation studies : Thirteenth Issue – October 2025
A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin
:To download the pdf version of the research papers, please visit the following link
Orcid iD 1 : 0009-0005-3669-3034
Orcid iD 2 : 0009-0009-1344-1220
| Published | Accepted | Received |
| 24/10/2025 | 12/09/2025 | 08/05/2025 |
| : 10.63939/ajts.a4cjgg17 |
| Cite this article as: Mhakkak, N., & Ghouati, S. (2025). Cinematic Language: Thresholds, Characters, and Passions in Moroccan Cinema. Arabic Journal for Translation Studies, 4(13), 176-186. https://doi.org/10.63939/ajts.a4cjgg17 |
| Abstract |
| The feature film Déserts, directed by Moroccan filmmaker Faouzi Bensaïdi, displays powerful aesthetic qualities, both in terms of its formal structure and the thematic depth it explores. The film engages with what the director himself refers to as “conflicts between values, traditions, and humanity in the face of the brutality of the modern world.” It exemplifies an avant-garde cinematic vision that elevates cinema into a space of artistic refinement while simultaneously conveying profound humanistic messages. These messages invite the viewer to perceive the world through a more nuanced and empathetic lens.
Accordingly, the filmic trajectory is reinforced by a mise-en-scène that respects the integrity of artistic creation, while also committing itself to the critical examination of social dynamics. These are effectively depicted through a carefully constructed cinematic narrative. In this regard, the film’s portrayal of both positive and negative moments reflects a broader system of social values — one that attributes meaning to objects and experiences based on collective consensus. Such a system emerges from events that either frustrate or fulfill the individual or the collective, whether on a psychological, economic, or social level. This mechanism is rendered in the film with notable clarity and precision. |
| Keywords: Cinema, Language, Characters, Filmic Trajectories, Temporality & Spatiality |
|
| Publié le | Accepté le | Reçu le |
| 24/10/2025 | 12/09/2025 | 08/05/2025 |
| : 10.63939/ajts.a4cjgg17 |
| Citez cet article : Mhakkak, N., & Ghouati, S. (2025). Le langage Cinématographique : Les seuils, les personnages et les passions dans le cinéma marocain. Arabic Journal for Translation Studies, 4(13), 176-186. https://doi.org/10.63939/ajts.a4cjgg17 |
| Résumé |
| Le film cinématographique « Déserts » du réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi possède des qualités esthétiques très fortes soit au niveau structural, soit au niveau des thèmes qui abordent « les conflits entre les valeurs, les traductions et l’humanité face à la brutalité du monde moderne » selon l’expression du réalisateur lui-même .Un film qui appartient à une vision cinématographique avant-gardiste, qui rend le monde du cinéma, un monde plein de beauté artistique, mais aussi plein des messages humanistes qui poussent les spectateurs à voir le monde autrement, à le voir d’une façon compréhensive. De ce fait, le parcours filmique se double d’une mise en scène qui respecte le travail artistique mais qui s’intéresse parallèlement à traiter les effets sociaux et à les monter à travers le récit filmique d’une manière bien structurée. Subséquemment, les moments négatifs ou positifs montrés dans le film, renvoient « au système de valeurs social qui valorise ou dévalorise un objet selon un consensus social. Il provient d’un événement qui fruste ou gratifie l’individu ou la collectivité, psychiquement, économiquement ou socialement. ». Ce qui se présente dans ce film avec tant d’efficacité. |
| Mots clés: Cinéma, Personnages, Parcours filmiques, Temps et Espace |
|
Introduction
Le cinéma est un art qui dépasse presque tous les autres arts qui ont existé avant lui, puisqu’il a possédé à travers son développement, la possibilité de les faire réunir dans un film. Ainsi, le cinéma, en utilisant les images mouvantes avec le son, et en essayant de représenter les effets du réel, d’une manière ou d’une autre, il nous offre la possibilité de voir le monde autrement, d’une façon magique qui se situe entre la réalité et le rêve en même temps.
Et puisque le cinéma est un art de spectacle, comme le théâtre, et surtout le théâtre filmé, selon André Bazin, dans son livre « Qu’est-ce que le cinéma » (Bazin, 2011), il est considéré en tant qu’art majeur qui peut séduire les spectateurs. En plus, le cinéma étant, selon André Bazin, « par son essence une dramaturgie de la nature, il ne peut y avoir cinéma sans construction d’un espace ouvert, se substituant à l’univers au lieu de s’y inclure. » (Bazin, 2011, p. 164). Et quand on parle de l’espace, cela nous mène bien évidemment à parler du temps, et des personnages. Surtout que dans la majorité des cas, « aller au cinéma, c’est aller voir un film qui raconte une histoire. » (Aumont et al., 1983, p. 63). Et attendu que « tout film est un film de fiction » (Aumont et al., 1983, p. 70), et « le propre du film de fiction est de représenter quelque chose d’imaginaire, une histoire. », nous allons étudier le film « Déserts » du réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, en focalisant d’abord le parcours narratif de son histoire filmique d’une part et d’autre part en analysant la structure de ses personnages et leurs passions, sans oublier de temps à autre de traiter les grands thèmes abordés dans ce film.
- Les seuils du film et leurs significations
D’abord on peut considérer l’affiche du cinéma en tant qu’un miroir du film, selon l’expression de Claude Racine (Racine, 1989). Car à travers cette affiche le spectateur peut entrer dans le monde du film d’une façon ou d’une autre. Puisqu’elle contient les éléments les plus frappants dans le film, tels les personnages, les lieux, et les signes du temps.
En plus, dans l’affiche du cinéma, on trouve aussi le nom du réalisateur et le titre du film. Ainsi, une affiche efficace « doit être vite mémorisable et donner très précisément une idée des codes du film. D’un coup d’œil, on doit pouvoir identifier de quel type de film il s’agit. Si on trahit les codes en mettant autre chose, eh bien on ne touche pas le public concerné ! », d’après le point de vue de Benjamin Baltimore (Baltimore, as cited in Racine, 1989, p. 41). D’où, et selon J.M. Monnier, l’affiche de cinéma « doit être populaire, c’est-à-dire compréhensible par tous, suggestive par une synthèse simplifiée du sujet » (Monnier, 1946, as cited in Maison des Arts d’Antony, 2022).
Pour l’affiche du film « Déserts » du réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, on remarque d’abord dès la première vue que cette affiche contienne dans son image, des signes linguistiques, c’est-à-dire les mots de la langue, qui désignent le genre du film « Un western fascinant », le titre du film « Déserts », et le nom du réalisateur « Faouzi Bensaïdi », et des signes iconiques qui désignent bien sûr toutes les formes de l’image qui se trouvent dans cette affiche elle-même.
Selon le genre de ce film, c’est-à-dire « Western », on est obligé de penser d’abord aux films américains, car le « Western » est un film américain « dont l’action se situe dans le Far West américain et qui illustre certains épisodes de la conquête des terres de l’Ouest sur les Indiens » suivant le dictionnaire Larousse (Larousse.fr). Et on trouve souvent dans ce genre de films des actions très mouvementées, des poursuites, et bien évidements des bagarres entre les personnages. Et en conséquence de cela, le spectateur va penser que le film « Déserts » en tant qu’un film de « Western », va être un film plein des actions, des bagarres et des poursuites entre ses personnages. Et surtout que ce film est désigné par celui qui a créé son affiche comme un film fascinant même. Mais pour son réalisateur Faouzi Bensaïdi, ce film dépasse son genre de « Western », car selon lui, « C’est un film burlesque, un western quasi-mythologique, un conte et une satire » (Bensaïdi, as cited in Sauphie, 2023).
En plus, on trouve que le titre de ce film désigne l’espace du désert, mais en portant l’empreinte du pluriel, c’est-à-dire, il ne parle pas d’un seul désert bien défini, mais il parle des plusieurs déserts, surtout que ces déserts mêmes sont non déterminés, soit à propos de la langue ou à propos de leurs significations qui sont restées ouvertes à toutes les interprétations. De cette façon-là, nous nous sommes préparés, en tant que spectateurs, à voir le film dès son titre comme un film qui « raconte les déserts des êtres, de leurs vies spirituelle et intérieure, mais aussi de leur existence quotidienne » (Bensaïdi, as cited in Sauphie, 2023).
C’est vrai que le sens du mot « désert » prend tant de significations, on trouve dans le dictionnaire des symboles, ceci : « le désert comporte deux sens symbolique essentiels : c’est l’indifférenciation principielle, ou c’est l’étendue superficielle, stérile, sous laquelle doit être cherchée la réalité » (Chevalier & Gheerbrant, 1999, p. 349).
Ainsi, quand le spectateur regarde cette affiche pour la première fois, et avant de voir le film, il espère que ce film traite toutes ces choses-là, qui viennent à son esprit. Ce qui signifie que ce titre est un titre qui est très attirant par son mystère voulu et par son ambigüité. D’où, on constate que le réalisateur en tant que scénariste aussi, a pu choisir un titre qui peut selon lui attirer l’attention du public ou au moins lui fait pousser d’aller au cinéma pour voir le film. Puisque Selon Gérard Genette, « le public, ou, comme on dit plus précisément en anglais, l’audience d’une représentation théâtrale, d’un concert ou d’une projection cinématographique, est bien la somme des personnes présentes, et donc en principe des spectateurs et/ou des auditeurs – en principe, parce que certaines des personnes présentes peuvent ne l’être que physiquement et, pour des raisons diverses, manquer à voir ou à entendre. » (Genette, 1987, p. 45).
Pour le nom du réalisateur, en tant qu’un seuil aussi qui représente le film, on trouve dans l’affiche juste après le titre, le nom de « Faouzi Bensaïdi ». Et quand on lit ce nom -là, on voit que ce réalisateur, surtout pour ceux qui connaissent bien le champ cinématographique marocain, est bien connu dans ce champ en tant qu’un réalisateur qui appartient d’une manière ou d’une autre à la nouvelle vague, et qui a réalisé cinq films (longs-métrages) avant celui-ci « Déserts ». Ces films sont les suivants « Mille mois » en 2003, « WWW. What A Wonderful World » en 2006, « Mort à vendre » en 2011, « Volubilis », et « Jours d’été » en 2022, Ce qui donne l’envie aux spectateurs cinéphiles à le voir et à le découvrir.
Passons maintenant aux signes iconiques de cette affiche, on voit d’abord un grand arbre, et tout près de lui deux hommes dans un état de fatigue pour ne pas dire dans un état de dépression presque totale, et une voiture marronne (la nature et l’aventure) / rouge. (Couleur du sang, de la passion, du sentiment).
La signification de l’arbre est très claire, on le trouve dans le dictionnaire des symboles de la sorte : « symbole de la vie en perpétuelle évolution, en ascension vers le ciel, il évoque tout le symbolisme de la verticalité » (Chevalier & Gheerbrant, 1999, p. 62), et pour cette raison-là, que les deux hommes ont essayé de se mettre tout près de cet arbre, pour qu’il les protège contre la pluie qui était en train de tomber d’une façon inattendue. Pour la voiture, elle symbolise le voyage, elle est un moyen de transport, un moyen pour changer les anciens lieux, et trouver des lieux nouveaux. Et puisqu’elle est marron / rouge, elle symbolise la quête de la nouvelle vie, la quête de la joie et de la paix aussi, loin des malheurs vécus.
- Les personnages et les actions fonctionnaires
Selon Tzvetan Todorov, la critique du XXème siècle « a voulu réduire le problème du personnage à celui de la vision ou du pont de vue. Confusion d’autant plus facile, que depuis Dostoïevski et Henry James, les personnages sont moins des êtres « objectifs » que des consciences des « subjectivités » : à la place de l’univers stable de la fiction classique, on trouve une série de visions, toutes également incertaines, qui nous renseignent bien plus sur la faculté de percevoir et de comprendre, que sur une prétendue « réalité ». » (Ducrot & Todorov, 1972, pp. 86-87). Et cela nous mène en étudiant les personnages dans le film « Déserts » à ne pas oublier leur point de vue à propos des événements qui se déroulent ou même à propos les espaces ou le temps qui construisent le récit filmique, surtout que ces personnages eux-mêmes se définissent par leur « sphère d’action » selon Vladimir Propp, « c’est-à-dire par le faisceau de fonctions qu’ils remplissent à l’intérieur de l’histoire. » (Aumont et al., 1983, p. 92).
De ce fait, et dès le commencement du film « Déserts », on trouve deux personnages Mehdi et Hamid qui sont en train de changer leurs points de vue à propos du chemin qui vont le prendre pour arriver à l’endroit désigné. Mais ce changement de points de vue, il est presque devenu une sorte de bagarre verbale, puisque chacun d’eux ne veut pas entendre le point de vue de l’autre. Ce qui nous montre en tant que spectateurs que ces deux personnages ont des caractères différents. Et cela va les mène soit vers l’échec dans leur travail ou soit vers la séparation. Mais ce qui est arrivé après, c’est que l’un deux, Hamid, malgré son point de vue personnel, il possède une faible personnalité, ce qui lui oblige à suivre l’avis et la décision finale de l’autre, Mehdi, dont la personnalité est très forte que sa personnalité. Mais les deux, et d’après la signification de leur nom, ils sont de très bons gens. Car le nom de Hamid signifie en langue arabe, celui qui est « digne de louange », et le nom de Mehdi, signifie dans la même langue celui qui est « guidé sur le droit chemin ». Ainsi, le nom désigne souvent le destin de celui qui l’emporte.
Juste après, on voit ces deux personnages filmiques Mehdi et Hamid dans un hôtel, l’un est dort tranquillement tandis que l’autre n’a pas trouver le sommeil idéal pour lui. Ce qui nous montre la personnalité de chacun d’eux. Mehdi est souvent énervé par le travail qu’il le fait alors que Hamid prend les choses avec une légèreté presque totale.
De ce fait, et en suivant le déroulement des évènements dans le film, on comprend que le récit filmique nous présente la vie de ces deux personnages dans leur travail, et même dans leur vie personnelle. Et puisque « tout récit met en place deux temporalités : celle des événements racontés et celle qui tient à l’acte même de raconter. Dans l’univers construit par la fiction, la diégèse un événement peut se définir par la place qu’il occupe dans la chronologie supposée de l’histoire, par sa durée et par le nombre de fois où il intervient» (Gaudreault & Jost, 1990, p. 104).
Pour leur vie en plein travail, le récit filmique nous les montre en tant que deux « amis de longue date » (unifrance.org), qui « travaillent pour une agence de recouvrement. Ils sillonnent les villages du grand Sud marocain dans leur vieille voiture et se partagent des chambres doubles dans des hôtels miteux. Ils ont exactement la même taille, les mêmes costumes-cravates, les mêmes chaussures. Payés une misère, ils essaient de jouer aux durs pour faire du chiffre. » (unifrance.org)
C’est vrai que leur travail est très difficile pour eux, surtout que les deux, malgré leur besoin d’argent, ils ne traitent pas les mauvais payants, selon l’expression même de leur patronne de l’agence, avec dureté. Car ils essayent toujours de les aider de trouver une solution convenante, ce n’est pour l’agence, mais pour ces gens-là, qui sont très pauvres.
Le film s’articule autour de trois pôles : l’espace du désert, les deux employés et les habitants de ce vaste désert. Ainsi, le désert comme les deux personnages Mehdi et Hamid et même les habitants sont envahis, fouillées par l’œil de la caméra, soit à travers les différents plans cinématographiques, tels le plan général, le plan d’ensemble, le plan moyen et le gros plan.
De ce fait, on voit que les personnages deviennent très liés avec l’espace filmique, et surtout l’espace des déserts. Puisque cet espace est devenu lui-même un personnage filmique plein de signification.
Revenons maintenant à la vie personnelle des deux personnages du film, Mehdi Attaf et Hamid Dergoune. Pour Mehdi, il est père de famille. Il vit avec sa deuxième femme après le divorce avec la première. Il vit dans un lieu familial plein de problèmes, surtout que sa deuxième femme lui propose de se débarrasser de sa fille unique, soit en rendant la fille à sa mère, soit en lui donnant à une famille riche. Et lorsqu’il a refusé de faire cela, elle lui menace de quitter le foyer conjugal. Ces problèmes familiaux lui rendent souvent triste et en plein colère, parfois contre son ami et collègue Hamid, et parfois contre lui-même. Ainsi, la scène familiale montre d’une façon cinématographique les problèmes sociaux, et cette scène douloureuse exige la disparition d’un membre de la famille pour Mehdi, soit sa fille, soit sa femme. Ce qui rend malheureux. Et tous ces problèmes familiaux sont liés bien sûr avec sa situation financière. Car pour lui, il y a toujours un manque d’argent pour gérer bien les choses de la famille. D’où, la liaison de la scène familiale avec les autres scènes du travail, nous montre, la fragilité de la personnalité de Mehdi et ses souffrances qui n’ont pas de fin durant le déroulement du récit filmique, sauf à la fin du film, où il va voir un fil de lumière qui va lui paraitre grâce à l’argent qui va obtenir de l’homme évadé, avec son ami Hamid.
Pour Hamid, lui aussi, il vit dans une situation sociale très difficile, car il veut se marier le plus tôt possible avec la jeune femme qui a pu choisir, mais à cause de manque d’argent, le mariage a été retardé d’une année à l’autre. Mais malgré cela, il est moins malheureux que son ami Mehdi, car il possède un caractère simple qui lui faire accepter son destin sans aucune révolte, en laissant le temps au temps, et en pensant que sa chance viendra surement un jour.
On voit bien videment d’autres personnages dans le film, qui leur chemin se coïncide avec celui de Mehdi et Hamid, d’une façon ou d’une autre, et cela fait enrichir le parcours narratif de ce film, on peut citer à titre d’exemple les membres de la famille de la fiancée de Hamid, et la femme de Mehdi, et en plus la fille de Mehdi, elle aussi, comme on peut citer aussi les habitants de ces lieux désertes.
Ces personnages filmiques ont été bien interprétés par des bons acteurs tels Fehd Benchemsi (Mehdi Attaf), Abdelhadi Talbi (Hamid Dergoune), Rabii Benjhaile (L’évadé), Hajar Graigaa (Selma / Hadda), Mohamed Choubi (Le père de Naïma), Nezha Rahile (La patronne), Abdelghani Sannak (Le Moqadem), Nordine Saaden (Le barman), Mohamed Hmimsa (Le jeune paysan), Brahim Khai (Le père de Hadda), Zhor Slimani (Hlima), Abdellah Chicha (Rabah), Faouzi Bensaïdi (L’épicier) et bien d’autres.
- les passions et la mise en discours de la subjectivité
Hernan Parret, remarque dans son livre sur les passions, que « la construction de la mise en discours des passions tiendra compte des oppositions paradigmatiques esquissées au cours de ce rappel de l’histoire des théories des passions » (Parret, 1986, p. 49), et cela nous mène à étudier les passions qui se manifestent dans ce film à travers ses personnages et leurs relations , avec une méthode scientifique qui n’est que la sémiotique de la subjectivité , puisque chaque passion est une manifestation subjective. Ainsi, «la sémiotique de la subjectivité se fera d’abord par une réévaluation des propriétés du sujet manifesté dans et par son discours, ou par la réévaluation du parlier « superficiel » du modèle sémiotique » (Parret, 1986, p. 50).
Et puisqu’il y a tant des passions qui se manifestent d’une façon ou d’une autre dans ce film, nous allons nous concentrer sur deux grandes passions, la passion de l’amour et celle de la haine.
Ainsi, le champ, ou plutôt le territoire de la passion de l’amour est très vaste, il se trouve dans l’espace familial comme il se trouve dans l’espace du travail. De ce fait, on trouve la passion de l’amour s’est déclaré clairement dans la relation entre le personnage de Hamid, et de celui de sa fiancée. Lui, il l’aime tellement, et il fait de son mieux pour l’épouser malgré sa situation financière très difficile. Et pour elle, c’est presque la même chose, car elle l’aime aussi, et essaye de le suivre dans son chemin et d’être sa femme à tout prix. Tandis que la passion de l’amour dans le cas de son ami et collègue Mehdi, est une passion malheureuse, puisque lui aime tellement sa nouvelle femme, mais elle, elle ne l’aime pas, elle veut tout simplement d’être une femme mariée comme les autres femmes, sans penser à lui ou à sa situation financière très ardue. C’est pour cela, qu’elle veut le quitter, en lui déclarant cela avec dureté.
C’est vrai que la manifestation de cette passion dans ces deux relations est tout à fait normale, car elle n’a pas dépassé le stade de l’amour ordinaire, malgré que Mehdi vive tout seul à cause d’elle dans le désespoir et puis dans la tristesse presque totale même.
Mais la manifestation de cette passion de l’amour d’une façon éclatante, elle se voit dans la relation entre l’évadé et sa bien-aimée, car il a fait tout pour le reprendre, malgré qu’elle soit devenue une femme d’un autre. Ainsi, dans la relation de cet homme évadé et recherché par la police, avec la femme qu’il aime, se trouve tellement de la folie. On peut voir même dans son parcours narratif et sa façon de réagir avec les gens de son douar, une histoire qui ressemble aux histoires des cobayes, surtout avec son cheval, sa façon baroque de voir le monde, et son amour fou pour la femme qu’il a choisi avec tout son cœur. De ce fait, la passion de l’amour se manifeste dans la relation de cet évadé avec cette femme, d’une manière extraordinaire. D’où, le plus souvent dans ce genre de relation amoureuse, « l’abîme menace et la passion s’en va danser au bord du gouffre. Les deux valseurs portent des dossards. L’un celui de l’amour, l’autre celui de la mort. » (Avril, 2006, p. 18). D’où, la passion de l’amour de cet homme-là le mène enfin vers le chemin de la mort lui-même.
De l’autre côté, on voit que la passion de la haine se présente dans ces relations de ces personnages eux-mêmes. On trouve que Mehdi et Hamid, et surtout Mehdi, sentent une passion de haine envers leur patronne. Car cette patronne leur oblige d’être sévères contre des gens très pauvres pour leur faire rendre l’argent prêté de l’agence. Cette passion de haine est tout à fait approuvable car elle ne dépasse pas le stade normal, et elle ne devient pas une sorte de caractère habituelle pour eux.
Le récit filmique est plein de ce genre de passions, et grâce à elles-mêmes que les personnages filmiques peuvent continuer leur vie d’une façon presque régulière en espérant toujours que leur chance attendue arrive dans un jour.
Conclusion
Ainsi, on peut dire que ce film cinématographique « Déserts » du réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi possède des qualités esthétiques très fortes soit au niveau structural, soit au niveau des thèmes qui abordent « les conflits entre les valeurs, les traductions et l’humanité face à la brutalité du monde moderne » selon l’expression du réalisateur lui-même (e-taqafa.ma). Un film qui appartient à une vision cinématographique avant-gardiste, qui rend le monde du cinéma, un monde plein de beauté artistique, mais aussi plein des messages humanistes qui poussent les spectateurs à voir le monde autrement, à le voir d’une façon compréhensive. De ce fait, le parcours filmique se double d’une mise en scène qui respecte le travail artistique mais qui s’intéresse parallèlement à traiter les effets sociaux et à les monter à travers le récit filmique d’une manière bien structurée. Subséquemment, les moments négatifs ou positifs montrés dans le film, renvoient « au système de valeurs social qui valorise ou dévalorise un objet selon un consensus social. Il provient d’un événement qui fruste ou gratifie l’individu ou la collectivité, psychiquement, économiquement ou socialement. » (Eizykman, 1976, p. 186). Ce qui se présente dans ce film avec tant d’efficacité.
Pour terminer, il faut préciser que le réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, en utilisant des images, des sons, des découpages, et un point de vue bien précis, il a voulu créer un film cinématographique qui n’appartient qu’à sa pensée personnelle, à sa manière de création et bien évidement à sa réflexion artistique envers le monde qui l’entoure.
Références
- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., & Vernet, M. (1983). L’esthétique du film. Nathan.
- Avril, N. (2006). Dictionnaire de la passion amoureuse. Éditions du Plon.
- Bazin, A. (1958–1962). Qu’est-ce que le cinéma ? Éditions du Cerf.
- Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (1999). Dictionnaire des symboles. Éditions Robert Laffont / Éditions Jupiter.
- Ducrot, O., & Todorov, T. (1972). Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Éditions du Seuil.
- Eizykman, C. (1976). La jouissance-cinéma. Union générale d’éditions.
- Gaudreault, A., & Jost, F. (1990). Le récit cinématographique. Nathan.
- Genette, G. (1987). Seuils. Éditions du Seuil.
- Western. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/western/82772
- Maison des Arts d’Antony. (2022). L’affiche du cinéma – Quelques jalons. https://www.maisondesarts-antony.fr/wp-content/uploads/2022/07/Laffiche-de-cinema-Quelques-jalons.pdf
- Parret, H. (1986). Les passions : essai sur la mise en discours de la subjectivité. Pierre Mardaga.
- Racine, C. (1989). Rencontre avec Yvan Adam et Benjamin Baltimore : L’affiche de cinéma, miroir du film. 24 images, (42), 41-45.
- Sauphie, E. (2023, 21 septembre). Rencontre avec Faouzi Bensaïdi, à propos de son film “Déserts”. Jeune Afrique. https://www.jeuneafrique.com/1482909/culture/faouzi-bensaidi-dans-deserts-il-est-question-de-filmer-de-petites-gens-face-au-vide/
- Déserts [Fiche technique et synopsis]. https://www.unifrance.org/film/54934/deserts
- E-Taqafa. (2024, 8 mai). Le long-métrage “Déserts” de Faouzi Bensaïdi. http://bit.ly/3KZcZlU