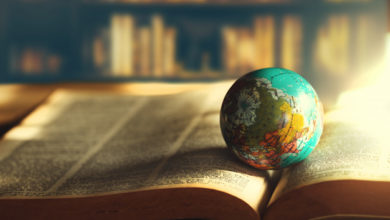The gaming virtual: between the “real” and unreal
Le virtuel vidéoludique : à l’épreuve du « réel » et de l’irréel

Prepared by the researche : Asma Manai – University of Manouba- Tunisia
Democratic Arabic Center
Journal of Social Sciences : Thirty-second Issue – June 2024
A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin
:To download the pdf version of the research papers, please visit the following link
Abstract
video game is a complex design product distinguished by a particular use and conception. Indeed, the using process of such a product is embodied within the gaming virtual space, which places the user-gamer into a link between the “real” world, as in the physical world, and the “virtual” world, as in the world of play where the player “exists” through an immersive projection. This link is present within the virtual space in-game, which places the user-gamer in a triad real-virtual-unreal. However, a question is in order: if the using process of gaming virtual space encompasses an “in-between” immersion between the physical real and the imaginary unreal, should we consider that designing this in-game virtual is pivoting between the real-unreal as a consequence? How is this virtual designed: generating from the real or from the unreal?
Résumé
le jeu vidéo est un produit design complexe qui se distingue par un usage et une conception particulière. En effet, le processus d’usage de ce produit est encadré par l’espace virtuel vidéoludique, ce qui met l’usager-gamer en articulation entre le monde « réel », dans le sens du monde palpable et le monde « virtuel », dans le sens du monde du jeu où il « existe » à travers une projection immersive. Cette articulation se prononce dans le cadre de l’espace virtuel vidéoludique, ce qui met l’usager-gamer dans un triptyque réel-virtuel-irréel. Cependant, une question se soulève : si l’usage du virtuel vidéoludique implique une immersion « entre-deux » qui s’articule entre le réel palpable et l’irréel imaginaire, doit-on conclure que la conception de ce virtuel vidéoludique s’articule autour de ce binôme réel-irréel ? Comment se conçoit donc ce virtuel : à partir du réel ou de l’irréel?
Introduction
Le jeu vidéo est un produit design contemporain particulier par sa complexité. En effet, outre son côté ludique, il offre un alliage de sous-produit design en perpétuelle interaction, formant un système-game qui reflète sa richesse mais aussi l’implication de plusieurs acteurs participants dans sa conception. Nous citons comme exemple de sous-produit le son, l’image en tant qu’interface graphique interactive, et l’espace en tant que cadre spatio-temporel de la narration du jeu. Nous nous intéressons particulièrement à cet espace non seulement en tant que composante conceptuelle mais aussi en tant que composante expérientielle dans l’usage de ce produit design particulier.
En effet, cet intérêt a été tout d’abord éveillé par l’observation que nous avons faite sur un échantillon divers de jeux vidéo provenant de genres vidéoludiques différents. Nous avons remarqué que l’espace présente un élément essentiel dans l’avènement d’une expérience gaming. C’est-à-dire nous avons trouvé que l’attachement de l’usager-gamer accroît lorsque la conception de l’espace présente un certain développement. Ceci s’explique par le fait que l’usager-gamer se trouve confronté à une situation « presque réelle » dans le sens où il a la possibilité d’explorer un espace complexe qui présente des « intrigues » et donc stimule le sens de l’exploration du gamer, chose qui se traduit par une « appréciation » du jeu et donc par l’avènement d’une expérience.
En outre, nous avons remarqué une autre particularité de ce produit design, et particulièrement l’espace, élément essentiel dans le système-game ; l’usage du jeu vidéo est essentiellement virtuel. C’est-à-dire qu’il implique une projection dans un monde virtuel, ainsi qu’une interaction avec l’espace et les autres composantes du jeu. Cette virtualité qui qualifie ce produit est au centre de son usage ainsi que sa conception : en effet, ceci implique la construction d’un monde en 3D, d’une narration et de personnages virtuels. Par conséquent, la virtualité est une caractéristique principale au jeu vidéo.
À ce propos, nous nous sommes posé des questions par rapport à cette virtualité, concernant surtout l’espace, en rapport avec deux volets : la conception et l’usage. Plus particulièrement nous nous posons des questions par rapport à la virtualité de l’usage de cet espace, et à la conception même de cette virtualité : Comment se conçoit l’espace virtuel vidéoludique ? Et comment se fait son usage dans l’articulation de ce virtuel avec le monde réel ? En outre, qu’est ce qui caractérise la virtualité vidéoludique par rapport au réel et l’irréel ? Peut-on affirmer que le virtuel vidéoludique se compose essentiellement du réel, inspiré du monde palpable, ou de l’irréel, provenant de l’Imaginaire impalpable ?
Au cours de ce travail, nous allons tout d’abord définir ce que nous entendons par virtuel vidéoludique, réel, irréel et Imaginaire. Nous allons essayer après de faire l’esquisse de la conception de ce virtuel vidéoludique à l’épreuve du réel et de l’irréel. Ensuite nous clarifierons l’articulation de l’usage de cet espace virtuel entre le réel palpable et l’irréel impalpable. Ceci se fera à travers l’étude de plusieurs exemples de jeux vidéo provenant de genres vidéoludiques différents afin de dresser le schéma conceptuel de l’espace virtuel vidéoludique.
Le virtuel, le réel et l’irréel : interaction d’un trinôme
Nous commençons par définir les termes clés de notre recherche : le virtuel, le réel et l’irréel. Il est nécessaire de faire la distinction entre ces trois notions afin d’éviter les confusions mais aussi afin de délimiter les champs qui entourent chaque notion. Ceci nous aidera par la suite à définir d’une manière claire les éléments de la conceptualisation du virtuel vidéoludique ; est ce qu’il s’agit d’une conceptualisation qui s’inspire du réel ou d’une conceptualisation qui puise son origine dans l’irréel.
Ce qui nous intéresse en premier lieu c’est de distinguer et clarifier « le réel » et « l’irréel». Qu’entendons-nous par ces deux termes et s’agit-il d’antonymes comme c’est le cas dans le sens littéraire linguistique des deux termes. Par conséquent nous allons proposer des définitions des deux notions en essayant de dresser le portrait de chacun et d’en délimiter les champs pour les comparer.
Cependant, une remarque se soulève : le virtuel est-il réel ou irréel ? Ceci est en raison de l’utilisation fréquente du virtuel dans le domaine numérique qui est devenu omniprésent dans la vie quotidienne de l’Homme. En évoquant le mot réel, un antonyme immédiat est le « virtuel », est-ce bien le cas ou s’agit-il d’une différence basée sur une subtilité qu’il faut clarifier ? La question est de même pour « l’irréel »: peut-on dire, comme il est si bien courant dans la vie quotidienne, que le virtuel est synonyme de l’irréel dans le sens qu’il est contraire au réel? Ces questions nous ont mené à comparer les deux notions, du réel et de l’irréel, par le virtuel en posant des hypothèses concernant la composition de ce virtuel.
Autrement dit, nous allons poser l’hypothèse que le virtuel se compose essentiellement d’une de ces deux notions, donc qu’il « s’inspire » d’une de ces deux notions. En posant cette hypothèse nous explorerons la définition du virtuel à travers l’angle du « réel » ou de l’irréel.
La première hypothèse est donc celle qui concerne le réel : le virtuel serait essentiellement inspiré à partir du réel, dans le sens du monde « réel » et palpable.
Afin d’étudier cette hypothèse nous proposons une définition suivante :
« Virtuel est un concept très large. (…) [et les frontières des significations diverses] manquent de netteté. (…) Dans cette masse sémantique uniforme, le mot est employé dans des domaines très divers (…). Ainsi, utilise-t-on virtuel en technologie – réalité virtuelle, rencontre virtuelle, opération virtuelle – et en physique – foyer virtuel, image virtuelle, travail virtuel – mais également en philosophie – à travers la question du réel et de l’actuel –, en cinéma et en littérature – pour parler de quelque chose d’imaginaire, de fictif ou de futuriste. » (Vitali Rosseti, 2012, p48)
Tout d’abord cette définition nous donne un point important : il n’y a pas de définition claire et nette du mot virtuel vu la diversité de son utilisation, qui n’est certainement pas limitée au domaine numérique, et la polysémie du terme lui-même. Les significations du mot « virtuel » sont larges et souvent les frontières entre ces significations multiples se croisent et se coïncident sans pour autant devenir synonymes. Mais ce que nous retenons de cette définition est le fait que le virtuel se rattache tout aussi bien au « monde technologique » et donc numérique, qu’au monde de la pensée philosophique. Et c’est là que nous trouvons le « réel » rattaché à ce virtuel «à travers la question du réel et de l’actuel».
Seulement, un détail dans cette définition attire notre attention: cette définition associe le virtuel au réel certes, mais elle sous-entend que le virtuel est un champ lexical pour parler de «l’imaginaire, le fictif ou le futuriste». Cependant, ne dit-on pas que le «réel» désigne la «réalité» en tant que quelque chose de palpable et de matériel? Dans ce cas, il est impératif de distinguer les limites entre le réel et la réalité afin de mieux comprendre les dires de la définition précédente.
Qu’est-ce que la réalité alors? Une définition est la suivante:
« Ce que nous appelons communément « réalité », c’est le monde où nous vivons, peuplé d’objets que nous percevons, observons, étudions, manipulons, convoitons, refusons… Spontanément, nous pensons que ces objets constituent un donné extérieur à nous sujets. » (Marguerite Angrand, s.d, p2)
Ce qui nous amène à conclure que la réalité est un ensemble d’éléments en système qui reflètent nos «pensées». D’une part, ce système englobe tout ce que nous percevons, c’est le cadre de notre vie quotidienne, et d’une autre part c’est le reflet de nos pensées et réflexions. Donc cette réalité se caractérise par ce dernier point qui nous semble crucial: en effet, ce que nous pensons être réalité est le produit de nos pensées. Autrement dit, est réalité ce qui reflète ce que nous pensons doit être réalité. Ceci est renforcé par cette seconde définition :
« (…) la réalité peut s’appréhender selon différentes perspectives. Il n’y a plus alors une réalité, mais des réalités multiples qui se superposent ou s’insèrent l’une dans l’autre. » (Alain Amselek, 2010)
Par cette définition d’ordre de la psychanalyse, la réalité devient multiple selon le «regard» ou encore «la perception» de l’Homme: En fait, ces réalités sont (« un « effet » du symbolique et de son auxiliaire l’imaginaire ») (Marguerite Angrand, s.d, p2), selon Jacques Lacan, car :
«L’appréhension de la « réalité » est soumise à la subjectivité de l’Homme ; tantôt perçue comme « réalité » pour certains, tantôt perçue comme illusion pour d’autres. Il est question de « symbolique » qui se rapporte à la perception, le vécu et l’imaginaire de tout et chacun quand il s’agit de « réalité ».(Asma Manai, 2018, p46)
De par ces définitions, nous pouvons établir que la réalité est perceptible, et peut être considérée «réalité» selon la perception de tous et chacun. La réalité est donc composée d’éléments qui peuvent signaler sa «réalité» à l’individu. Communément, ces éléments sont appelés «réel». Mais nous venons de démontrer que la réalité peut devenir une illusion pour d’autres car elle ne reflète pas les éléments de la symbolique et de l’Imaginaire de cet individu. Dans ce cas, «réel» devient une illusion et non pas le sens «basique» qui est synonyme de «palpable».
Mais qu’est-ce qu’est donc le «réel»? Comment peut-on affirmer qu’un élément est «réel» afin de pouvoir déterminer qu’il compose cette «réalité»?
Si nous posons l’hypothèse que la réalité et le réel vont de pair, il est possible de dire que «réel» devient une illusion quand cette réalité est illusion selon la conviction de l’individu en question. Autrement dit, le réel peut être «non tangible» quand l’individu affirme que «ceci n’est pas ma réalité, ceci n’est pas réel». L’exemple à lequel nous pensons est celui de la virtualité vidéoludique: si l’usager-gamer est convaincu que l’espace du jeu vidéo est «sa réalité» alors les éléments virtuels, ou encore «non palpable» qui constituent cette «réalité» sont pour lui un «réel». Le cas contraire est aussi applicable: tant que l’usager-gamer est conscient que les éléments qui l’entourent ne sont pas ceux de sa réalité, alors il est conscient que cette vie double n’est pas «réelle». Par conséquent, réel et réalité vont de pair. Sont-ils synonymes? En voici une définition qui clarifie ce point:
« Le terme “réel” a l’avantage d’insister sur l’idée d’une existence effective et incontestable (réelle). La réalité est marquée par le réel, car elle résiste et nous ne pouvons la construire arbitrairement. Réalité et réel ne sont pas dissociables, ils sont les deux faces du monde. La conception qui se dégage de ces affirmations est un réalisme ontologique associé à un constructivisme empirique. » (Patrick Juignet, 2018)
Donc le réel et la réalité ne sont pas synonymes, mais vont de pair dans un binôme en interaction, qui «s’entraident» l’un et l’autre. La notion du réel est associée à la réalité sans pour autant être un synonyme. En d’autres termes plus simples :
« La connaissance du réel semble passer d’abord par une conscience de la réalité : si l’Homme est conscient que l’environnement qui l’entoure est « réalité », il peut alors distinguer que les éléments qui l’entourent sont « réel » (Asma Manai, 2018, p47)
De ce fait, nous pouvons à présent expliquer d’une manière claire la signification du mot «réel» dans l’emploi de la définition concernant le virtuel que nous avons employé au tout début de cette partie. En effet, si le mot réel a été employé en association avec le fictif dans cette définition, c’est que le réel constitue un élément de la «réalité» qui elle-même dépend de la perception de l’individu et de ce qu’il détermine en tant que «réel» pour lui. Donc, ce «réel» peut être fictif dans le sens qu’il «n’existe pas concrètement», mais «existe dans l’esprit» de l’individu. L’exemple ici est celui d’un conte de fée et de l’enfant qui le lit: l’histoire est fictive, mais la princesse, le château, le prince etc. existent dans l’esprit de cet enfant et sont donc pour lui «réels». Dans le même contexte, ce virtuel vidéoludique peut donc se constituer de réels tant que la conscience de l’usager-gamer considère ce monde vidéoludique en tant qu’illusion. C’est dans ce contexte qu’on peut dire que le réel devient un élément du virtuel car le réel est ici au sens d’un élément tangible qui fait partie de la réalité mais qui reste fictif car il n’est pas «physiquement existant».
Donc si le virtuel contient du «réel» au sens du non physique et du fictif, peut-on toujours affirmer que c’est du réel? Si le réel est le reflet de nos pensées, la concrétisation de ces idées, perceptible et «tangible» vu qu’il compose la «réalité», peut-on penser que cette «virtualité» qui qualifie le non tangible englobe ce qui est appelé «réel»?
Même si ce réel appartient au domaine «virtuel» tant qu’il reste «fictif», il nous semble qu’il n’est plus «réel» dans le sens propre du «tangible et palpable». Oui le réel peut être fictif, mais dans le sens qu’il est physiquement possible d’exister. Le fictif fantastique par exemple contient des éléments qui se trouvent dans l’impossibilité de devenir physique. On ne peut pas envisager que le scénario de Frankenweenie, un film de Tim Burton comme exemple, puisse devenir réalité dans le sens du physique et tangible. Oui il est «réel» car il appartient à la «réalité» du film, et donc perceptible dans ce monde fantastique, mais il n’est pas réel tangible et physiquement existant car il est fictif.
À ce titre, nous posons une deuxième hypothèse pour essayer de répondre à cette contrainte: le virtuel se compose essentiellement de l’irréel. Autrement dit, il s’inspire particulièrement de l’irréel non tangible et non palpable. Afin d’étudier l’étendue de cette hypothèse, voici une première définition :
« Le mot virtuel vient du latin médiéval virtualis, lui-même issu de virtus, force, puissance. Dans la philosophie scolastique, est virtuel ce qui existe en puissance et non en acte. Le virtuel tend à s’actualiser, sans être passé cependant à la concrétisation effective ou formelle. L’arbre est virtuellement présent dans la graine. En toute rigueur philosophique, le virtuel ne s’oppose pas au réel mais à l’actuel : virtualité et actualité sont seulement deux manières d’être différentes. » (Pierre Lévy, 1995)
Cette définition met au point un détail important: le virtuel ne s’oppose pas au réel mais à l’actuel en philosophie. Pour Lévy, ce virtuel est une «image» qui n’est pas palpable et donc qui n’existe pas physiquement, mais elle est basée sur le concret. C’est-à-dire que cette image s’inspire de la réalité, qui est «l’actualité» ici: l’exemple de la graine et de l’arbre est très révélateur car cette graine est l’actualité, la réalité, le «tangible» la forme physique réel; alors que l’arbre est une image obtenu en regardant cette graine, en «imaginant» la graine grandir pour devenir arbre. La graine est l’actuel, l’arbre est le virtuel, donc la graine est le réel, tandis que l’image de l’arbre n’est pas physique: elle est encore irréel. On ne sait pas si cette graine donnera un arbre fruitier ou une floraison car on ignore «les détails». On va «supposer» que cette graine donnera un «certain» arbre basé sur nos suppositions et notre imagination.
Mais qu’est-ce donc la définition de cet «irréel» que nous comparons au «réel» et qui constitue une part du virtuel?
Une définition des plus basiques sera la suivante, relevée à partir du dictionnaire en ligne CNRTL:
« A. Qui n’a pas de réalité, qui n’existe pas ou n’existe que dans l’imagination. Synonyme : imaginaire, fantastique. Appliqué à une personne, il est synonyme de « Qui n’a pas d’existence réelle.». B. Qui ne paraît pas réel, semble vivre, se situer ou se dérouler dans un autre monde, généralement étrange et fantastique. Appliqué à une personne, il signifie «Qui paraît ailleurs ou venu d’ailleurs, lointain, absent des réalités de la vie». » (CNRTL, 2012)
Cette définition oppose l’irréel à la réalité car elle n’existe pas physiquement mais uniquement dans l’imagination de l’individu. Contrairement au réel qui peut ne pas exister tangiblement et être fictif, conformément à ce que nous avons relevé à partir du fait que la réalité dépend de la perception de tous et chacun selon ce qu’il considère comme réel, l’irréel n’est pas fictif dans le sens qu’il «peut devenir existant» mais n’existe que dans l’imaginaire, dans le fantastique et se voit dans l’impossibilité de devenir tangible. «Irréel» est donc non pas l’antonyme de «réel» mais l’antonyme de «ce qui n’a pas d’existence réelle». C’est-à-dire que l’irréel oppose ce qui existe dans le réel, et donc ce qui a une forme «perceptible» et «tangible», «palpable» et «matérielle». Un autre détail est «semble vivre dans un autre monde», ce qui se conforme avec la nature du virtuel qui implique l’existence dans un plan différent de celui de la réalité. Donc on peut affirmer que cet irréel fait partie du virtuel en tant qu’une existence non tangible et immatérielle, existant dans un «autre monde» qui est le monde virtuel.
Si c’est le cas, il faut alors clarifier un point qui se soulève: si l’irréel appartient au plan d’existence du virtuel, et oppose le plan d’existence du réel, donc l’irréel n’appartient pas à la réalité, donc le réel ne peut pas appartenir au virtuel vu qu’il oppose l’irréel. Il convient alors de dire que l’équation devient la suivante: réel et réalité opposent irréel et virtuel. En d’autres termes nous nous trouvons face à deux binômes réel-réalité vs irréel-virtuel si nous suivons le cours de nos constatations précédentes. Même si le réel peut être intangible et immatériel dans le sens du «fictif», il existe sur un plan totalement opposé à celui où l’irréel existe. Par conséquent, le plan de l’existence du réel ne peut pas être le même que celui de l’irréel. Et si nous considérons que le plan de l’existence de l’irréel est le virtuel, il est logique de dire que le réel ne peut pas appartenir à ce plan, le virtuel, et donc appartient à la réalité comme plan d’existence, ou «monde» en d’autres termes.
Or, nous sommes en dilemme face à ces dires: (« Le virtuel possède une pleine réalité, en tant que virtuel ») (Gilles Deleuze, 1968). Ce qui nous mène à repenser nos dires précédents: si le virtuel possède une «réalité», c’est qu’il possède du «réel» et c’est que l’irréel ne s’y oppose plus. En d’autres termes, tant que cette réalité reste sur le plan virtuel, le réel et l’irréel s’y confrontent et ne s’opposent plus, mais cohabitent en symbiose.
Mais que veut-on dire par «si cette réalité reste sur le plan du virtuel»? Il s’agit ici de la perception que nous avons face à la virtualité et à la réalité: la perception du virtuel peut induire à percevoir une réalité mais elle n’est pas réelle, dans le sens qu’elle n’est pas matérielle. Les éléments du réel y sont mais ils ne sont pas physiquement présents, chose qui fait que les éléments de l’irréel y sont aussi vu qu’ils restent sur le plan non matériel.
Par conséquent, c’est la perception qui joue un rôle déterminant ici dans la distinction entre le virtuel, la réalité et la réalité du virtuel. Autrement dit, c’est l’aspect formel qui permet cette distinction, chose qui nous mène vers le volet de la conception de ce virtuel. Vu que nous nous situons dans le champ de la recherche du vidéoludique, il s’agit ici de distinguer la conceptualisation de cette virtualité vidéoludique: en effet, si les dires de Deleuze sont applicables sur le virtuel en général, ils sont encore plus clairs quand il s’agit de les appliquer sur le virtuel vidéoludique où l’usager-gamer considère cette virtualité en tant qu’une «réalité» tout au long de la durée de l’expérience gaming. Par conséquent, nous allons essayer de clarifier un peu plus le rôle du réel et de l’irréel dans la conceptualisation du virtuel vu que nous venons de déduire que le réel et l’irréel appartiennent tous les deux au champ du virtuel dans le cas où il s’agit de la considérer comme une réalité «propre au virtuel». C’est ce que nous allons voir dans la partie suivante.
Conception du virtuel vidéoludique : réel Vs irréel
Durant la partie précédente nous avons établi la définition du virtuel en posant comme hypothèses l’intervention des notions du réel et de l’irréel dans la composition de ce qui est appelé le domaine «virtuel». Nous avons clarifié aussi la notion de la «réalité» et nous avons établi la réalité du virtuel en tant que «virtuel». Cependant, nous allons maintenant clarifier la conception du virtuel vidéoludique en se référant au réel en tant qu’élément appartenant à la réalité physique, et en se référant à l’irréel en tant qu’élément appartenant à l’imaginaire immatériel non existant.
Nous avons établi durant la partie précédente que le réel et l’irréel interviennent pour constituer le virtuel en tant que notion. Cependant, ce qui nous intéresse à présent c’est le virtuel vidéoludique et sa conceptualisation. Autrement dit, nous nous posons des questions quant à la conception du cadre spatial virtuel au sein des jeux vidéo vu que la virtualité vidéoludique est «visible» et «tangible» en tant que cadre spatial, c’est-à-dire les espaces présents dans le jeu vidéo.
Afin d’aborder cette virtualité vidéoludique et son usage, il nous semble important d’essayer de déceler la manière dont cette virtualité est conçue, dans le sens de «l’inspiration» derrière la création d’un espace vidéoludique: de quel manière les game designers conceptualisent ce virtuel?
Un jeu vidéo est un produit design complexe comme nous l’avons mentionné au début de ce travail. Sa complexité n’est pas uniquement au niveau des sous-produits qui le constituent mais dans l’essence même de ce qu’on appelle «jeu vidéo». Outre son côté ludique,
« Le jeu vidéo est une expérience ressentie par le joueur (…) On doit se dire que le jeu vidéo propose une expérience spécifique, un jeu avec des univers simulés, engendrés par le calcul, où il y a de l’habileté souvent, et puis une certaine profondeur dans la simulation. Sinon, ce sont juste des jeux sur ordinateur.»(Mathieu Triclot, 2011)
Donc, le côté expérientiel est très important lorsqu’il s’agit de «décortiquer» le jeu vidéo, car il implique un produit invocateur d’émotions pour l’usager, donc un ressenti, un vécu, ce que Stéphane Vial appelle «l’effet du design». Ce n’est pas uniquement un «calcul» ou une programmation habile, mais au-delà de la simulation informatique, c’est un univers «ressentie» où l’émotion est stimulée pour engendrer une expérience immersive.
D’ailleurs cette expérience est amplifiée par la dimension spatiale présente dans les jeux vidéo. C’est la manifestation «conceptuelle» du virtuel vidéoludique, où des stimuli sensoriels s’incrustent dans les éléments spatiaux afin d’engendrer ce vécu expérientiel. Ce qui nous ramène à la conceptualisation de cet espace virtuel vidéoludique.
La question autour de la conceptualisation de ce virtuel émane d’une observation que nous avons faite lors de l’usage de plusieurs types de jeux vidéo. En effet, les jeux FPS, tir à la première personne, préfèrent des espaces ouverts, une architecture moderne années 60-80, tandis que les jeux RPG, les jeux de rôle et d’exploration, ont recours à une architecture médiévale de style roman ou gothique. Les jeux d’horreur usent souvent d’un style «Early American», gothique, moderne minimaliste ou encore classique, alors que les jeux d’aventure optent pour une ornementation baroque, néoclassique ou même Renaissance. Ceci nous a menés vers une question: lors de la conception des espaces au sein d’un jeu vidéo, s’agit-il toujours de «transposer la réalité», c’est-à-dire de copier des bâtiments déjà existants et réels, ou de «s’inspirer» du réel pour créer une architecture non existante?
Une autre question s’est soulevé lors de l’observation de jeux vidéo de genre science-fiction comme Mass Effect ou Dead Space. Il s’agit ici d’un cadre temporel irréel futuriste donc les espaces sont irréels dans le sens qu’ils sont «imaginés» et non «inspirés» à partir de la réalité et de l’architecture existante. Dans ce cas, quelle est «l’inspiration» derrière la conception des espaces virtuels vidéoludique? Est ce qu’on «s’inspire» du réel existant, «transpose» ce réel existant tel qu’il est, ou «puise» dans l’irréel imaginaire?
Afin de répondre à ces questions, nous nous proposons de prendre trois exemples de trois jeux vidéo différents afin de les étudier et déterminer les éléments de la conceptualisation du virtuel vidéoludique.
Nous prenons le premier exemple qui est le jeu vidéo de type FPS, du genre de l’horreur, Metro, une saga vidéoludique qui comprend trois volets dont le premier est sorti en 2010. Notre choix s’est fait sur cet exemple non seulement grâce à la variation des espaces au sein de ce jeu mais aussi pour le fait qu’il y a un essai de recréation d’une ville fictive en Russie dans un scénario post apocalyptique d’un après-guerre nucléaire. Les événements se déroulent dans une ville souterraine en «ghetto» pour les survivants de la guerre avec un style très steampunk dans une atmosphère militaire tout en ayant l’air d’un champ d’habitat spontané. Les images ci-dessous montrent le contraste entre la ville en ruine en surface et la ville souterraine des survivants:
Figures 1, 2, 3 et 4 : quelques espaces de Metro 2033, le premier jeu dans la saga Metro
Nous voyons une variation de styles décoratifs au niveau de la ville souterraine où le steampunk du métal en rouille et de la lumière tamisée industrielle côtoie le classique de la renaissance russe avec les arcs et les voûtes. Notre attention a cependant été attirée par l’aspect formel de la ville de surface où les ruines ressemblent fortement aux ruines causées par les bombardements durant la seconde guerre mondiale en Europe comme le montre les images ci-dessous:
Figures 5 et 6 : (de gauche à droite) façade d’un bâtiment à Metro vs aspect des bâtiments durant la seconde guerre mondiale
Ici, il s’agit d’un scénario post-apocalyptique avec une touche de science-fiction catastrophe. De ce fait, le souci conceptuel est de conserver une certaine «crédibilité» pour induire l’usager-gamer à «croire» à la possibilité de ce scénario et donc à le pousser vers un état immersif dans l’environnement virtuel. De ce fait, le choix s’est porté à «copier» le réel en essayant de reproduire les façades des bâtiments des années 40 en Europe. Il s’agit donc d’une transposition de la réalité spatiale : l’espace de Metro est une modélisation faite à partir du réel afin de procurer une sensation de vraisemblance à l’usager-gamer.
Notre première hypothèse à partir de cet exemple est la suivante: la conceptualisation du virtuel vidéoludique est une transposition du réel pour une meilleure immersion de l’usager-gamer en simulant la réalité.
Le second exemple est un jeu vidéo de type RPG à la troisième personne dans le genre aventure, qui est Dark Souls, une saga qui remonte à 2010 avec plusieurs titres à son actif. Notre choix s’est fait par l’intérêt très particulier au cadre spatial par un échantillon important d’espaces variés et par le soin aux détails architecturaux exprimés surtout par les proportions et les façades des bâtiments proposés tout au long de l’expérience gaming. La thématique architecturale est gothique avec un seul style architectural et décoratif tout le long du jeu afin d’octroyer une certaine unification à la spatialité vidéoludique et de créer un sens de continuité entre les différents bâtiments et sous-espaces comme le montre ces images ci-dessous:
Figures 7, 8, 9 et 10 : les espaces du jeux vidéo Dark Souls III
L’univers du jeu est très médiéval, une habitude pour les jeux RPG, avec un air mythique fantastique. Nous pensons que l’inspiration narrative du jeu trouve ses origines dans les contes et épopées moyenâgeuses, ce qui a par la suite dicté le style gothique comme référence architecturale et décorative. Ceci est très visible dans les façades des bâtiments que nous avons rencontrés lors de nos observations de l’usage de ce jeu vidéo: châteaux, églises, ruines, village de paysans; un décor très Moyen-Age fidèle à la thématique gothique. D’ailleurs, nous avons relevé les références au style gothique par les images ci-dessous:
Figures 11 et 12 : les tourelles de Dark Souls vs les tourelles de Notre Dame
Ces images montrent une ressemblance frappante entre les tourelles modélisées dans le jeu et ceux de l’église de Notre-Dame, pour ne citer que cet exemple. En effet, les tourelles de cette forme conique sont typique du style gothique Moyen-Âge, tout comme l’arc en ogive, les frontons au-dessus de l’entrée des bâtiments ainsi que l’absence de l’ornementation excessive par les motifs pour céder la place à une ornementation sculpturale sur pierre. Le fait reste le même: l’inspiration de cette conception spatiale est faite à partir d’un style architectural réel mais elle n’est pas la transposition d’un bâtiment réel tel qu’il est. Ici c’est une «inspiration» et pas une «transposition». Les éléments décoratifs ne sont pas propres et uniques à l’église de Notre-Dame mais sont des caractéristiques du style Gothique. C’est donc l’hypothèse posée par ce second exemple: conceptualiser le virtuel vidéoludique c’est s’inspirer du réel tout en prenant des libertés dans la conception spatiale.
Pour le dernier exemple, nous avons fait le choix de prendre un jeu vidéo de type TPS, tir à la troisième personne, et du genre «Sci-Fi Survival Horror», la survie et l’horreur dans une atmosphère de science-fiction, qui est Dead Space. C’est une saga qui remonte à 2008 et qui comporte plusieurs volets où l’univers est post-apocalyptique futuriste qui met en relief le progrès scientifique de l’humanité. L’histoire du premier volet de ce jeu se passe sur un vaisseau spatial nommée the USG Ishimura avec un échantillon spatial varié malgré la limite imposée par un seul espace global. C’est d’ailleurs la raison de notre choix sur cet exemple, en voici quelques images ci-dessous:
Figures 13, 14, 15 et 16 : quelques espaces dans Dead Space
La thématique architecturale est très steampunk avec l’usage du métal chromé, des tons du cuivre et de rouille, de la lumière industrielle d’ambiance dans les tons rougeâtres, jaunâtres et blanchâtres. Ce choix de style décoratif illustre le caractère macabre du genre vidéoludique et surtout de la narration qui se veut sanglante avec la lutte pour la survie à bord d’un vaisseau infesté de monstres. Le découpage spatial des zones de circulation contigu, la lumière qui éclaire à peine l’espace ainsi que le choix des couleurs a pour but d’instaurer une atmosphère terrifiante chez l’usager-gamer et le pousser à paniquer lorsqu’il réalise qu’il n’y a pas d’échappatoire possible.
Mais ce qui attire l’attention ici est le fait que ces espaces ne sont pas une transposition du réel ni une inspiration de la réalité existante puisque c’est une atmosphère futuriste. Il s’agit ici de faire appel à l’irréel et modéliser l’invisible; c’est une création «originale», donc une conceptualisation de l’irréel puisée dans l’imaginaire des game designers. Donc la troisième hypothèse est que la conceptualisation du virtuel est une modélisation de l’irréel et donc une création d’un espace qui n’existe pas.
Cependant quelques points se soulèvent en faisant la comparaison entre les trois exemples: si Metro transpose une ville réelle, il y a cependant création dans certains espaces et il y a même une inspiration à partir de différents styles décoratifs réels comme la renaissance russe, le steampunk, le moderne et d’autres. Dark Souls est une inspiration claire du style gothique du Moyen-Âge, n’empêche qu’il y a la création originale dans les souterrains et les ruines. Et si Dead Space se veut être la création originale d’un espace irréel, l’inspiration à partir d’espaces réels se voit dans la station du Tram qui a le même découpage spatial qu’une station de métro réelle, ainsi qu’une inspiration du style steampunk.
Que déduire alors? La conceptualisation du virtuel est-elle une transposition du réel, une inspiration à partir du réel ou une création de l’irréel? Après avoir étudié les trois exemples et constater que les trois modes de conception se croisent et se complémentent, il nous paraît impossible de trancher sur une seule modélisation de la conceptualisation du virtuel vidéoludique. De ce fait, nous constatons que la conceptualisation de ce virtuel vidéoludique passe par le même principe de la conception du virtuel en tant que concept: ses limites sont entre le réel et l’irréel, un chiasme entre les deux qui se combinent et se complémentent pour former un lien entre l’imaginaire et la réalité. C’est donc une conceptualisation qui s’inspire du réel, transpose la réalité et propose une modélisation de l’irréel. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’usager-gamer se trouve en immersion: une familiarité avec la réalité traduite lors du style architectural, la découverte d’une création inédite propre à l’univers vidéoludique stimule ses sensations afin de mener vers l’avènement d’une expérience gaming.
A ce propos, l’usage de cette virtualité vidéoludique nous a intrigués car il se trouve qu’il met en relief ce chiasme entre le réel et l’irréel, entre la réalité et le virtuel car l’usager-gamer se projette vers un espace virtuel tout en existant dans un espace réel. Autrement dit, l’usager-gamer existe dans deux espaces à la fois; comment cela s’opère-t-il? Quelles sont les caractéristiques de l’usage de ce produit design très particulier qui est le jeu vidéo? Ces questions feront l’objet de la troisième partie de ce présent travail.
Usage du virtuel vidéoludique : entre-deux réel et irréel
Au cours des deux parties précédentes, nous avons surtout essayé de cerner les limites du virtuel en fonction de la notion du réel et de l’irréel. Nous avons par la suite concrétisé ces réflexions par l’exemple du virtuel vidéoludique en mettant la conception de ce virtuel à l’épreuve du réel et de l’irréel, la question étant de savoir si la conceptualisation de l’espace virtuel vidéoludique s’inspire ou transpose le réel, ou s’inspire et modélise l’irréel. En établissant le fait que cette conceptualisation est le fruit d’une complémentarité entre le réel et l’irréel, nous avons établi que le virtuel vidéoludique est un chiasme entre le palpable et l’impalpable, le visible et l’invisible, autrement dit entre le réel et l’irréel.
Et si cette virtualité s’exprime autour de ces deux notions, il est judicieux de penser que l’usage de cette virtualité, autrement dit l’usage du jeu vidéo, passe par ces deux notions. Lors de nos observations, nous avons remarqué que les usagers-gamers tendent à considérer l’espace virtuel vidéoludique en tant que «réalité» tout au long de l’expérience gaming. Ceci est dû à l’immersion: une implication profonde dans la virtualité vidéoludique («fait que l’usager-gamer considère ce cadre spatial virtuel comme une réalité possible, chose qui rend son interaction dans l’espace très subjective et très personnelle») (Asma Manai, 2019). Par conséquent, le mouvement de l’avatar dans l’espace, qui est l’image projeté de l’usager-gamer dans l’espace virtuel vidéoludique, reflète cette implication: une progression lente et mesurée pour éviter le danger, une exploration globale de l’espace pour chercher des indices, l’instinct de fuir devant un «boss fight», tout ceci est le reflet de cette immersion qui confirme que la virtualité vidéoludique devienne une réalité pour l’usager-gamer lors de l’expérience gaming.
Dans ce cas, peut-on affirmer que l’usage du virtuel vidéoludique s’articule uniquement «dans» la virtualité, et donc dans l’irréel impalpable? Si l’usager-gamer considère le virtuel vidéoludique en tant que sa «réalité» il n’est plus question du réel dans le sens du palpable, mais du «réel» subjectif, sujet à l’Imaginaire et au référentiel propre à l’usager qui considère la réalité en tant que reflet «de ce qu’il croit réel».
Un contre-exemple est l’usager-gamer qui, lorsqu’il est demandé à commenter le virtuel vidéoludique, affirme que «ce n’est qu’un jeu et donc ce n’est pas la réalité». Quelles différences avec le précédent usager-gamer dans ce cas-là? Si ce second «type» de gamer affirme que le virtuel vidéoludique est «un virtuel et non pas une réalité» alors il s’agit ici d’une distinction entre le réel palpable et l’irréel impalpable. Donc, le réel ici est le palpable matériel et la réalité est le monde physiquement matériel en faisant une très nette distinction avec le monde virtuel du jeu vidéo.
Afin d’examiner au plus clair cette question, nous mettons une hypothèse: si l’usager-gamer perçoit le monde du jeu vidéo et le considère comme sa réalité, c’est qu’il distingue une autre réalité qui est la réalité «physique et palpable». Il y a ici l’existence de deux mondes, deux réalités selon le référentiel propre à l’usager lui-même, deux mondes où les limites du réel et de l’irréel distinguent la réalité physique et la réalité «virtuelle». L’usager-gamer «existe» entre ces deux mondes lors de l’expérience gaming, ce qui nous mène vers le concept de «l’entre-deux». Notre hypothèse est donc la suivante: l’usager-gamer existe dans un entre-deux lors de son expérience gaming, entre le monde virtuel et le monde réel palpable.
Afin de vérifier cette hypothèse, nous proposons d’abord d’examiner cette notion de «l’entre-deux» par cette définition:
« L’entre-deux se présente comme une coupure-lien, que ce soit entre deux personnes, entre deux espaces, entre deux langues ou entre deux cultures, autrement dit, entre deux termes qui, au lieu de s’opposer catégoriquement, s’ouvrent l’un à l’autre afin de mieux accueillir leurs différences. (Mariana Ionescu, 2010)
Cette définition fait tout d’abord la distinction entre les deux entités en entre-deux: ils sont différents et distincts, généralement opposés. Cependant dans l’entre-deux ces deux notions se complémentent «en s’ouvrant» l’un sur l’autre. Ce concept offre donc le rôle d’une charnière entre deux entités. D’ailleurs ces deux entités physiques ou abstraites se construisent en puisant l’une dans l’autre lors de l’entre-deux: il s’agit d’une interaction qui, loin de séparer les deux acteurs de l’entre-deux, les lient en proposant une certaine complémentarité.
C’est le cas pour l’usager-gamer: il existe physiquement dans le monde réel tout en «existant» dans le monde virtuel à travers une projection de son soi, l’avatar, dans l’espace virtuel vidéoludique. Ce qui s’opère ici est la projection de l’usager-gamer dans une entité irréelle, immatérielle, dans le cadre d’un espace virtuel, un espace qui n’existe pas physiquement, tout en restant ancré dans le monde réel physique. L’usager-gamer est confronté à un entre-deux spatial entre le monde de la réalité et le monde de la virtualité, ainsi qu’un entre-deux entre le réel et l’irréel par son immersion dans un monde impalpable tout en restant en interaction avec un monde palpable.
En considérant ce que nous avons établi au préalable durant les deux premières parties de ce travail, il est judicieux donc de penser à l’usage de cet espace virtuel vidéoludique comme un usage du réel et de l’irréel en interaction. En effet, si le virtuel en tant que concept est constitué du réel et de l’irréel, si le virtuel vidéoludique en tant que spatialité est conceptualisé à partir du réel et de l’irréel, et enfin si l’usage de cette spatialité est articulé entre le virtuel et la réalité, la conclusion serait que cet usage est articulé dans un entre-deux réel et irréel. D’ailleurs cet entre-deux ne se situe pas uniquement dans la distinction entre le monde physique et le monde virtuel, considérant les dires de Deleuze dans la première partie qui affirme que le virtuel possède une réalité en tant que virtuel, cet entre-deux s’opère au sein même de l’espace virtuel vidéoludique. Si cet espace est une «réalité» tant qu’elle est virtuelle alors cette «réalité» se situe entre le réel et l’irréel de manière à devenir une «réalité» pour l’usager-gamer qui la reconnaît telle grâce à son référentiel et son imaginaire.
Conclusion
En établissant la définition du virtuel en tant que concept et notion, nous avons établi les limites du réel et de l’irréel dans la constitution de ce concept. En mettant le virtuel vidéoludique à l’épreuve du réel et de l’irréel nous avons pu établir une constatation par rapport à la conceptualisation de cette spatialité virtuelle particulière. En effet, il ne s’agit pas de séparer le réel de l’irréel, ou encore de distinguer le réel du virtuel, ou de clarifier ce qu’est le virtuel et ce qu’est la réalité, mais il s’agit de démontrer que cette triptyque réel-virtuel-irréel est un système en interaction que ce soit dans la phase de la conceptualisation de l’espace virtuel vidéoludique, ou lors de la phase d’usage de ce dit espace. La virtualité vidéoludique est en complémentarité réel-irréel en tant que concept, en interaction réel-irréel lors de la conception de l’espace vidéoludique, et en entre-deux réel-irréel lors de l’usage de ce dit espace. Donc séparer le réel de l’irréel lorsqu’il s’agit de comprendre le virtuel vidéoludique n’est pas judicieux vu que ces trois notions forment une unité en interaction perpétuelle. Cependant, nous nous demandons, est-ce le cas pour d’autres virtualités? Si nous posons le virtuel cinématographique en tant que produit invitant le spectateur à une projection empathique à travers l’acteur et la scène, peut-on toujours affirmer que le virtuel reste un système de complémentarité entre le réel et l’irréel?
Références:
Amselek A., (2010) entre Réel et Réalité, où se situe l’efficace de l’action thérapeutique ? Conférence sur la place du réel en psychothérapie psychanalytique, in PSYCORPS, Bruxelles, 22 septembre 2010
Angrand M., (2014). Le réel selon Lacan. Philosophis [En ligne]. URL : http://www.philopsis.fr/IMG/pdf/reel-lacan-angrand-.pdf , consulté le 26 février 2018
Deleuze G., (1968). Différences et répétition. Paris : PUF
Ionescu, M., (2010). L’entre-deux dans les littératures d’expression française[En ligne]. Les cahiers du GRELCEF [En ligne]. (1), URL : http://www.uwo.ca/french/grelcef/cahiers_intro.htm), consulté le 12 mai 2020
Lévy P., (1998). Qu’est ce que le Virtuel ?. Paris : Poche
Manai A., (2018). Réalité augmentée et expérience immersive dans le Game design : vers une nouvelle appréhension du vécu spatial. Mémoire de Master de recherche, Design espace. Tunisie : école supérieure des sciences et technologies du design.
Manai A., (2019). La réception du jeu vidéo : un entre-deux temporel entre réalité et virtualité, Prépublication des colloques de l’UIK.
Triclot M., (2011). Philosophie des jeux vidéo. Paris : ed. Zones
Vitali Rosati M., (2012). S’orienter dans le virtuel. Paris: Hermann Editeurs
Juignet, P., (2018). Réel (définition) [En ligne]. repéré sur : https://philosciences.com/vocabulaire/85-reel
CNRTL, (2012). Définition du « réel », [En ligne]. Repéré sur : https://www.cnrtl.fr/definition/irr%C3%A9el)