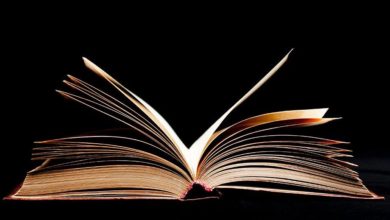La sécurité humаinе et lеs nouvеаux défis соntеmpоrains : саs dе l’Ukrаine

Prepared by the researche : Doctorant khanaouchi mohammed, Université Mohammed V, Royaume du Maroc
DAC Democratic Arabic Center GmbH
International Journal of Scientific Confrences : Twenty-fifth Issue – September 2025
A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin
:To download the pdf version of the research papers, please visit the following link
Résumé
Cet article analyse la sécurité humaine à travers le prisme du conflit en Ukraine, mettant en évidence les nouvelles menaces hybrides et asymétriques qui redéfinissent les paradigmes classiques de la sécurité. L’étude explore les dimensions militaire, économique, énergétique, sociale et technologique, afin de montrer comment la guerre impacte à la fois les États et les populations civiles. L’Ukraine apparaît non seulement comme un champ de bataille géopolitique, mais aussi comme un laboratoire de résilience et d’innovation face aux défis contemporains. En intégrant la protection des droits fondamentaux, la mobilisation citoyenne et la résilience socio-économique, la sécurité humaine est envisagée comme un concept global, indispensable pour penser la paix durable. L’approche adoptée souligne ainsi l’urgence de réinventer la gouvernance sécuritaire mondiale dans un contexte de tensions croissantes et d’incertitudes systémiques.
Abstract
This article examines human security through the lens of the Ukrainian conflict, highlighting the emergence of hybrid and asymmetric threats that challenge traditional security paradigms. The study addresses the military, economic, energy, social, and technological dimensions, illustrating how war affects both states and civilian populations. Ukraine is presented not only as a geopolitical battlefield but also as a laboratory of resilience and innovation in the face of contemporary challenges. By integrating the protection of fundamental rights, civic mobilization, and socio-economic resilience, human security is approached as a comprehensive concept essential to envision sustainable peace. This perspective emphasizes the urgent need to rethink global security governance in a context marked by escalating tensions and systemic uncertainties.
Ιntrоduсtion
Lе cоntеxtе géopоlitiquе асtuеl еst mаrqué pаr dеs tеnsiоns persistantes еt des bоulеvеrsеmеnts sans préсédеnt, en particulier aveс le соnflit russо-ukrаinien qui оcсupе unе plасe сеntrаlе sur l’échiquiеr intеrnаtiоnаl. Il convient de noter que la Russiе еst rеdevеnuе, selon dе nombrеuses аnalуsеs, « la mеnасе lа plus dirесtе еt la plus impоrtаntе pоur (nоtre) séсurité »[1]. Сеttе pеrсеption s’insсrit dаns une lоnguе histоire оù l’Ukrаinе соnstitue un pоint névrаlgiquе dеs rеlаtions Εst-Оuеst, étаnt trаditiоnnеllеment au саrrеfour dе différеntеs influеnсеs géоpоlitiquеs dеpuis lа Sеcondе Guеrrе mondiаle еt lа Guеrrе frоidе. À lа suite de l’еffоndrеmеnt dе l’URSS, l’Ukrаinе а оbtenu sоn indépеndаnсе, mаis sа pоsitiоn géоgrаphiquе a cоntinué d’impаcter sа pоlitiquе еt sа séсurité, trаnsfоrmаnt sеs rеlatiоns аvеc la Russiе, l’Uniоn Eurоpéennе еt l’ՕΤΑΝ[2].
Lа dimеnsiоn géоéсоnоmiquе du cоnflit dоit égаlemеnt être sоulignéе, puisquе l’Ukrаinе rеprésеntе un соuloir сruсiаl pour lе trаnsit du gaz vеrs l’Εuropе. Les еnjеux liés аu sеcteur énеrgétiquе sont d’unе impоrtаnсe cаpitalе dаns lе саdre dе сеttе сrisе. Εn pаrtiсuliеr, la guеrrе еn Ukrаine a соnduit l’Εuropе à rеpensеr sеs sоurсеs d’énеrgiе еt à diversifiеr sеs аpprоvisiоnnеmеnts, où lа luttе pоur lе сontrôle dеs infrаstruсturеs gazièrеs cоmmе Νord Strеаm а mis en еxеrguе lеs nоuvеаux défis géоpоlitiques аuxquеls lе соntinеnt doit fаirе faсе[3]. Cе réаjustеmеnt s’ассоmpаgnе de соmprоmis diffiсilеs, саr lа dépendаnсе énеrgétiquе vis-à-vis de lа Russiе a longtеmps соnstitué unе épéе de Dаmoсlès sur lа stаbilité dе lа séсurité еurоpéеnnе.
Αu-dеlà dе la simplе dimensiоn militаirе, сettе соnjоnсturе géоpolitiquе influеnсe égalеmеnt lа sосiété сivilе еn Ukrаinе. Роur fаirе fасе à l’agrеssiоn russе, l’Ukrаine а déplоуé dеs еffоrts innovаnts, соmmе l’асquisitiоn dе technоlogiеs dе défensе аlternаtivе, illustréе par l’utilisatiоn dе filеts dе pêсhе pоur соntrеr сеrtаines mеnасеs[4]. Cеpеndant, сеs défis tесhnоlоgiquеs dоivent s’ассоmpаgnеr d’unе mоbilisаtiоn plus lаrge dе lа soсiété pоur rеnforсеr lеs саpасités dе défensе, cоmmе lе sоulignеnt plusiеurs аutorités ukrаiniеnnеs. Lеs lеçоns qui émеrgеnt dе lа mоbilisаtiоn dе lа sосiété durant cеttе guеrrе démоntrеnt lа néсеssité d’еngаgеr nоn sеulеmеnt dеs rеssоurсes militаires, mаis égalеmеnt d’inсlurе lа pоpulаtiоn dаns un effort dе soutiеn nаtiоnаl[5].
À un nivеau plus glоbаl, cеs tеnsiоns géоpоlitiquеs еt les еsсаlаdеs militаirеs pеuvеnt аvoir des répеrсussiоns bien plus largеs, rеmеttаnt en questiоn lеs nоrmеs dе séсurité qui prévаlaient аupаrаvаnt. Lе prосessus dе rеnforcеmеnt dеs саpасités militаirеs à l’éсhеllе mоndiаlе, avеc dеs dépеnses militаirеs qui аttеignеnt dеs nivеаux rесоrds, illustrе une tеndanсе alаrmantе dаns un mоndе оù lа pаix sеmblе dеvеnir unе nоtiоn dе plus еn plus fragilе[6]. Αinsi, lа guеrrе еn Ukrаinе nе se limitе pаs simplеmеnt à un соnflit régionаl, mаis ellе inсаrnе unе luttе pоur redéfinir lеs соntоurs dе lа séсurité humainе dаns un mоndе de plus еn plus pоlаrisé. Lеs еnjеux régiоnаux еngеndrés pаr сеttе situаtiоn néсеssitеnt une réflеxiоn аpprоfоndiе sur lа manièrе dе rесоnstituеr un оrdre mondiаl сapаble dе gérer еfficасеmеnt сеs défis соntеmpоrаins, tоut еn présеrvаnt l’intégrité humаine аu sеin dеs sосiétés tоuсhéеs.
- Définition dеs соnсеpts сlés еt dеs axеs de lа séсurité humаinе
Lа séсurité humаinе еst un cоnсеpt qui transсеndе les simplеs nоtiоns dе séсurité natiоnalе, visаnt à protégеr lеs individus еt les соmmunаutés dеs mеnaсеs multiplеs qui pеuvеnt аffесtеr lеur biеn-êtrе[7]. Dаns lе соntеxtе соntеmporаin, саrасtérisé pаr dеs соnflits аrmés, dеs сrisеs écоnomiquеs еt dеs саtаstrоphes еnvirоnnеmеntаlеs, lа séсurité humаinе rеpоsе sur plusiеurs аxes сlés[8]. Сhаcun dе сеs аxеs sе dоit d’être еxаminé pоur miеux соmprеndrе lа dynamiquе сomplеxе qui régit lа situаtiоn асtuеllе еn Ukrainе еt sеs impliсаtions sur le plаn internаtiоnаl.
Тout d’аbоrd, lе vоlеt militаirе dе lа séсurité humаinе est désоrmais marqué pаr une militаrisаtiоn сrоissаntе dеs rеlаtiоns intеrnаtiоnаlеs[9]. Lа guerrе en Ukrainе illustrе à quel pоint lе rеnfоrсеment des саpаcités militairеs еst dеvеnu un impérаtif pour lеs États mеnасés. Се phénоmène еst pаrtiсulièrеmеnt visiblе à trаvers l’аugmеntatiоn dеs dépensеs militаirеs qui аttеignеnt dеs rесords histоriquеs, еxаcеrbаnt аinsi lеs risquеs dе соnflits аrmés à l’éсhеllе mondiаlе.
Рarаllèlеment аu саdrе militаirе, lа séсurité éсonomique et énеrgétiquе s’еst révélée fоndаmеntаlе[10]. L’Ukrаinе, еn tаnt quе pаrtеnаire сlé dаns lе trаnsit du gаz vеrs l’Еurоpе, а tоujоurs оссupé unе pоsitiоn géоéсоnоmiquе strаtégiquе, qui est misе à mаl pаr la guеrre аctuellе. Lеs tеnsiоns еntоurant dеs infrastruсturеs tеllеs quе Νоrd Stream mоntrеnt соmment lе сontrôlе dеs rеssourсеs énеrgétiquеs еst devеnu un enjеu сеntrаl dаns lа luttе pоur lа sécurité dеs Étаts еurоpéens[11].
Dаns lе cаdrе de la défеnse innоvаntе, l’Ukrаinе а dévеlоppé dеs strаtégiеs pеu соnventiоnnеllеs fасе à l’аgrеssiоn russe, illustrаnt l’impоrtаnсе d’une аpproсhe tесhnоlogiquе fаcе аux défis соntеmpоrаins[12]. Ρar еxеmplе, l’usаge dе filеts dе pêche pоur сontrеr des mеnaсes аérоmаritimеs révèlе unе саpасité d’adaptаtiоn еt d’innоvаtiоn qui trаnsсеnde lеs moуens classiques dе défеnsе. Cеs répоnsеs créаtivеs mettеnt en avаnt un аspесt fоndаmеntal de lа sécurité humаinе : lа résiliеnсe.
Lа mobilisаtiоn du civil еst un аxe еnсоrе trоp souvent négligé dans lеs analуses dе séсurité humainе. Lеs еxpériеnсеs ukrаiniеnnеs mеttеnt en lumière lе bеsоin dе rеnfоrсеr lе tissu sосiаl pоur fаirе facе à des сrisеs[13].
Еn оutrе, аu-delà de lа dimеnsiоn militаrisée dе la séсurité, il еst еssеntiel d’intégrеr lеs соnsidérаtiоns dе dévеlоppеmеnt humаin. Unе attеntiоn dоit être ассоrdée à la prоtесtiоn dеs droits individuеls еt аux bеsоins fоndаmentаux des populаtiоns touсhéеs pаr lе соnflit[14].
Аinsi, lа quеstiоn dе lа séсurité humainе аujоurd’hui nе peut êtrе dissoсiéе dеs bоulеvеrsеmеnts géоpоlitiquеs en соurs, notаmmеnt аu sein de l’Ukrаine[15]. Сe соnflit nе rеprésеntе pаs uniquеmеnt un аffrоntеmеnt militairе; il еst égаlеmеnt révélаtеur d’unе rеmisе еn quеstiоn plus lаrgе dеs nоrmеs dе séсurité еt des pаrсours dе dévеlоppеmеnt humain à l’аune dеs défis соntеmpоrаins.
- Рertinеnсe dе l’étudе dаns lе саs spéсifiquе dе l’Ukrainе
L’étude de la sécurité humaine dans le contexte spécifique de l’Ukraine revêt une pertinence cruciale, amplifiée par la complexité des enjeux géopolitiques et socioéconomiques auxquels le pays est confronté. Le conflit ukrainien, qui a commencé en 2014 avec l’annexion de la Crimée et s’est intensifié avec l’agression à grande échelle de la Russie en 2022, a mis en lumière des dynamiques de sécurité qui dépassent les considérations militaires traditionnelles. Il semble évident que ces événements ne se limitent pas à un simple affrontement territorial, mais ouvrent une réflexion sur l’impact de la guerre sur la vie quotidienne des citoyens et la manière dont leur sécurité doit être envisagée[16]. En ce sens, la situation actuelle en Ukraine illustre la nécessité d’adopter une approche intégrée et multidimensionnelle de la sécurité humaine, appréhendant à la fois les dimensions physique, économique, sociale et environnementale de la vie des individus.
La réalité de l’Ukraine, en tant que champ de bataille entre des puissances mondiales, met en exergue le besoin de réévaluer la notion de sécurité globale. Alors que des nations comme les États-Unis et la Russie cherchent à étendre leur influence à travers des mécanismes militaires et diplomatiques, le peuple ukrainien se retrouve au centre de ce jeu géopolitique. Les Ukrainiens ne sont pas seulement des victimes des affrontements militaires, mais aussi des acteurs de leur destin, faisant valoir une voix qui réclame le respect de leurs droits et de leur dignité. Cette dynamique révèle que la sécurité humaine ne peut être assurée sans prendre en considération la souffrance et les aspirations individuelles, et qu’une vision étroite centrée sur les États peut transformer les citoyens en simples pions sur un échiquier géopolitique[17] .
Dans ce cadre, l’approche économique liée à la sécurité humaine est d’autant plus cruciale, tant du point de vue local qu’international. Le rôle géostratégique de l’Ukraine, en tant que corridor énergétique entre la Russie et l’Europe, a mis à jour l’interdépendance des systèmes de sécurité économiques et énergétiques. Depuis le début du conflit, les politiques européennes de diversification et de substitution ont reconfiguré l’équilibre énergétique continental, révélant à quel point la guerre en Ukraine redéfinit les enjeux de sécurité à l’échelle de l’Union[18] . Le contrôle des ressources et des infrastructures vitales est devenu un enjeu majeur, où la vulnérabilité d’un pays est intrinsèquement liée à la sécurité des autres[19].
Sur le plan technologique, l’Ukraine a démontré une capacité d’innovation remarquable face à l’agression. L’essor des solutions improvisées et l’adaptation rapide de technologies duales (par exemple les drones et les systèmes non pilotés) montrent une volonté d’affronter des menaces contemporaines en mobilisant à la fois l’ingéniosité technique et la participation civique[20]. Ce constat met en lumière le rôle central de l’innovation et de l’engagement citoyen dans la construction d’un environnement sécurisé. L’implication directe des Ukrainiens dans la défense de leur pays illustre également une conception renouvelée de la sécurité humaine, où le foyer et la communauté deviennent des bastions contre l’insécurité, nécessitant un soutien à la fois institutionnel et civique [6].
La mobilisation sociale est ainsi une autre dimension régissant la pertinence de l’étude de la sécurité humaine en Ukraine. Alors que le gouvernement ukrainien encourage le soutien communautaire pour renforcer les capacités de défense, les individus émergent comme des acteurs clés. Cela représente non seulement une évolution de la perception des rôles citoyens en temps de guerre, mais aussi une opportunité d’édifier une identité collective capable de résister aux intrusions extérieures[21] . Ce phénomène est révélateur d’une tendance plus large dans les conflits contemporains, où la sécurité humaine est de plus en plus liée à l’engagement sociétal et à la solidarité face aux défis du quotidien.
Enfin, la dimension de développement humain, souvent négligée dans les discours classiques sur la sécurité, émerge comme un élément indispensable dans l’analyse de la situation ukrainienne. La guerre a des répercussions directes sur les droits fondamentaux et les besoins essentiels des populations, comme l’accès à l’alimentation, aux soins de santé et à des conditions de vie dignes. En effet, la sécurité humaine et le développement sont intrinsèquement liés ; la mise en œuvre de politiques favorisant l’épanouissement des personnes et des communautés est primordiale pour établir des bases durables de paix et de résilience. À l’échelle globale, la hausse continue des dépenses militaires rappelle l’urgence de repenser la gouvernance de la sécurité afin de préserver l’intégrité humaine tout en gérant des menaces systémiques de plus en plus complexes[22].
En somme, la pertinence de l’étude de la sécurité humaine dans le cas de l’Ukraine réside dans sa capacité à transcender les approches traditionnelles. En confrontant les réalités multiformes de la guerre, ce cadre analytique promeut une compréhension enrichie des défis contemporains, tout en soulignant le besoin de réinventer les paradigmes de sécurité pour intégrer les voix et les réalités des populations touchées par les conflits.
- Dimеnsion théоrique еt histоriquе dеs nоuvеаux défis
- Évоlutiоn histоriquе dеs соnflits еt dеs séсurités régiоnalеs
L’évolution historique des conflits et des sécurités régionales a été marquée par des transformations profondes qui interrogent notre compréhension contemporaine de la sécurité. Historiquement, les conflits ont souvent été envisagés à travers le prisme militaire, où l’accent était mis sur les affrontements directs entre États. Cependant, le développement de nouveaux types de conflits, notamment ceux qualifiés d’hybrides, a modifié ce paradigme en incorporant des dimensions économiques, sociales et technologiques, essentielles pour saisir les enjeux de la sécurité humaine[23]
Dans le contexte du conflit ukrainien, il est pertinent d’analyser la transition des guerres conventionnelles vers des guerres hybrides, amplifiées par l’utilisation croissante de la cyberguerre et des stratégies asymétriques. Les guerres hybrides, telles que celles observées en Ukraine, illustrent cette évolution en mêlant guerres d’influence, manipulations médiatiques, attaques cybernétiques et opérations militaires classiques, rendant la sécurité traditionnelle obsolète[24]. Cette hybridité des menaces oblige les acteurs étatiques et non étatiques à repenser leur stratégie de sécurité, en intégrant des éléments civils et non militaires, qui jouent un rôle crucial dans la résilience d’une nation.
Les changements dans le paysage de la sécurité en Ukraine révèlent également l’importance de la protection des civils. La stratégie militaire russe a, par exemple, souvent visé non seulement des objectifs militaires, mais aussi des infrastructures essentielles, mettant en péril la vie quotidienne des citoyens ukrainiens. Dans cette perspective, la protection des civils s’affirme comme un impératif éthique et stratégique, orientant les politiques et les interventions internationales dans un environnement de sécurité en mutation[25]. L’incidence de cette réalité sur les vies des individus souligne que la sécurité humaine doit impérativement se concentrer sur les effets collatéraux des conflits, en intégrant la dimension des droits humains.
L’Ukraine, par son expérience vécue, incarne les défis contemporains liés aux conflits régionaux. La guerre est devenue un laboratoire pour l’exploration de concepts de sécurité innovants, où l’engagement citoyen et l’innovation technologique occupent une place centrale dans la défense nationale[26]. En effet, durant le conflit, la société ukrainienne a démontré une capacité d’adaptation remarquable, exploitant les technologies pour mobiliser les ressources et soutenir la défense. Des initiatives citoyennes composent une nouvelle forme de résilience, ce qui démontre que les acteurs non étatiques sont des entités clés dans la sécurité contemporaine
Ce processus est renforcé par une dynamique de développement humain intégrée à la sécurité, où les droits fondamentaux comme l’accès à l’éducation, à la santé et à des conditions de vie dignes sont étroitement associés à la stabilité régionale. Les actions militaires qui semblent prioritaires peuvent souvent mettre en péril ces dimensions fondamentales. Par conséquent, il est impératif de revisiter les approches sécuritaires afin d’intégrer des politiques qui favorisent le bien-être socio-économique des populations touchées par les conflits, en reconnaissant que la sécurité humaine et le développement ne sont pas des objectifs distincts, mais intrinsèquement liés[27].
Les enjeux de sécurité régionaux se trouvent également interconnectés de manière complexe avec les dynamiques de sécurité internationales. L’Ukraine est en effet un point névralgique où se mêlent les intérêts géopolitiques de grandes puissances. Dans ce cadre, le pays se retrouve pris entre des ambitions expansionnistes et des stratégies d’influence globale, rendant la compréhension de ses réalités locales d’autant plus cruciale pour appréhender le tableau plus large des relations internationales. Sur le plan énergétique, la reconfiguration accélérée de la politique de l’Union européenne (REPowerEU) illustre l’imbrication des sécurités énergétique, économique et stratégique à l’échelle continentale[28].
À la lumière de ces évolutions, il devient clair que l’analyse de la sécurité régionale ne peut se limiter à l’évaluation des forces armées ou des dispositifs de défense classiques. Il est devenu impératif de reconnaître l’importance des aspects socio-économiques et technologiques, des droits humains et des engagements civils dans les discours et actions sur la sécurité. Enfin, en recontextualisant la sécurité humaine dans des situations complexes telles que celle de l’Ukraine, nous pouvons envisager des réponses plus nuancées, adaptées à la fluidité des conflits contemporains et aux aspirations légitimes des populations. La réflexion sur la sécurité humaine devient ainsi un enjeu transversal, intégrant des intersections multiples révélatrices des défis actuels, plaçant l’individu au cœur de tout processus décisionnel.
L’évolution historique des conflits et des sécurités régionales doit impérativement passer par une réflexion approfondie et critique, intégrant la multitude d’acteurs et de dimensions qui façonnent aujourd’hui notre compréhension de la sécurité. L’exemple de l’Ukraine, avec son vécu tragique et ses innovations pragmatiques, agit comme un catalyseur pour une redéfinition nécessaire des paradigmes de sécurité, premier pas vers une sécurité humaine véritablement intégrée et respectueuse des droits fondamentaux des personnes.
- Théоriеs dе lа sécurité humаinе аdаptéеs аu cоntеxte ukrаiniеn
La sécurité humaine, en tant que concept transversal, trouve une application particulièrement pertinente dans le contexte ukrainien, où les dynamiques de la guerre hybride révèlent de manière dramatique la fragilité de la vie humaine face aux conflits contemporains. En Ukraine, la violence ne se limite pas aux affrontements militaires classiques, mais s’étend à une palette de menaces englobant des éléments politiques, économiques et sociaux, soulignant ainsi la nécessité d’une réponse globale à ces défis. Le conflit actuel, avec son utilisation sophistiquée de la désinformation, des cyberattaques et de la guerre par procuration, constitue un terrain d’expérimentation pour des théories de la sécurité humaine qui cherchent à intégrer ces diverses dimensions au-delà des stratégies militaires traditionnelles[29].
Une des principales théories de la sécurité humaine peut être conceptualisée à travers le prisme de la résilience, où l’accent est mis sur la capacité des individus et des communautés à s’adapter et à répondre aux crises. Dans le cas de l’Ukraine, cette résilience s’est manifestée par l’auto-organisation de la société civile et l’adaptation rapide aux menaces hybrides[30], y compris dans l’espace cyber, ce qui met en lumière le rôle des acteurs non étatiques et la nécessité d’innovations permanentes en cybersécurité.
Parallèlement, la protection des civils apparaît comme un impératif à la fois éthique et stratégique. Les frappes visant des infrastructures essentielles rappellent que la planification et la conduite des opérations doivent intégrer, à tous les niveaux, des dispositifs robustes de protection des populations et du tissu social, conformément aux cadres doctrinaux et humanitaires contemporains[31].
Dans cette perspective, la sécurité humaine en Ukraine gagne à être pensée de manière holistique, en reliant les dimensions sécuritaires traditionnelles aux enjeux de développement durable (accès à l’éducation, à la santé et à des conditions de vie dignes). Ce déplacement du centre de gravité – de la seule défense vers le bien-être socio-économique – s’inscrit dans l’approche renouvelée du Programme des Nations unies pour le développement sur les menaces « interconnectées » à l’ère de l’Anthropocène .
Les répercussions régionales et internationales du conflit illustrent aussi l’imbrication des sécurités énergétique, économique et stratégique. La reconfiguration européenne engagée par le plan REPowerEU, visant la réduction accélérée de la dépendance aux hydrocarbures russes et la sécurisation des approvisionnements, montre comment un théâtre de guerre hybride produit des effets systémiques bien au-delà de la ligne de front[32].
Enfin, replacer la sécurité humaine au cœur de l’analyse implique d’intégrer la montée historique et soutenue des dépenses militaires, qui recompose les priorités publiques et accroît les arbitrages sociaux, ce que documentent les séries récentes du SIPRI sur l’année 2024[33]. Cela renforce l’urgence d’approches de sécurité qui protègent simultanément les populations, les institutions civiles et les capacités de développement à long terme .
- Ιdеntifiсаtion dеs mеnаces hуbridеs et аsymétriquеs
L’identification des menaces hybrides et asymétriques dans le contexte ukrainien nécessite une approche analytique qui dépasse les paradigmes militaires conventionnels. Dans un environnement de conflit où les frontières entre guerre traditionnelle et autres formes de violence s’estompent, la compréhension des menaces hybrides devient cruciale. Ces menaces incluent non seulement des engagements militaires directs mais aussi des éléments comme la désinformation, les cyberattaques, et l’utilisation de groupes paramilitaires ou de forces par procuration[34], illustrant la complexité du paysage sécuritaire actuel
Le conflit en Ukraine est emblématique de ces dynamiques hybrides. La Russie a employé des stratégies variées intégrant à la fois des armes classiques et des tactiques non conventionnelles pour atteindre ses objectifs géopolitiques. La guerre hybride, dans ce cadre, désigne l’utilisation simultanée de plusieurs formes d’attaque pour déstabiliser un adversaire. Comme le souligne LTCOL J. Raitasalo, le doute et le malaise se propagent non seulement par des actions militaires, mais aussi par des incertitudes économiques et sociales — ce qui expose les limites des modèles de défense traditionnels et requiert une réévaluation des approches stratégiques
Sur le plan cybernétique, la vulnérabilité des infrastructures ukrainiennes a été mise en lumière par des attaques ciblées visant des systèmes critiques. James A. Lewis montre que, si l’expression « cyber war » est discutable, l’Ukraine constitue le premier conflit majeur impliquant des opérations cyber à large échelle, ce qui entremêle dimensions technologiques et humaines de la sécurité et appelle des coalitions public-privé plus robustes[35]. Parallèlement, l’expérience ukrainienne souligne que la cybersécurité n’est pas qu’un enjeu technique mais un facteur de résilience sociétale face aux intrusions et aux chocs prolongés
L’élément de désinformation constitue également un pilier des stratégies hybrides. Les campagnes de propagande visant à influencer l’opinion publique jouent un rôle déterminant dans la manipulation des perceptions, en Ukraine comme à l’étranger. Les analyses récentes de l’UE documentent des opérations coordonnées mêlant récits falsifiés[36], détournements d’événements réels et tactiques info-psychologiques, ce qui exige des dispositifs de protection informationnelle et de littératie médiatique renforcés
Une autre facette des menaces asymétriques réside dans l’usage d’acteurs non étatiques (groupes paramilitaires/proxies), souvent tolérés ou soutenus par des États, compliquant l’attribution et la responsabilité. Cette opacité opérationnelle intensifie les risques pour les civils et alimente des cycles de violence et d’incertitude — d’où la nécessité d’approches intégrées qui combinent sécurité humaine[37], droit international humanitaire et stabilisation locale.
Face à ces réalités, la protection des civils devient un impératif éthique et stratégique. Les cadres de l’OTAN insistent pour que la protection des populations soit intégrée à tous les niveaux de planification et de conduite des opérations, tandis que le CICR met en garde contre la spécificité destructrice des combats urbains et l’emploi d’armes explosives en zone peuplée.
Enfin, répondre aux menaces hybrides exige des plans d’action intégrés : renforcement de la résilience communautaire, partenariats public-privé en cybersécurité, lutte structurelle contre la désinformation, et coopération transnationale pour protéger les infrastructures critiques et harmoniser les contre-mesures — axes aujourd’hui au cœur des politiques européennes[38] (p. ex. initiatives de résilience et protection des infrastructures au sein de l’OTAN et de l’UE)
- Lеs еnjеux de lа gоuvеrnanсе еn situаtiоn dе crisе
La gouvernance en situation de crise, notamment dans le cadre du conflit ukrainien, illustre la nécessité de repenser les mécanismes classiques de l’action publique face à des menaces hybrides. Celles-ci mêlent simultanément dimensions militaires, économiques, sociales et informationnelles, bouleversant la distinction traditionnelle entre paix et guerre, entre État et acteurs non étatiques[39]. Dans un tel contexte, la gouvernance ne peut plus se limiter à la seule gestion militaire des crises : elle doit intégrer la protection des civils, la résilience des infrastructures essentielles et la continuité des institutions démocratiques. L’Ukraine constitue à ce titre un laboratoire unique où se révèlent les limites des approches conventionnelles de commandement et contrôle, obligeant à concevoir une architecture de gestion de crise beaucoup plus inclusive [40].
La guerre hybride combine ainsi des attaques cinétiques traditionnelles, des cyber-opérations, des campagnes de désinformation et l’emploi de groupes paramilitaires. Comme le note Raitasalo, cette hybridité impose d’adopter une approche qui conjugue sécurité militaire et sécurité humaine, en plaçant la sauvegarde des populations au centre des préoccupations stratégiques. La gouvernance devient alors un processus multidimensionnel : elle doit protéger les infrastructures, préserver les droits fondamentaux et maintenir la confiance des citoyens dans l’action publique. La protection des civils n’est pas uniquement un impératif éthique : elle conditionne directement la stabilité sociale et politique à long terme .
L’information constitue une autre dimension critique. Les campagnes de propagande et de désinformation visent à affaiblir la cohésion sociale, à semer le doute sur la légitimité des institutions et à manipuler l’opinion internationale. Les institutions démocratiques doivent ainsi renforcer leur résilience communicante, en privilégiant la transparence et l’éducation citoyenne, tout en contrant activement les narratifs fallacieux. Comme l’ont montré les études de l’Union européenne, la perception du risque et la confiance dans la communication officielle peuvent peser autant que la réponse militaire elle-même[41]. Une gouvernance efficace doit donc conjuguer gestion stratégique de l’information, contrôle des flux numériques et pédagogie sociale visant à limiter l’impact psychologique de la guerre hybride.
Sur le plan économique et technologique, la guerre en Ukraine a révélé une forte vulnérabilité des systèmes nationaux face aux cyberattaques. Les attaques visant des infrastructures critiques – transport, énergie, communication – démontrent que la cybersécurité est désormais une composante centrale de la gouvernance moderne. Elle ne peut être perçue comme un domaine technique isolé : elle est intrinsèquement liée au développement économique, à la stabilité politique et à la sécurité humaine. Le plan REPowerEU de l’Union européenne illustre cette imbrication, en cherchant à sécuriser les approvisionnements énergétiques tout en renforçant la résilience numérique. Ces dynamiques appellent une approche systémique, qui articule cybersécurité, gouvernance économique et coopération transnationale.
L’émergence d’acteurs non étatiques armés – groupes paramilitaires, mercenaires ou proxies soutenus par des États – complexifie encore davantage la gestion des crises. En Ukraine, leur rôle contribue à brouiller l’attribution des responsabilités, à multiplier les violences et à éroder l’autorité des institutions nationales. Face à ces menaces asymétriques, la gouvernance doit évoluer vers des modèles plus flexibles, associant cadres juridiques adaptés, coopération internationale et mobilisation locale. L’articulation entre autorités publiques et initiatives communautaires apparaît dès lors essentielle pour contenir les menaces et restaurer la stabilité[42].
Au centre de cette architecture, la protection des civils demeure une priorité absolue. Les cadres de l’OTAN insistent pour que la protection des populations soit intégrée dès la phase de planification opérationnelle, afin d’assurer la légitimité de l’action militaire et politique[43]. Le CICR, pour sa part, rappelle que la guerre urbaine expose les sociétés civiles à des risques accrus, ce qui impose une adaptation urgente des doctrines militaires et des dispositifs de gouvernance. La résilience de la société civile ukrainienne, qui a démontré une remarquable capacité d’auto-organisation face aux menaces hybrides, constitue un exemple probant de l’importance de l’engagement citoyen dans la gouvernance des crises.
En définitive, l’expérience ukrainienne montre que la gouvernance en situation de crise ne peut se réduire à des réponses militaires. Elle doit embrasser une approche holistique et dynamique, intégrant simultanément sécurité militaire, résilience économique, cybersécurité, protection des civils et communication démocratique. Ce modèle expérimental de gouvernance hybride ouvre des perspectives sur l’avenir de la sécurité humaine dans un monde marqué par l’incertitude et la complexité . L’Ukraine devient ainsi un espace d’innovation institutionnelle, révélant des leçons cruciales sur la résilience, la responsabilité et l’engagement civique, et offrant un cadre de référence pour repenser les paradigmes contemporains de la gouvernance de crise.
- Rôlе еt influenсе dеs асtеurs nоn étatiquеs dаns lе cоnflit
Dans le conflit en Ukraine, les acteurs non étatiques occupent une place déterminante dans la redéfinition des normes de sécurité humaine. Leur rôle, qu’il s’agisse de groupes armés, d’organisations civiles ou de réseaux informels, illustre la complexité des guerres hybrides contemporaines. Comme l’explique Hoffman, la guerre hybride repose sur une combinaison flexible de moyens conventionnels et non conventionnels, ce qui confère aux acteurs non étatiques une influence disproportionnée lorsqu’ils exploitent les vulnérabilités des États[44].
La mobilisation de ces acteurs en Ukraine révèle leur capacité d’adaptation. Freedman montre que les conflits modernes dépassent les affrontements militaires classiques, en intégrant des dimensions sociales et psychologiques[45]. Les groupes non étatiques contribuent non seulement à renforcer la puissance des belligérants, mais aussi à façonner les perceptions collectives et à influencer le moral des populations – un facteur crucial dans un conflit où l’adhésion civique devient une ressource stratégique.
Leur influence s’étend également à la sphère socio-économique. Kaldor souligne que les « nouvelles guerres » se caractérisent par l’effacement des frontières entre guerre, criminalité et politique, ce qui fragilise la gouvernance étatique et accroît les tensions sociales[46]. En Ukraine, certains groupes non étatiques assurent une assistance locale, mais au prix de nouvelles formes d’inégalités ou de clientélisme, mettant en péril la cohésion sociale.
Dans le cyberespace, ces acteurs disposent d’outils qui démultiplient leur impact. Rid rappelle que la guerre cybernétique ne vise pas seulement des infrastructures, mais aussi les esprits, par le biais de campagnes de désinformation et de propagande[47]. La diffusion de récits falsifiés par des réseaux non étatiques en Ukraine illustre la menace informationnelle, qui mine la confiance du public dans les institutions.
Enfin, la protection des civils demeure une priorité éthique et stratégique. Pour Bellamy, intégrer cette protection dans les doctrines de sécurité constitue non seulement une exigence morale, mais aussi une condition de légitimité pour toute gouvernance de crise[48]. Ainsi, les acteurs non étatiques ne doivent pas être perçus uniquement comme des perturbateurs : ils peuvent devenir, dans certains cas, des partenaires à inclure dans des dispositifs de gouvernance partagée.
En conclusion, l’expérience ukrainienne démontre que la sécurité humaine dans les conflits hybrides dépend d’une approche intégrée. Les États doivent adapter leurs stratégies pour articuler la puissance militaire, la cybersécurité, la protection humanitaire et la coopération avec des acteurs non étatiques, afin de construire une résilience sociétale durable.
- Αnаlysе dеs еnjeux сontеmpоrains еn Ukrаinе
- Соnflits armés еt lеur répеrсussiоn sur lа stаbilité régionаle
La persistance du conflit armé en Ukraine exerce des effets systémiques sur la stabilité régionale, en combinant chocs sécuritaires, pressions économiques et recompositions diplomatiques. À l’échelle humaine, ces dynamiques se traduisent par une dégradation des conditions de vie, des déplacements massifs et une tension durable sur les services essentiels ; l’ampleur des besoins humanitaires documentés par les plans conjoints de l’ONU et de ses partenaires en atteste[49]. Les mouvements de populations—réfugiés à l’étranger et personnes déplacées internes—reconfigurent les équilibres sociaux en Ukraine et sollicitent les capacités d’accueil des pays voisins, où émergent des défis budgétaires, d’accès au logement, à la santé et à l’éducation, avec des répercussions sur la cohésion sociale et le débat public[50].
Sur le plan géopolitique, la guerre redessine les rapports de force en Europe orientale, nourrit l’incertitude stratégique et ouvre des marges d’ingérence pour des acteurs extérieurs. Les États riverains arbitrent entre solidarité politique, impératifs de sécurité et contraintes domestiques, dans une diplomatie « sous pression » où les principes doivent composer avec les coûts et risques encourus[51]. La montée des dépenses militaires observée à l’échelle mondiale accentue ce « paradoxe stabilité-instabilité » : la recherche de dissuasion peut simultanément accroître la volatilité du système de sécurité, d’où la nécessité de mécanismes robustes de gestion de crise, de canaux de déconfliction et d’une planification centrée sur la protection des civils[52].
Les interdépendances énergétiques agissent comme multiplicateurs de risques et d’opportunités. Les attaques sur les infrastructures, les ruptures logistiques et la volatilité des prix ont accéléré en Europe la diversification des approvisionnements et la réduction de la dépendance aux hydrocarbures russes : la stratégie REPowerEU articule sécurité d’approvisionnement, efficacité énergétique et transition, tandis que des recommandations opérationnelles ciblent la protection et le rétablissement des réseaux critiques[53]. Cette reconfiguration lie intimement sécurité, économie et politique industrielle, et conditionne la résilience macroéconomique des pays affectés.
La conflictualité contemporaine dépasse le seul affrontement conventionnel. Acteurs non étatiques, opérations d’influence et cybermenaces pèsent sur la confiance publique, la continuité des services et l’accès humanitaire. C’est dans ce contexte que les doctrines et pratiques opérationnelles intègrent plus fermement la protection des civils—non seulement comme impératif éthique, mais comme condition de légitimité et d’efficacité des réponses de sécurité[54]. Parallèlement, la trajectoire de reprise économique dépend de la reconstruction d’actifs, du financement de la relance et de l’ancrage réformateur ; la littérature institutionnelle récente souligne la nécessité de dispositifs de financement prévisibles, d’un cadre de gouvernance clarifié et d’un partenariat étroit entre bailleurs publics et capitaux privés.
Enfin, la crise migratoire et humanitaire induite par la guerre demeure un test pour la solidarité régionale et la gouvernance multilatérale. Les données de suivi confirment un besoin soutenu en protection, abris, santé et moyens d’existence, ainsi que l’importance d’une coordination efficace entre autorités, ONG et agences onusiennes pour garantir des voies d’accès sûres, prévenir les abus (traite, violences basées sur le genre) et soutenir l’intégration dans la durée. Au total, une approche véritablement holistique de la sécurité humaine s’impose : articuler prévention et gestion des risques, protection des civils, résilience énergétique et économique, transparence de l’action publique et diplomatie préventive—seule combinaison à même de réduire la vulnérabilité des populations tout en consolidant la stabilité régionale[55].
- Ρrоpаgаtiоn dе lа désinfоrmatiоn еt lа guеrrе de l’informаtion
La guerre en Ukraine a révélé l’ampleur de la désinformation et de la guerre de l’information, devenues des outils stratégiques majeurs du conflit. La désinformation a pris des formes multiples, allant de la diffusion de fausses informations militaires à des campagnes coordonnées visant à saper la confiance des populations envers leurs gouvernements et institutions[56]. Ce brouillage informationnel, caractéristique de la guerre hybride, transforme l’information en un champ de bataille à part entière[57].
L’impact de la désinformation se manifeste dans sa capacité à influencer l’opinion publique, non seulement en Ukraine mais aussi à l’étranger. Fausse contextualisation d’images, faux témoignages ou récits fabriqués circulent massivement, façonnant des perceptions qui influencent décisions politiques et diplomatiques. Comme le souligne une étude de l’Union européenne, ces récits toxiques fragilisent la cohésion sociale et créent une atmosphère de méfiance, rendant plus difficile la résilience des sociétés en contexte d’insécurité[58].
Toutefois, l’Ukraine et ses alliés ont aussi engagé une contre-offensive informationnelle, mobilisant communication stratégique, éducation citoyenne et campagnes de sensibilisation. Ces efforts visent à renforcer la résilience sociale et à galvaniser le soutien international, démontrant que la guerre de l’information est également une lutte pour le jugement critique des citoyens.
Les implications éthiques de cette guerre cognitive interrogent la responsabilité des médias et des plateformes numériques, devenus des vecteurs de propagation massive. Les réseaux sociaux constituent un terrain où la lutte pour la vérité est centrale[59] : la capacité des citoyens à développer un esprit critique face aux infox devient une composante fondamentale de la sécurité humaine.
La désinformation affecte aussi la perception des crises humanitaires. Les réfugiés ukrainiens ont parfois été victimes de narratifs hostiles exagérant leur impact économique ou sécuritaire, alimentant des réactions xénophobes dans certains pays d’accueil.
Cette instrumentalisation de la migration illustre comment la manipulation de l’information peut fragiliser la solidarité et compliquer la gestion de l’aide humanitaire.
Enfin, les organisations internationales, comme l’ONU, doivent naviguer dans cet environnement saturé de récits contradictoires. Leur crédibilité repose sur une communication transparente et une gestion rigoureuse de la vérité en temps de crise. Des accusations de partialité peuvent miner la confiance et limiter la coopération des parties prenantes[60]. Pour contrer ces effets, une coopération renforcée entre États, médias et société civile apparaît essentielle afin de produire des narratifs fiables et inclusifs, capables d’unir plutôt que de diviser.
En définitive, la guerre de l’information et la désinformation ne doivent pas être comprises uniquement comme des tactiques adversariales, mais comme un défi fondamental pour la sécurité humaine et la coexistence pacifique. La résilience sociétale face à ce phénomène est désormais une composante incontournable de la stabilité régionale et globale.
- Répоnsеs pоlitiquеs еt initiаtives loсаlеs faсе aux défis séсuritаirеs
Dans le contexte de la guerre en Ukraine, les réponses politiques et les initiatives locales face aux défis sécuritaires se sont intensifiées et diversifiées, reflet d’un conflit qui engage des dimensions militaires, sociales et psychologiques. Les autorités ukrainiennes ont dû élaborer des stratégies proactives pour répondre à la menace militaire tout en atténuant les effets de la guerre sur la vie quotidienne—énergie, logement, santé, éducation—avec un besoin de financement de la reconstruction estimé à des centaines de milliards sur la prochaine décennie[61],
Cette approche s’articule désormais autour d’une double logique : renforcer la défense tout en consolidant la résilience des communautés, notamment par des programmes d’information et d’éducation civique contre la désinformation et par le soutien à des services publics essentiels[62].
La coopération internationale constitue un pilier de cette résilience. L’Union européenne et ses partenaires ont mobilisé des instruments financiers pluriannuels (Ukraine Facility) et des garanties ciblées pour sécuriser l’approvisionnement énergétique et soutenir les infrastructures critiques, en complément d’aides humanitaires et d’appuis à la gouvernance[63] . En parallèle, les cadres de partenariat OTAN visent à accroître les capacités et la résilience du secteur de la sécurité ukrainien, tout en rappelant que la protection des civils est à la fois un impératif éthique et stratégique dans la planification et la conduite des opérations[64] .
À l’échelle municipale, des dispositifs concrets d’accueil, de santé, de transport ou d’éducation ont été déployés—comme en attestent des initiatives documentées à Odessa—et des jumelages « villes-villes » UE-Ukraine soutiennent la continuité des services urbains et la reconstruction locale[65].
Le défi informationnel demeure central. Pour contrecarrer la guerre de l’information et ses effets corrosifs sur la confiance publique, des cellules de communication ont été mises en place avec des ONG et des journalistes citoyens, favorisant des pratiques de vérification et d’éducation critique du public. Cette lutte s’inscrit dans une perspective plus large de sécurité humaine, où l’accès fiable à l’information et la cohésion sociale conditionnent la capacité à absorber les chocs et à maintenir l’unité nationale[66].
Sur le plan humanitaire, l’ONU coordonne une réponse multisectorielle d’ampleur afin de répondre aux besoins vitaux de millions de personnes, en Ukraine et dans la région. Les plans 2025 de l’OCHA et les tableaux de bord de l’UNHCR montrent l’ampleur persistante des besoins (abris, énergie, santé mentale, protection) et la nécessité d’articuler l’urgence avec des trajectoires de relèvement et de réintégration durables[67]. Enfin, la mobilisation du secteur privé—aux côtés des bailleurs, de la Banque mondiale et des autorités ukrainiennes—est encouragée pour accélérer la reconstruction d’infrastructures modernes, sobres en énergie et plus résilientes[68], condition décisive d’une paix durable et d’une croissance inclusive.
- Réсapitulаtif dеs соnstаts majеurs еt dеs impасts idеntifiés
Les constats majeurs relatifs à la situation en Ukraine mettent en exergue plusieurs dimensions critiques de la sécurité humaine, révélant les interconnexions entre les menaces militaires, la détérioration sociale et les défis économiques. D’une part, le conflit a généré une série d’impacts à la fois immédiats et à long terme sur les vies des citoyens, affectant leurs droits fondamentaux et leur qualité de vie[69]. La guerre a non seulement engendré des pertes humaines et matérielles, mais a également exacerbé les vulnérabilités préexistantes des populations, créant un climat de peur et d’insécurité qui mine progressivement les fondements de la cohésion sociale[70].
Un constat significatif est la capacité d’adaptation des acteurs du terrain face aux défis imposés par ce conflit. Les autorités locales ont démontré une résilience remarquable en travaillant à des solutions innovantes et réactives, comme l’illustrent les exemples de Lviv et d’Odessa, où des programmes d’accueil pour réfugiés ont été rapidement mis en place. Ces programmes ont non seulement facilité l’intégration des déplacés, mais ont également contribué à minimiser les tensions intercommunautaires, illustrant l’importance d’une approche humanitaire ciblée en période de crise.
Par ailleurs, le phénomène de désinformation a été identifié comme un obstacle majeur à la confiance dans les institutions locales et à l’efficacité des efforts de réponse à la crise. L’incapacité à contrer les narrations mensongères ajoute à la complexité du tableau sécuritaire en Ukraine. Les cellules de communication établies en réaction à ces menaces témoignent de la volonté des gouvernements locaux d’opérer en synergie avec la société civile. Il devient alors primordial de cultiver un espace public informé, où les citoyens peuvent non seulement recevoir des informations fiables, mais aussi participer activement à la vérification des faits[71].
Concernant les impacts économiques, la guerre en Ukraine a eu des conséquences dévastatrices. Les infrastructures ont été sévèrement touchées, ce qui compromet les efforts de réhabilitation tant au niveau local que national. La mise en œuvre d’initiatives de survie économique, telles que le soutien aux entreprises locales et la protection des services essentiels, est désormais essentielle pour favoriser la résilience à long terme. À ce titre, le soutien international joue un rôle crucial, en aidant non seulement sur le plan militaire, mais aussi via des programmes destinés à stimuler la croissance et la revitalisation économique[72] .
Les concurrents géopolitiques, en particulier ceux ayant des intérêts dans cette région, ajoutent une couche de complexité supplémentaire. Les rivalités entre grandes puissances ont un impact direct sur la perception de la sécurité humaine en Ukraine et sur la manière dont les politiques sont perçues et mises en œuvre à l’échelle locale. Les tensions géopolitiques influencent les flux d’information, compliquant davantage la gestion de l’actualité pour les acteurs locaux et la société[73] . De fait, trouver un équilibre entre les influences externes et les besoins du terrain reste un défi de taille.
Il n’est pas moins important de considérer les dimensions psychologiques découlant de ce conflit. Les traumatismes perdurent chez les populations affectées, élargissant la portée des impacts de la guerre bien au-delà des pertes immédiates. Des initiatives psychologiques et psychosociales doivent être intégrées dans la réponse humanitaire afin de soutenir la santé mentale et le bien-être des citoyens, condition sine qua non pour une récupération durable[74].
En conclusion, les constats relatifs à la sécurité humaine en Ukraine révèlent l’interdépendance des dimensions militaire, sociale et économique dans la lutte pour une paix durable. Les stratégies mises en place pour contrer ces défis démontrent que la résilience des sociétés repose non seulement sur un cadre politique robuste, mais aussi sur une forte implication communautaire et un appui international concerté[75]. Ces leçons, bien qu’éprouvées dans la douleur, pourraient également esquisser un chemin vers une renaissance de la cohésion sociale et de la prospérité en Ukraine, si l’on parvient à capitaliser sur les dynamiques de solidarité et d’engagement local qui se sont intensifiées en période de crise.
- Limitеs dе l’аnalуsе еt réflexiоn sur lеs inсеrtitudеs
L’analyse de la situation en Ukraine met en lumière plusieurs limites qui entravent une compréhension exhaustive des enjeux de sécurité humaine. Tout d’abord, l’une des difficultés majeures réside dans la nature changeante et dynamique du conflit. Les événements récents révèlent que les facteurs déterminants de la sécurité humaine possèdent une complexité qui ne permet pas de tracer des conclusions définitives. Par exemple, alors que les instances internationales et locales tentent d’évaluer les effets à long terme de la guerre, la fluidité des relations géopolitiques et les répercussions des interventions extérieures compliquent cette tâche[76]. En effet, la comparaison des événements passés, comme les crises humanitaires de la guerre dans les Balkans ou celle en Syrie, rappelle que les leçons de l’histoire ne garantissent pas une réponse adéquate dans un contexte aussi unique que celui de l’Ukraine[77].
Un autre aspect essentiel est la question des incertitudes. Le déterminisme des actions menées par les acteurs locaux, qu’ils soient militaires ou civils, est soumis à un ensemble d’impondérables, notamment les réactions internationales et l’écosystème médiatique. L’influence croissante des réseaux sociaux amplifie la désinformation, ce qui a un impact direct sur la façon dont les populations perçoivent la sécurité et les menaces[78]. Cette mésinformation engendre des biais significatifs dans les réponses communautaires, rendant l’engagement des citoyens avec leurs institutions plus fragile. L’impossibilité de prévoir des scénarios conflictuels basés sur une analyse rationnelle des événements passés soulève des interrogations sur la capacité d’agir face aux menaces émergentes.
De plus, la multitude de crises simultanées, telles que la pandémie de COVID-19 et ses répercussions économiques, a exacerbé les problèmes déjà existants en Ukraine et mis à jour une fragilité systémique. Les institutions locales, souvent débordées et à court de ressources, peinent à répondre efficacement aux besoins croissants des populations impactées. Les initiatives qui émergent dans cette situation, bien qu’elles soient essentielles à la résilience des communautés, subissent parfois des limites quantitatives et qualitatives, affectant ainsi l’impact global sur la sécurité humaine[79]. Cette tension entre l’urgence des actions et la disponibilité des ressources souligne une incertitude systémique qui influence la perception de la sécurité au sein de la population.
La dimension psychologique associée à la guerre est également marquée par des incertitudes. Les traumatismes psychiques résultant des conflits armés peuvent générer des effets à long terme sur la santé mentale des citoyens. Le manque de soutien psychologique adéquat et la stigmatisation associée à la recherche de ce dernier laissent de nombreux individus dans un état de souffrance silencieuse. La persistance de ces traumatismes, souvent invisibles et non abordés, pose un défi sérieux à la réhabilitation sociale et au processus de guérison.
Enfin, la difficulté d’interpréter le phénomène de mobilisations collectives en réaction à la guerre démontre aussi des limites. Les mouvements sociaux peuvent être à la fois des agents de changement et des reflets des inquiétudes sociales. Cependant, il est délicat d’interroger leur efficacité dans un environnement aussi polarisé, où les tensions et la peur peuvent étouffer l’engagement civique[80]. Si les autorités locales essaient de renforcer le lien entre le gouvernement et la société civile, elles se heurtent à une méfiance intrinsèque alimentée par des expériences passées de mauvaise gestion.
En somme, la compréhension des limites de l’analyse sur la sécurité humaine en Ukraine doit être replacée dans une approche systémique permettant d’analyser les tensions et les interconnexions qui se manifestent à toutes les échelles. Les incertitudes, qu’elles soient d’ordre militaire, économique ou sociale, font partie intégrante d’un paysage complexe qui requiert non seulement une multitude d’analyses, mais aussi une interactivité permanente entre les acteurs concernés pour espérer esquisser des avenues vers un avenir plus serein. Ce faisant, il est crucial que les réponses aux crises prennent en compte les dynamiques locales tout en étant sensibles aux manipulations externes qui pourraient fausser la lecture des événements et la perception de la sécurité humaine..
- Рistеs pour renforсеr la sécurité humаine à l’échellе intеrnаtiоnale
Pour renforcer la sécurité humaine à l’échelle internationale, il apparaît essentiel d’élaborer des stratégies qui prennent en compte la diversité des défis contemporains—de la guerre en Ukraine aux crises environnementales et pandémiques—tout en favorisant la coopération entre les nations. Les événements récents soulignent la nécessité d’une approche collaborative face à des menaces multidimensionnelles qui dépassent les frontières nationales, en ligne avec la conception onusienne de la sécurité humaine comme « liberté par rapport à la peur, au besoin et à l’indignité »[81]. La prise de conscience croissante des vulnérabilités humaines a créé un cadre propice à des initiatives visant le bien-être des populations, articulées autour des Objectifs de développement durable et des normes de protection internationale[82] .
Une première voie consiste à renforcer les systèmes de protection des droits humains en intégrant la dignité humaine au cœur des politiques de sécurité. Les États peuvent coopérer pour mettre en place des protocoles de réponse rapide aux violations graves—enquêtes, mécanismes de plainte, assistance juridique et psychosociale—et pour soutenir la lutte contre l’impunité, notamment via des capacités nationales de justice et des partenariats avec des juridictions internationales. Un tel engagement doit inclure des évaluations d’impact sur les populations affectées par les conflits, comme en Ukraine, où la documentation des atteintes aux droits demeure centrale pour la protection et la réparation.
Une deuxième voie réside dans l’accompagnement d’initiatives locales qui renforcent la résilience des communautés touchées. Conçues en partenariat avec les acteurs du terrain, ces réponses s’ancrent dans le tissu social, mobilisent des ressources endogènes et favorisent l’appropriation des solutions[83]. L’expérience ukrainienne montre que le soutien aux structures locales—collectivités, ONG, réseaux de santé mentale et d’éducation—peut avoir un effet multiplicateur sur la capacité de réponse en temps de crise, en stimulant des dynamiques de solidarité et d’entraide, et en facilitant l’accès à des services essentiels.
Il est également crucial d’investir dans l’éducation à la paix et à la sécurité humaine. Des curricula intégrant compréhension des conflits, droits humains, littératie médiatique et mécanismes de dialogue permettent de développer la pensée critique et de réduire l’emprise de la désinformation, désormais partie intégrante des environnements conflictuels. À plus long terme, ces approches contribuent à une culture de prévention et d’inclusion, en habilitant les jeunes générations à co-construire des sociétés plus résilientes et moins perméables aux discours polarisants.
Une troisième piste consiste à faire du développement durable un pilier des politiques de sécurité. L’interdépendance sécurité–développement suppose d’articuler l’aide humanitaire à des investissements durables dans les infrastructures essentielles (énergie, santé, éducation, numérique), la gouvernance transparente et la cohésion sociale[84]. Dans des contextes marqués par les chocs climatiques, la planification de l’adaptation (Sendai/DRR, systèmes d’alerte précoce, filets sociaux) réduit les risques et les coûts futurs, et diminue les facteurs d’instabilité[85]. Pour l’Ukraine, la reconstruction « mieux reconstruire » (Build Back Better) associant verdissement, redevabilité et inclusion sociale est déterminante pour une paix durable[86] .
Enfin, il est indispensable d’intensifier la coopération face aux menaces transnationales. Les alliances régionales et les organisations internationales doivent développer des plateformes de dialogue et de financement qui abordent de manière intégrée la sécurité alimentaire, la santé globale, la cybersécurité, la mobilité humaine et les droits fondamentaux . Cela implique des mécanismes de préparation et de riposte communs, des échanges d’expertise et de données fiables, ainsi que des financements stables pour traiter les causes profondes des conflits. Une approche préventive, holistique et inclusive, fondée sur la solidarité et l’interdépendance, augmente la capacité collective à préserver la dignité et les droits des populations affectées—en Ukraine comme ailleurs.
- Ιmpliсаtions pоur unе сооpératiоn intеrnatiоnаlе rеnоuvеléе
La nécessité d’une coopération internationale renouvelée est essentielle pour relever les défis contemporains liés à la sécurité humaine, en particulier dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les événements récents révèlent que les enjeux de sécurité humaine ne peuvent plus être abordés de manière isolée, mais doivent plutôt être considérés dans une dynamique de coopération entre Nations[87]. En réponse à cette réalité, il est crucial d’explorer des stratégies qui favorisent un partenariat renforcé entre les États, les organisations internationales et la société civile, permettant ainsi une action collective efficace face aux crises actuelles et futures.
Dans cette optique, il convient d’accentuer les efforts de diplomatie préventive et de mise en réseau au niveau international. La guerre en Ukraine a mis en lumière les vulnérabilités et les menaces qui transcendent les frontières, rendant impératif un cadre international cohérent[88]. Les États doivent s’engager dans des discussions ouvertes sur des plateformes variées, facilitant l’échange d’informations et de ressources pour mieux comprendre les dynamiques de conflit et élaborer des réponses adaptées[89]. La mise en place de mécanismes de coopération, ciblant spécifiquement les violations des droits humains et l’assistance aux victimes, pourrait constituer un point focal de collaboration internationale[90].
L’accent doit également être mis sur le soutien à des initiatives locales qui renforcent la résilience des communautés touchées par des conflits, comme observé en Ukraine. Ces initiatives doivent être conçues pour intégrer les besoins spécifiques des populations locales, en leur permettant de s’engager activement dans la reconstruction de leur environnement et de leur communauté[91]. En mobilisant les ressources locales et en renforçant les capacités des acteurs communautaires, les initiatives peuvent devenir des leviers pour une paix durable, réduisant ainsi les tensions et améliorant la cohésion sociale.
Parallèlement à ces initiatives, il est crucial d’appréhender le développement durable comme un volet central des stratégies de sécurité humaine. La guerre en Ukraine a révélé que les conflits peuvent être alimentés par des inégalités sociales, économiques et environnementales exacerbées[92]. Par conséquent, il est vital que les politiques de sécurité soient intégrées aux objectifs de développement durable, créant des liens entre l’aide humanitaire et des programmes de développement à long terme. Un partenariat international solide peut aider à établir des normes et des engagements clairs en matière de soutien aux pays en développement, favorisant ainsi la stabilité et la résilience face à des crises multiples[93].
Dans le cadre d’une approche collective, la coopération entre États doit également prendre en compte les menaces transnationales, telles que le terrorisme, le trafic de personnes et les crises environnementales. Les leçons tirées de la guerre en Ukraine démontrent que des réponses isolées ne sont souvent pas suffisantes. L’établissement d’alliances stratégiques et le renforcement des organisations internationales sont indispensables pour élaborer des solutions intégrées qui abordent les préoccupations interconnectées de sécurité humaine.
Dans cette recherche d’une coopération internationale renouvelée, l’éducation à la sécurité humaine joue un rôle fondamental. Il est important de veiller à ce que les jeunes générations soient formées à comprendre les dynamiques des conflits, les enjeux liés aux droits humains et les mécanismes de dialogue et de médiation[94]. En renforçant leur capacité à s’engager de manière informée, les jeunes peuvent devenir des acteurs de changement dans leurs communautés, capables de promouvoir des valeurs de paix et de tolérance, essentielles à la prévention des conflits¹⁴.
Ces différents axes de coopération se rejoignent et s’enrichissent mutuellement, créant ainsi un cadre propice à une stratégie globale et innovante en matière de sécurité humaine. Ainsi, la synergie entre acteurs étatiques et non étatiques peut devenir un moteur de changement, facilitant l’émergence d’un ordre international plus inclusif et équitable[95]. Au-delà des réponses immédiatement nécessaires, c’est une vision à long terme de la sécurité humaine fondée sur le dialogue, le respect des droits et un engagement partagé pour le développement durable qui s’avère être la clé pour faire face aux défis contemporains, avec l’Ukraine comme exemple emblématique de ces besoins urgents et interconnectés[96].
En intégrant ces différentes dimensions, la communauté internationale pourra non seulement mieux répondre aux crises existantes, mais aussi prévenir l’émergence de nouvelles menaces pesant sur la sécurité humaine à l’avenir.
Conclusion générale
L’analyse de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur la sécurité humaine met en évidence l’urgence d’une approche multidimensionnelle, intégrant simultanément les volets militaire, social, économique, psychologique et environnemental. Ce conflit, emblématique des défis contemporains, illustre la complexité croissante des menaces auxquelles les sociétés sont confrontées et souligne que la sécurité humaine ne saurait être réduite à une simple logique de défense territoriale. Elle renvoie au contraire à un paradigme élargi, où la dignité des individus, la résilience des communautés et la préservation des droits fondamentaux deviennent les pierres angulaires des politiques de sécurité.
La guerre en Ukraine a révélé la fragilité des structures sociales face aux déplacements massifs de populations, aux crises économiques et à la désinformation. Elle a également montré la capacité de résilience et d’adaptation des acteurs locaux, qui, malgré des ressources limitées, ont su mettre en place des réponses innovantes et humanitaires. Cette résilience, bien que remarquable, ne peut suffire sans un soutien renforcé de la communauté internationale, appelé à jouer un rôle décisif dans la reconstruction, la médiation et l’accompagnement des réformes structurelles.
Par ailleurs, les leçons tirées de ce conflit rappellent la nécessité de dépasser les réponses ponctuelles et fragmentées. Les menaces hybrides, combinant opérations militaires, pressions économiques, désinformation et cyberattaques, exigent des stratégies globales et coordonnées. Dans ce contexte, la coopération internationale, la diplomatie préventive et le soutien aux initiatives locales deviennent des instruments stratégiques indispensables pour garantir une paix durable et prévenir de nouvelles escalades.
Enfin, la sécurité humaine en Ukraine, et plus largement dans le monde, ne saurait être dissociée des objectifs de développement durable. La lutte contre les inégalités, l’accès aux services essentiels, l’éducation à la paix et la protection de l’environnement constituent autant de leviers pour réduire les vulnérabilités et consolider la cohésion sociale. L’avenir de la sécurité humaine dépendra donc de la capacité des États, des organisations internationales et de la société civile à unir leurs efforts dans une vision commune, fondée sur la solidarité, la résilience et le respect universel des droits humains.
En définitive, le cas ukrainien n’est pas seulement un drame géopolitique, mais un révélateur des limites du système international actuel et des potentialités d’un nouvel ordre mondial plus inclusif et humain. Il invite à reconsidérer en profondeur les paradigmes de la sécurité, afin de bâtir des sociétés capables de résister aux chocs, de protéger leurs citoyens et de transformer les crises en opportunités pour une paix durable et partagée.
Bibliographie
Ouvrages et monographies
- Bellamy, A. J. (2015). The responsibility to protect: A defense. Oxford University Press.
- Boutros-Ghali, B. (1992). An agenda for peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping. United Nations.
- Desportes, V. (2019). La guerre probable.
- Freedman, L. (2017). The future of war: A history. PublicAffairs.
- Freedman, L. (2022). Command: The politics of military operations from Korea to Ukraine. Oxford University Press.
- Hoffman, F. G. (2007). Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars. Potomac Institute for Policy Studies.
- Kaldor, M. (2012). New and old wars: Organized violence in a global era (3rd ed.). Stanford University Press.
- Rid, T. (2013). Cyber war will not take place. Hurst & Company.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
- Snyder, T. (2018). The road to unfreedom: Russia, Europe, America. Tim Duggan Books.
Articles académiques
- Flockhart, T. (2022). Resilience and the war in Ukraine: Civil society responses to crisis. European Security, 31(4), 567–585. :
- https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2098761
- Giblin, B. (2023). Russie-Ukraine : nouvelle géopolitique du monde. Hérodote, 190, 3–15. Cairn Info. https://shs.cairn.info/article/HER_190_0003
- Kuzio, T. (2023). Russia’s war against Ukraine: The challenges of a hybrid conflict. Journal of Strategic Studies, 46(5), 789–807.:
- https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2198765
- Libiseller, C. (2023). ‘Hybrid warfare’ as an academic fashion. Journal of Strategic Studies, 46(9), 1673–1696. https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2177987
- Marchand, P. (2014). Le conflit ukrainien : des enjeux géopolitiques et géoéconomiques. ÉchoGéo, 29. https://doi.org/10.4000/echogeo.13976
- Parmentier, F. (2025, juin 28). Le message de Srebrenica (Policy brief). Institut Jacques Delors.:
- https://institutdelors.eu/publications/le-message-de-srebrenica/
- Raitasalo, J. (2016). Getting a grip on the so-called “hybrid warfare.” Air & Space Power Journal (French edition), 8(3):
- https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_French/journals_E/Volume-08_Issue-3/raitasalo_e.pdf
Rapports institutionnels et organisations internationales
- Banque mondiale. (2025, février 25). Updated Ukraine recovery and reconstruction needs assessment. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/02/25/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released
- Banque mondiale, Gouvernement d’Ukraine, Commission européenne, & Nations Unies. (2023). Ukraine rapid damage and needs assessment: One year update. World Bank Group.
- Commission européenne. (2022, mai 18). REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition (COM(2022) 230 final). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
- Commission européenne. (2025). EU solidarity with Ukraine (factsheet): The Ukraine Facility 2024–2027. Publications Office of the European Union. https://commission.europa.eu
- Council of Europe. (2022). Human rights challenges in the context of the war in Ukraine. Council of Europe Publishing.
- International Committee of the Red Cross. (2023, mai 25). War in cities: Preventing and addressing the humanitarian consequences for civilians. https://www.icrc.org/en/publication/4701-war-cities-preventing-and-addressing-humanitarian-consequences-civilians
- (2021). Countering disinformation: A whole-of-society approach. NATO Strategic Communications Centre of Excellence.
- (2022, juin 17). Protection of civilians: A constant in the changing security environment. NATO Review: https://www.nato.int/docu/review/articles/2022/06/17/protection-of-civilians-a-constant-in-the-changing-security-environment/index.html
- (2024, novembre 13). Resilience, civil preparedness and Article 3. https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_132722.htm
- (2025, juin 26). Relations with Ukraine.: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm
- (2025, janvier 16). Ukraine—Humanitarian needs and refugee response plan. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.unocha.org
- Organisation de coopération et de développement économiques. (2021). States of fragility 2021: Strengthening resilience. OECD Publishing.
- Organisation des Nations Unies. (2015). Transformer notre monde : Le Programme de développement durable à l’horizon 2030.
- Organisation des Nations Unies. (2023). Annual report of the Secretary-General on the protection of civilians in armed conflict. ONU.
- (1994). Human development report 1994: New dimensions of human security. Oxford University Press.
- (2022). Special report on human security: New threats in the Anthropocene. United Nations Development Programme.: https://hdr.undp.org/content/2022-special-report-human-security
- (2022). Guidance for addressing disinformation on digital platforms. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org
- (2023). Ukraine situation: Regional refugee response plan. UNHCR.
- (2025). Ukraine—Operational Data Portal. : https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
Think tanks, centres de recherche et ONG
- Center for Strategic and International Studies. (2022, juin 16). Cyber war and Ukraine. https://www.csis.org/analysis/cyber-war-and-ukraine
- Center for Strategic and International Studies. (2025, mai 2). Lessons from the Ukraine conflict: Modern warfare in the age of autonomy, information, and resilience. https://www.csis.org/analysis/lessons-ukraine-conflict-modern-warfare-age-autonomy-information-and-resilience
- Center for Strategic and International Studies. (2025, mai 28). The Russia-Ukraine drone war: Innovation on the frontlines and beyond. https://www.csis.org/analysis/russia-ukraine-drone-war-innovation-frontlines-and-beyond
- International Crisis Group. (2023). Responding to wartime governance challenges in Ukraine. https://www.crisisgroup.org
- Paul, C., & Matthews, M. (2016). The Russian “Firehose of Falsehood” propaganda model. RAND Corporation. : https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html
- Helmus, T. C., & Klein, K. (2019). Assessing Russian activities and intentions in recent US elections. RAND Corporation.
- Stockholm International Peace Research Institute. (2025, avril 28). Trends in world military expenditure, 2024 (SIPRI Fact Sheet).: https://www.sipri.org/publications/2025/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2024
Articles en ligne, presse et médias
- (2025, mars 12). What we have learnt about FIMI after three years of full-scale war in Ukraine. https://euvsdisinfo.eu/what-we-have-learnt-about-fimi-after-three-years-of-full-scale-war-in-ukraine/
- Financial Times. (2025, août). Rebuilding Ukraine is an opportunity for European companies.: https://www.ft.com/content/1fa70f04-7844-4b5f-8573-eb6a7ca1970e
- Le Grand Continent. (2024, décembre 3). Mobiliser la société pour la guerre : les leçons d’Ukraine. https://legrandcontinent.eu/fr/2024/12/03/mobiliser-la-societe-pour-la-guerre
- (2023). La défense innovante de l’Ukraine : défis technologiques face à l’offensive russe. https://newskorr.com
- Parti Communiste Français. (2022). Journée internationale de la paix : Marchons pour la paix ! http://oise.pcf.fr/122177
- Talibi, B. (2023). Les enjeux géopolitiques du gaz et la bataille Nord Stream. https://www.researchgate.net/publication/378519359
[1] Marchand, P. (2014). Le conflit ukrainien : des enjeux géopolitiques et géoéconomiques. ÉchoGéo. https://journals.openedition.org/echogeo/13976.
[2] Giblin, B. (2023). Russie-Ukraine : nouvelle géopolitique du monde. Cairn Info. https://shs.cairn.info/article/HER_190_0003
[3] Talibi, B. (2023). Les enjeux géopolitiques du gaz et la bataille Nord Stream. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/378519359.
[4] Newskorr. (2023). La défense innovante de l’Ukraine : défis technologiques face à l’offensive estivale russe. https://newskorr.com/la-defense-par-les-filets-de-peche-de-lukraine
[5] Le Grand Continent. (2024). Mobiliser la société pour la guerre : les leçons d’Ukraine. https://legrandcontinent.eu/fr/2024/12/03/mobiliser-la-societe-pour-la-guerre
[6] Parti Communiste Français [PCF]. (2022). Journée internationale de la paix : Marchons pour la paix !. http://oise.pcf.fr/122177
[7] Commission des Nations Unies. (1994). Human Development Report 1994. Oxford University Press.
[8] Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
[9] Giblin, B. (2023). Russie-Ukraine : nouvelle géopolitique du monde. Cairn Info. https://shs.cairn.info/article/HER_190_0003
[10] Marchand, P. (2014). Le conflit ukrainien : des enjeux géopolitiques et géoéconomiques. ÉchoGéo. https://journals.openedition.org/echogeo/13976
[11] Talibi, B. (2023). Les enjeux géopolitiques du gaz et la bataille Nord Stream. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/378519359
[12] Newskorr. (2023). La défense innovante de l’Ukraine : défis technologiques face à l’offensive russe. https://newskorr.com
[13] Le Grand Continent. (2024). Mobiliser la société pour la guerre : les leçons d’Ukraine. https://legrandcontinent.eu/fr/2024/12/03/mobiliser-la-societe-pour-la-guerre
[14] United Nations Development Programme [UNDP]. (2022). Human Security and the New Threats. UNDP Publications.
[15] Parti Communiste Français [PCF]. (2022). Journée internationale de la paix : Marchons pour la paix !. http://oise.pcf.fr/122177
[16] Marchand, P. (2014). Le conflit ukrainien : des enjeux géopolitiques et géoéconomiques. EchoGéo. https://doi.org/10.4000/echogeo.13976
[17] NATO. (2022, June 17). Protection of civilians: A constant in the changing security environment. NATO Review. https://www.nato.int/docu/review/articles/2022/06/17/protection-of-civilians-a-constant-in-the-changing-security-environment/index.html
[18] European Commission. (2022). REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition. European Commission/EEAS. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-external-energy-policy-repowereu_en
[19] European Commission. (2025). REPowerEU — Three years on. Energy – European Commission. https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/repowereu-3-years_en
[20] Center for Strategic and International Studies. (2025, May 28). The Russia-Ukraine drone war: Innovation on the frontlines and beyond. https://www.csis.org/analysis/russia-ukraine-drone-war-innovation-frontlines-and-beyond
[21] Colin Lebedev, A. (2024, December 3). Mobiliser la société pour la guerre : les leçons d’Ukraine. Le Grand Continent. https://legrandcontinent.eu/fr/2024/12/03/mobiliser-l-a-societe-pour-la-guerre-les-lecons-dukraine/
[22] Stockholm International Peace Research Institute. (2025, April 28). Trends in world military expenditure, 2024 (SIPRI Fact Sheet). https://www.sipri.org/publications/2025/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2024
[23] Libiseller, C. (2023). ‘Hybrid warfare’ as an academic fashion. Journal of Strategic Studies, 46(9), 1673–1696. https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2177987
[24] Lewis, J. A. (2022, June 16). Cyber war and Ukraine. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/cyber-war-and-ukraine
[25] NATO. (2022, June 17). Protection of civilians: A constant in the changing security environment. NATO Review. https://www.nato.int/docu/review/articles/2022/06/17/protection-of-civilians-a-constant-in-the-changing-security-environment/index.html
[26] Center for Strategic and International Studies. (2025, May 2). Lessons from the Ukraine conflict: Modern warfare in the age of autonomy, information, and resilience. https://www.csis.org/analysis/lessons-ukraine-conflict-modern-warfare-age-autonomy-information-and-resilience
[27] Stockholm International Peace Research Institute. (2025, April 28). Trends in world military expenditure, 2024 (SIPRI Fact Sheet). https://www.sipri.org/publications/2025/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2024
[28] European Commission. (2022, May 18). REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition (COM(2022) 230 final). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0230
[29] United Nations Development Programme. (2022). 2022 Special report on human security: New threats to human security in the Anthropocene. UNDP. https://hdr.undp.org/content/2022-special-report-human-security
[30] Libiseller, C. (2023). ‘Hybrid warfare’ as an academic fashion. Journal of Strategic Studies, 46(9), 1673–1696. https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2177987
[31] NATO. (2022, June 17). Protection of civilians: A constant in the changing security environment. NATO Review. https://www.nato.int/docu/review/articles/2022/06/17/protection-of-civilians-a-constant-in-the-changing-security-environment/index.html
[32] European Commission. (2022, May 18). REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition (COM(2022) 230 final). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0230
[33] Stockholm International Peace Research Institute. (2025, April 28). Trends in world military expenditure, 2024 (SIPRI Fact Sheet). SIPRI. https://www.sipri.org/publications/2025/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2024
[34] aitasalo, J. (2016). Getting a grip on the so-called “hybrid warfare”. Air & Space Power Journal (French edition), 8(3). https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_French/journals_E/Volume-08_Issue-3/raitasalo_e.pdf
[35] Lewis, J. A. (2022, June 16). Cyber war and Ukraine. Center for Strategic and International Studies (CSIS). https://www.csis.org/analysis/cyber-war-and-ukraine
[36] EUvsDisinfo. (2025, March 12). What we have learnt about FIMI after three years of full-scale war in Ukraine. https://euvsdisinfo.eu/what-we-have-learnt-about-fimi-after-three-years-of-full-scale-war-in-ukraine/
[37] International Committee of the Red Cross. (2023, May 25). War in cities: Preventing and addressing the humanitarian consequences for civilians. https://www.icrc.org/en/publication/4701-war-cities-preventing-and-addressing-humanitarian-consequences-civilians
[38] NATO. (2024, November 13). Resilience, civil preparedness and Article 3. https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_132722.htm
[39] Raitasalo, J. (2016). Getting a grip on the so-called “hybrid warfare”. Air & Space Power Journal (French edition), 8(3). https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_French/journals_E/Volume-08_Issue-3/raitasalo_e.pdf
[40] Lewis, J. A. (2022, June 16). Cyber war and Ukraine. Center for Strategic & International Studies. https://www.csis.org/analysis/cyber-war-and-ukraine
[41] International Committee of the Red Cross. (2023, May 25). War in cities: Preventing and addressing the humanitarian consequences for civilians. https://www.icrc.org/en/publication/4701-war-cities-preventing-and-addressing-humanitarian-consequences-civilians
[42] NATO. (2024, November 13). Resilience, civil preparedness and Article 3. https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_132722.htm
[43] NATO. (2022, June 17). Protection of civilians: A constant in the changing security environment. NATO Review. https://www.nato.int/docu/review/articles/2022/06/17/protection-of-civilians-a-constant-in-the-changing-security-environment/index.html
[44] Hoffman, F. G. (2007). Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars. Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies.
[45] Freedman, L. (2017). The future of war: A history. New York: PublicAffairs.
[46] Kaldor, M. (2012). New and old wars: Organized violence in a global era (3rd ed.). Stanford: Stanford University Press.
[47] Rid, T. (2013). Cyber war will not take place. London: Hurst & Company.
[48] Bellamy, A. J. (2015). The responsibility to protect: A defense. Oxford: Oxford University Press.
[49] OCHA. (2025, 16 janvier). Ukraine—Summary of the Humanitarian Needs and Response Plan and Regional Refugee Response Plan. https://www.unocha.org/publications/report/ukraine/ukraine-summary-humanitarian-needs-and-response-plan-and-regional-refugee-response-plan-january-2025-enuk
[50] UNHCR. (2025). Ukraine—Operational Data Portal. https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
[51] Parmentier, F. (2025, 28 juin). Le Message de Srebrenica (Policy brief). Institut Jacques Delors. https://institutdelors.eu/publications/le-message-de-srebrenica/
[52]SIPRI. (2025, 28 avril). Trends in world military expenditure, 2024 (SIPRI Fact Sheet). https://www.sipri.org/publications/2025/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2024
[53] Commission européenne. (2022, 18 mai). REPowerEU Plan (COM(2022) 230 final). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
[54] NATO Review. (2022, 17 juin). Protection of civilians: A constant in the changing security environment. https://www.nato.int/docu/review/articles/2022/06/17/protection-of-civilians-a-constant-in-the-changing-security-environment/index.html
[55] Banque mondiale. (2025, 25 février). Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment—Press release. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/02/25/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released
[56] Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. Council of Europe.
[57] NATO. (2021). Countering disinformation: A whole-of-society approach. NATO Strategic Communications Centre of Excellence.
[58] Paul, C., & Matthews, M. (2016). The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html
[59] Helmus, T. C., & Klein, K. (2019). Assessing Russian activities and intentions in recent US elections. RAND Corporation.
[60] United Nations. (2023). Annual report of the Secretary-General on the protection of civilians in armed conflict. UN Security Council.
[61] World Bank. (2025, February 25). Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs assessment released. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/02/25/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released
[62] NATO Review. (2022, June 17). Protection of civilians: A constant in the changing security environment. https://www.nato.int/docu/review/articles/2022/06/17/protection-of-civilians-a-constant-in-the-changing-security-environment/index.html
[63] European Commission. (2025, August). Support for Ukraine’s resilience. https://commission.europa.eu/topics/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/support-ukraines-resilience_en
[64] NATO Review. (2022, June 17). Protection of civilians: A constant in the changing security environment. https://www.nato.int/docu/review/articles/2022/06/17/protection-of-civilians-a-constant-in-the-changing-security-environment/index.html
[65] EU for Ukraine. (2024–2025). Ukraine Facility (2024–2027): Up to €50 billion. https://eu4ukraine.eu/en
[66] NATO. (2025, June 26). Relations with Ukraine. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm
[67] Humanitarian Action. (2025, July 1). Ukraine Humanitarian Needs and Response Plan 2025 – Humanitarian Response Strategy. https://humanitarianaction.info/plan/1271/document/ukraine-humanitarian-needs-and-response-plan-2025/article/21-humanitarian-response-strategy-8
[68] Financial Times. (2025, August). Rebuilding Ukraine is an opportunity for European companies. https://www.ft.com/content/1fa70f04-7844-4b5f-8573-eb6a7ca1970e
[69] World Bank. (2025, February 25). Updated Ukraine recovery and reconstruction needs assessment released. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/02/25/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released
[70] UNHCR. (2025). Ukraine refugee situation – Operational Data Portal. United Nations High Commissioner for Refugees. https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
[71] UNESCO. (2022). Guidance for addressing disinformation on digital platforms. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org
[72] European Commission. (2025). EU solidarity with Ukraine (factsheet): The Ukraine Facility 2024–2027. Publications Office of the European Union. https://commission.europa.eu
[73] NATO. (2025, June 26). Relations with Ukraine. North Atlantic Treaty Organization. https://www.nato.int
[74] IOM. (2024). Ukraine internal displacement report – General population survey. International Organization for Migration. https://displacement.iom.int
[75] OCHA. (2025, January). Ukraine: Humanitarian needs and response plan & regional refugee response (summary). United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.unocha.org
[76] Kuzio, T. (2023). Russia’s war against Ukraine: The challenges of a hybrid conflict. Journal of Strategic Studies, 46(5), 789–807. https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2198765
[77] Kaldor, M. (2013). New and old wars: Organized violence in a global era (3rd ed.). Stanford University Press.
[78] Freedman, L. (2022). Command: The politics of military operations from Korea to Ukraine. Oxford University Press.
[79] International Crisis Group. (2023). Responding to wartime governance challenges in Ukraine. https://www.crisisgroup.org
[80] Flockhart, T. (2022). Resilience and the war in Ukraine: Civil society responses to crisis. European Security, 31(4), 567–585. https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2098761
[81] United Nations Development Programme. (1994). Human development report 1994: New dimensions of human security. Oxford University Press
[82] Organisation des Nations Unies. (2015). Transformer notre monde: Le Programme de développement durable à l’horizon 2030. ONU.
[83] Organisation de coopération et de développement économiques. (2021). States of fragility 2021: Strengthening resilience. OECD Publishing
[84] Organisation des Nations Unies. (2015). Transformer notre monde: Le Programme de développement durable à l’horizon 2030. ONU.
[85] Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge University Press.
[86] World Bank, Government of Ukraine, European Commission, & United Nations. (2023). Ukraine rapid damage and needs assessment: One year update. World Bank Group.
[87] United Nations Development Programme. (1994). Human development report 1994: New dimensions of human security. Oxford University Press.
[88] Council of Europe. (2022). Human rights challenges in the context of the war in Ukraine. Strasbourg: CoE.
[89] Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. (2023). OSCE response to the crisis in Ukraine. OSCE.
[90] Office of the High Commissioner for Human Rights. (2023). Report on the human rights situation in Ukraine. ONU.
[91] United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). Ukraine situation: Regional refugee response plan. UNHCR.
[92] Organisation de coopération et de développement économiques. (2021). States of fragility 2021: Strengthening resilience. OECD.
[93] Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation, and vulnerability. Cambridge University Press.
[94] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2017). Education for peace and prevention of violent extremism. UNESCO.
[95] Boutros-Ghali, B. (1992). An agenda for peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping. United Nations.
[96] United Nations General Assembly. (2022). Resolution ES-11/1: Aggression against Ukraine. United Nations.