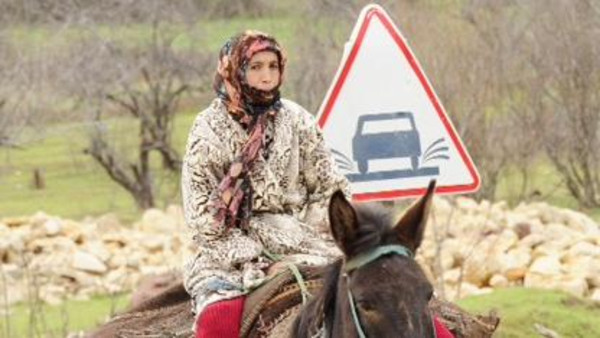Défis Socioculturels dans l’Apprentissage : Inégalités, Origines des Difficultés, Soft Skills et Voies d’Amélioration

Prepared by the researche : Ghizlane Hajjoubi – Doctorante, sous la direction du professeur Lahcen Ouasmi – Université Hassan II de Casablanca – Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik – Laboratoire « Langues, Littératures et Communication » « LALICO »
Democratic Arabic Center
Journal of African Studies and the Nile Basin : Twenty-sixth Issue – June 2024
A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin
Journal of African Studies and the Nile Basin
:To download the pdf version of the research papers, please visit the following link
Résumé
La recherche dans le domaine de l’enseignement de la langue révèle un paysage complexe, où sa compréhension et de son apprentissage nécessite une approche nuancée.
En se penchant sur cinq articles clés, cet article examine les défis inhérents à la variation linguistique et aux inégalités d’apprentissage dans le contexte scolaire. Nous mettant en lumière les lacunes de la diversité linguistique, ainsi que les obstacles rencontrés dans les pratiques langagières en classe.
En proposant des solutions adaptées, en explorant des pistes pour un enseignement du français plus inclusif et efficace et en adaptant les pratiques éducatives en conséquence, il est possible de favoriser un apprentissage authentique et enrichissant pour tous les apprenants.
Abstract
Research in the field of language education reveals a complex landscape, where understanding and learning require a nuanced approach. By examining five key articles, this paper explores the inherent challenges of linguistic variation and learning inequalities in the school context. It highlights the shortcomings of linguistic diversity, as well as the obstacles encountered in language practices in the classroom. By proposing tailored solutions and exploring pathways for a more inclusive and effective teaching of French, and by adapting educational practices accordingly, it is possible to foster authentic and enriching learning for all students.
Introduction
Les recherches sur la langue réelle et son enseignement est une tache complexe. Cette complexité découle de l’approche qui englobe de multiples niveaux (social, pédagogique, idéologique, politique, didactique…) concernant la nature même d’une langue et de son enseignement-apprentissage. Cependant, l’effort pour trouver un fil conducteur entre ces diverses approches est fondamental pour une meilleure compréhension de la réalité linguistique quotidienne ainsi que des pratiques linguistiques à l’école. Cela devient une exigence fondamentale si l’on souhaite promouvoir la justice linguistique et accroître l’efficacité à tous les niveaux de l’usage de la langue.
- Problématique
La variation linguistique représente un défi majeur, notamment au Maroc où cette diversité n’est pas reconnue ni intégrée dans le système éducatif. De plus, la politique linguistique favorise traditionnellement l’uniformisation, ce qui pourrait entraver l’enseignement et l’apprentissage de la langue.
Les travaux de Bautier, É. (2008), Emmanuelle, G., & Bellonie, J. D. (2010) et Guérin, E. (2013) explorent une problématique commune : la variation de la langue et du langage au sein d’une société culturellement diversifiée, confrontée aux pratiques linguistiques scolaires visant à établir et à promouvoir l’unification et la standardisation d’un français considéré comme légitime.
- Contexte Socioculturel et Disparités dans l’Apprentissage : Origines des Obstacles à l’Enseignement et à l’Apprentissage
L’environnement social de l’apprenant exerce une influence majeure sur l’acquisition de la langue et du langage. Comme le souligne Bautier, É. (2008) l’existence d’inégalités sociales où les pratiques linguistiques défavorisent souvent les enfants issus de milieux sociaux populaires ou moins favorisés. Cette situation découle principalement d’une diversité linguistique étendue, où les enfants n’apprennent pas à écrire et à parler la même langue que celle utilisée en dehors de l’école car ils ne sont pas nécessairement exposés à la même langue à l’école et dans leur environnement Hors du Cadre Scolaire. Ces différences linguistiques peuvent poser des défis significatifs, car elles ne correspondent pas toujours aux normes linguistiques promues dans le contexte scolaire.
Emmanuelle, G., & Bellonie, J. D. (2010) mettent en lumière la variété de la langue au sein de la société, soulignant que les dysfonctionnements constatés résultent de l’absence de prise en compte de ces variations linguistiques dans l’environnement socioculturel des apprenants.
Guérin, E. (2013) mentionne que les enfants évoluent dans un environnement où circulent différentes langues, parfois cloisonné au point où ils n’auraient accès qu’à des formes linguistiques régies par des “codes restreints”. Ainsi, selon lui, il est incorrect d’évoquer un “handicap linguistique” affectant ces enfants qui ne sont pas exposés, en dehors de l’école, à la forme légitime du français.
Bautier, É. (2008), Emmanuelle, G., & Bellonie, J. D. (2010) et Guérin, E. (2013) abordent les obstacles rencontrés lors de l’enseignement et de l’apprentissage du français. Comme le suggère la problématique, ces difficultés découlent généralement de la variabilité de la langue et de la diversité socioculturelle. Bautier, É. (2008), l’accent est mis sur la priorité accordée à la maîtrise de la langue au détriment de la diversité (notamment chez les élèves issus de milieux populaires), ce qui conduit à une négligence majeure dans l’approche pédagogique, notamment en ce qui concerne le langage et l’écrit.
Dans la plupart des cas, les activités scolaires se concentrent principalement sur les aspects matériels, laissant de côté les aspects cognitifs voire sociocognitifs de l’apprentissage. Emmanuelle, G., & Bellonie, J. D. (2010), en se focalisant sur les niveaux d’apprentissage inférieurs, soulignent que les difficultés surviennent lorsque l’on ignore l’intersection entre l’oralité et la littératie dans l’éducation, ce qui est en contraste avec la réalité. Il mentionne également que les enseignants exposent tous les élèves aux mêmes méthodes d’apprentissage, sans tenir compte de leurs capacités et de leurs références socioculturelles diverses. En outre, ces enseignants accordent de la valeur à des compétences telles que l’organisation et l’écrit, tout en dévalorisant les compétences liées à l’oralité en classe.
Du point de vue Guérin, E. (2013), ces difficultés se situent à deux niveaux. Premièrement, il s’agit de l’idéologie de la norme linguistique : la langue n’est jamais remise en question, elle est considérée comme un modèle surévalué pour l’enseignement. Deuxièmement, il est question de la manière dont les connaissances sont transmises aux élèves, notamment à travers les manuels de langue française et les pratiques éducatives qui présentent une langue unique. Or, cette langue est très éloignée de celle que les élèves rencontrent au quotidien. Face à cette disparité, il devient difficile de qualifier cela de handicap linguistique.
- Alternatives et Solutions Proposées
D’après les propositions d’Emmanuelle G. et Bellonie J.D. (2010), il est observé que les élèves arrivent à la maternelle et CP avec des compétences qui sont les leurs, ces compétences sont suffisantes pour tirer profit de l’enseignement. Cependant il ne faut pas les mettre devant des situations qui demandent des connaissances diverses, instable et on doit déterminer les connaissances orales et sujet d’apprentissage et les adapter aux besoins d’apprentissage.
Bautier, É. (2008) propose la mise en œuvre de situations de discours scolaires plus démocratiques, plus participatifs, plus respectueux des identités individuelles, du fait de la possibilité pour chacun d’intervenir, les pratiques du discours pédagogique doivent être révisées pour permettre aux élèves dans toutes leurs différences d’apprendre. L’approche de Bautier (2008) met en avant l’importance de créer un environnement de classe où chaque élève se sente capable de participer activement aux discussions où tout élève aura la possibilité de parler, de partager ses idées et ses expériences, cela crée un environnement inclusif où chacun se sent entendu et respecté, ce qui favorise un meilleur apprentissage. Pour mettre en place cette approche, il est nécessaire de revoir la manière dont les enseignants dirigent les discussions en classe comme par exemple : créer des activités où tous les élèves, indépendamment de leurs différences culturelles, linguistiques sociales, peuvent y participer pleinement. Autrement dis , promouvoir un environnement éducatif où la diversité est célébrée rend l’apprentissage plus intéressant et adapté aux besoins individuels de chacun.
Guérin, E. (2013) invite à une réflexion de fond sur ce qui pourrait être mis en œuvre pour proposer un enseignement du français, qui permettrait aux élèves d’accepter les savoirs en jeu sans que ceux-ci soient la condition à leur participation à la société française mais plutôt en tant qu’ils enrichissent leur répertoire linguistique pour développer leur champ d’action dans la société qu’ils contribuent à faire vivre.
La présence de différentes langues dites maternelles parmi les élèves est souvent identifiée comme un facteur pouvant expliquer les difficultés rencontrées à l’école.
Dans l’apprentissage de langue l’utilisation, par exemple, du critère du pourcentage d’élèves ayant des parents non-francophones pour classer les Réseaux Ambition Réussite (RAR), au même titre que les difficultés socioéconomiques. Ainsi, le fait que les enfants évoluent dans un environnement linguistique autre que le français est considéré dès le départ comme un obstacle à leur réussite. Pourtant, cette perspective peut sembler paradoxale dans un contexte où l’importance de l’enseignement des langues étrangères et de la diversité culturelle est soulignée.
Cependant, cette situation soulève des questions sur les inégalités, surtout dans la valorisation des différentes langues et cultures. Par exemple, la maîtrise du français et de l’arabe n’est pas perçue de la même manière sur le marché éducatif que la maîtrise du français et de l’anglais.
Pour aborder cette problématique, deux approches complémentaires peuvent être envisagées. D’une part, une approche externe exploite la diversité linguistique pour enrichir l’enseignement du français, comme le font certains programmes d’éveil aux langues qui favorise le développement de compétences métalinguistiques. D’autre part, une approche interne prend en considération les représentations sociales pour repenser l’enseignement du français en tenant compte de la diversité sociolinguistique des élèves.
Cette dernière approche interroge la manière dont l’école contribue à créer un “handicap linguistique” chez les enfants issus de l’immigration. Guérin, E. (2013) souligne que les savoirs enseignés en français laissent peu de place à la reconnaissance d’autres formes linguistiques ou à d’autres langues plutôt que de chercher un enrichissement par l’accumulation de connaissances, l’enseignement semble favoriser l’exclusivité d’une forme de savoir. Cela vise à influencer l’enseignement du français en considérant la place des autres langues à l’école, remettant en question la domination d’une seule langue et le manque de considération pour les autres langues dans la réalité quotidienne.
Guérin, E. (2013) propose une réflexion approfondie sur la manière de concevoir un enseignement du français qui permettrait aux élèves d’accepter les savoirs en jeu non pas comme une condition pour leur intégration à la société française, mais plutôt comme un enrichissement de leur répertoire linguistique, leur permettant ainsi d’élargir leur champ d’action au sein de la société à laquelle ils contribuent.
L’apprentissage et l’enseignement de la langue à l’école n’est pas une opération facile et mécanique, et ne vise pas un cumul des compétences linguistiques pour servir une idéologie Unifiante, cependant c’est une interaction continue de la réalité socioculturelle et l’école ; ce système éducatif en effet est appelé à reconnaitre les variations de la langue et du langage issues du milieu social et respecter les identités individuelles des enfants.
Conclusion
Le milieu socioculturel a un apport réellement majeur dans le processus d’apprentissage scolaire, ce qui est prouvé par témoignage des différentes études, et son absence dans le processus d’apprentissage engendre des difficultés scolaires chez des élèves depuis le bas âge en matière d’apprentissage des langues et par conséquent dans tous les apprentissages des autres disciplines.
Toutefois, l’élève n’arrive pas, comme on croyait autrefois, comme une page blanche à l’école sans aucun compétence ni habilité ni savoir, mais il entretient des relations étroites avec son milieu socioculturel et subit ses influences tous les jours. Pour favoriser la démocratisation de l’école et mieux répondre aux besoins des élèves, il est nécessaire de revoir les approches éducatives et la démarche d’enseignement. Cela inclut la nécessité de contextualiser les connaissances enseignées, de diversifier les supports pédagogiques et de prendre en compte les spécificités des élèves issus de milieux populaires dans l’enseignement. Les pratiques scolaires, doit être adaptée à ces spécificités. De cette façon l’élève trouve une transposition de ses acquis scolaire de l’école et s’engagera plus dans les cours scolaires puisqu’ils correspondent plus à sa propre pensée.
En intégrant ces soft skills dans les pratiques éducatives, nous pouvons instaurer un environnement d’apprentissage qui est à la fois inclusif, efficace et respectueux de la diversité linguistique. Cette approche non seulement permettra de surmonter les défis posés par la variation linguistique, mais aussi de préparer les élèves à devenir des citoyens compétents et empathiques dans un monde globalisé.
Bibliographie
- Bautier, É. (2008). Ambitions et paradoxes des pratiques langagières scolaires: constructions au quotidien des inégalités sociales d’apprentissage. In Actes du colloque «Ce que l’école fait aux individus». Nantes: CENS et CREN, Université de Nantes. En ligne: http://www. cren-nantes. net/IMG/pdf/Bautier. pdf.
- Bernardin, J. (2014). Culture écrite et inégalités: Entretien. Le français aujourd’hui, 185, 9-
- Emmanuelle, G., & Bellonie, J. D. (2010, October). On n’enseigne pas la langue à l’école: là est le problème. In Congrès international AREF 2010 (Actualité de la recherche en éducation et en formation).
- Guérin, E. (2013). La validité de la notion de «handicap linguistique» en question. Le français aujourd’hui, (4), 91-104.
- Nonnon, É. (2014). Langage oral et inégalités scolaires: Entretien. Le français aujourd’hui, 185, 17-24. https://doi.org/10.3917/lfa.185.0017